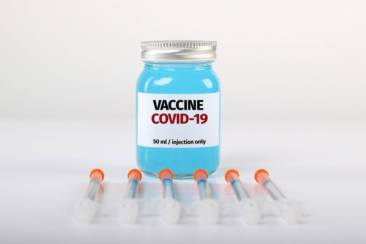Pas encore ménopausées, mais plus censées être mères : c’est le lot des femmes à partir de 40 ans, l’âge où débute la « ménopause sociale ». Une règle qui ne dit pas son nom, mais qui influence les femmes, leur rapport à la maternité et, plus encore, le regard qu’on porte sur elles.
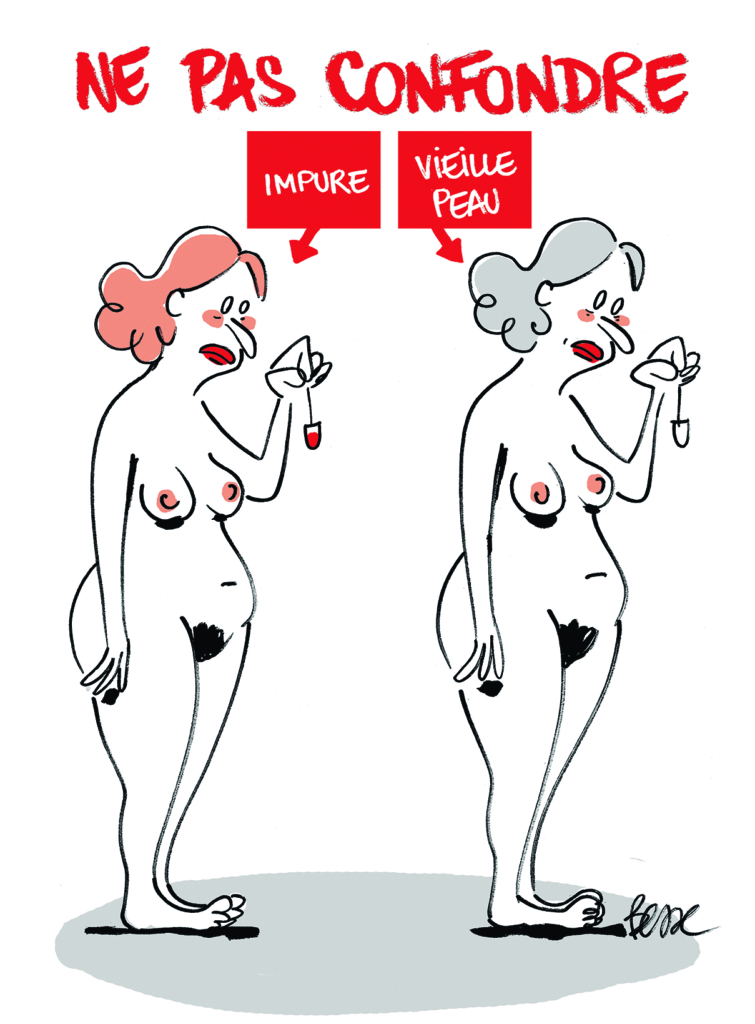
« J’ai eu mes deux premiers enfants à 18 et 24 ans. À 42 ans, j’ai eu envie d’en avoir un troisième. Mais j’ai eu peur que l’écart d’âge dans la fratrie soit trop important. Et puis je n’avais pas envie de faire “un enfant de vieux”, alors j’ai renoncé », confie Ghislaine, aujourd’hui grand-mère. Ce qu’elle raconte là n’est ni singulier ni anodin : c’est la parfaite illustration de ce que la sociologue Cécile Charlap appelle la « ménopause sociale », cette norme qui veut que, après 40 ans, les femmes ne sont plus censées faire d’enfants, même si elles sont encore fertiles. « Un bon usage du corps est enjoint aux femmes à partir de la quarantaine : elles passent du pouvoir de procréer au devoir de ne plus le faire », explique Cécile Charlap dans sa thèse sur la ménopause.
Cet interdit, l’ethnologue Véronique Moulinié l’avait déjà pointé dans son travail sur les opérations chirurgicales et leur portée sociale1 au début des années 1990. À l’époque, elle avait enquêté dans le Lot-et-Garonne auprès de femmes qui, dans[…]