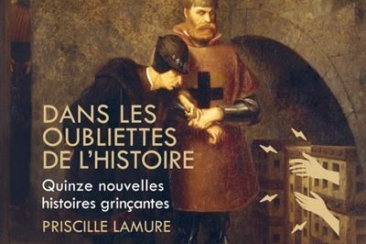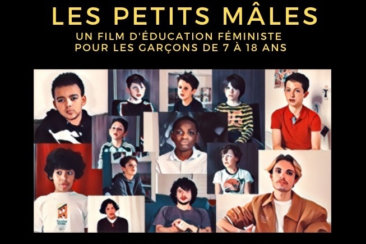Causette s’associe au webzine Contre Attaque, média créé par de jeunes amatrices de foot et dont nous vous parlions ici. Toutes les deux semaines, le samedi, vous trouverez sur notre site l’un de leurs articles. Dans ce quatrième épisode, nous vous proposons de découvrir l'histoire et les nombreuses règles qui encadrent une action footballistique aussi connue que sujette à controverse : le penalty. Parce qu'à quelques jours du début de l'Euro, c'est un peu la notion à maîtriser.
Pour lire les beaux webzines de Contre Attaque, c’est ici.
Par Chloé Michel
Olympico, 28 février 2021 : l'Olympique lyonnais affronte l'Olympique de Marseille. Alors que les supporters marseillais trouvent miraculeux de n’être menés que d’un but, c’est par un penalty – qui provoquera de nombreux débats – que leur équipe va revenir au score juste avant la mi-temps. Selon l’arbitre Benoît Millot, Lucas Paquetá est coupable d’une faute de main suite à un tir en force de Pape Gueye, à l’entrée de la surface. Cette erreur permet à Arkadiusz Milik de marquer le but du match nul. Après cette partie tendue, les différentes interprétations du règlement s’opposent : pour l’Olympique lyonnais, le premier contact entre le corps de Paqueta et le ballon, avant le rebond sur le bras, rend la faute de main inexistante. Pour les autres, le défenseur se serait trouvé en position non naturelle, augmentant artificiellement la surface de son corps avec un bras tendu au niveau de l’épaule. Animant nombre de débats footballistiques, parfois largement empreints de mauvaise foi, le penalty fête cette année ses 120 ans de présence dans les règles officielles du football. Alors, peno ou pas peno ?
La loi 14 du football
Aujourd’hui, la loi n°14 du football, encadrée par l’International Football Association Board (IFAB), est formulée ainsi : « Un penalty (coup de pied de réparation) est accordé si un joueur commet une faute passible d’un coup franc
direct dans sa propre surface de réparation […] comme décrit dans les Lois 12 et
13 »1. Autrement dit, toute faute sanctionnable par un coup franc direct, commise dans la surface de réparation du joueur fautif donne lieu à un penalty. C’est dans la loi 12 que sont énumérées les différentes fautes concernées, allant de la charge, au coup de pied ou au tacle, si effectués « de manière imprudente, inconsidérée ou violente ». Ces trois derniers qualificatifs décident de la sanction supplémentaire qui visera le joueur : une faute « imprudente » n’appellera pas de sanctions, tandis qu’une faute « inconsidérée » (sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences sur l’adversaire) provoquera un avertissement pour le joueur, et une faute « violente » (usage excessif de la force au risque de mettre en danger l’intégrité physique de l’adversaire) amènera l’exclusion. À ces fautes « physiques » s’ajoutent la tenue, ou retenue d’un adversaire, ainsi que la morsure et le crachat. Enfin sont concernées les fautes de main : l’IFAB définissant la limite de la « main » au bas de l’aisselle.
C’est d’un gardien de but irlandais que viendra l’idée, en 1890, du « penalty kick ». William McCrum voulait alors « limiter la brutalité des défenseurs ». Le championnat local l’introduit, et la Fédération irlandaise pousse pour qu’il soit codifié dans les règles internationales. Après un scepticisme assez large dans le monde du football, un match entre Notts County et Stoke City dans le championnat anglais relance le débat : malgré une main volontaire d’un joueur de Notts County sur sa ligne de but pour stopper le ballon, Stoke City n’en tire aucun bénéfice, le coup franc sifflé n’ayant pas été transformé. Le 2 juin 1891, le penalty devient alors la loi n°13 du football. Le 14 septembre, c’est John Heath, joueur de Wolverhampton, qui devient le premier joueur de l’histoire à marquer un but sur penalty. En 1902 est formellement introduit le point de penalty, et en 1930, le gardien français Alex Thépot arrêtera le premier penalty accordé en Coupe du monde, lors d’un match France-Chili.
D’Antonin Panenka qui, en 1976, donnera son nom à une technique particulière pour tirer ce coup de pied de réparation, à Johan Cruyff, qui marquera le premier penalty joué à deux en 1982 à l'aide de son compère Jesper Olsen (rien n’oblige le tireur à tirer directement au but, tant que la passe est vers l’avant et que le ballon passé par un autre joueur revient dans les pieds du tireur), les joueurs se sont, au fil des années, appropriés cette action si particulière, la rendant parfois légendaire.
Jeux de mains, jeux de vilains

Après 118 ans d’existence, le penalty en tant que loi du football va connaître une modification majeure en mars 2019, suite au 133e congrès annuel de l’IFAB. Voulant mettre fin aux multiples débats consécutifs aux penaltys sifflés pour faute de main, l’IFAB décide alors de supprimer la distinction entre main volontaire et involontaire, qui guidait auparavant l’arbitre dans sa décision. Les mains dans la surface seront donc systématiquement sanctionnées, que ce soit pour les défenseurs ou pour les attaquants. Les débats volontaire /involontaire sont donc désormais remplacés par des débats quant à l’utilisation de leur corps par les joueurs : augmentent-ils artificiellement la surface de leurs corps ? Sont-ils dans une position « naturelle » ?
Sur cette question, au vu des derniers matchs, personne ne semble bien d’accord. D’abord, la position « naturelle » telle que vue par l’IFAB ne convainc pas : pour Lionel Mathis, ex-milieu de terrain à Auxerre ou Guingamp, « c'est lorsqu'on a les bras raides le long du corps que la position n'est pas naturelle […] c’est impossible de bien défendre de cette façon »2. Lui aimerait qu’on responsabilise davantage les joueurs : pour Mathis, si le ballon rebondit sur le bras ou la main suite à un contrôle raté, la main devrait être sifflée.
Les penaltys, un symbole de l'émotion dans le football ?
Le débat est d’autant plus vif qu’il est bien souvent imprégné par la controverse autour de l’assistance à l’arbitrage vidéo. Alors que la distinction entre main volontaire et involontaire laissait une marge d’interprétation conséquente à l’arbitre, les vérifications actuelles paraissent éloigner « l’humain » de la décision : le contact main-ballon devient nécessairement problème, le sentiment de l’instant ne peut plus se substituer à la règle écrite. C’est en tout cas l’avis de Michel Platini, qui, dans une lettre à l’attention de Philippe Piat, président du syndicat des footballeurs, cible nettement les arbitres : « Ils n’ont plus à interpréter le règlement, mais simplement à l’appliquer. Comme si toutes leurs décisions devaient rentrer dans des cases. […] L’arbitre est un rouage essentiel du football, mais il n’en est pas l’architecte »3.
La VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) et les penaltys seraient-ils les tue‑l’amour du football ? Si la question divise, il est certain que certaines situations deviennent particulièrement ubuesques. Le huitième de finale retour entre Dortmund et Séville le 9 mars dernier l’a encore montré : alors qu’Haaland avait inscrit son deuxième but et s'apprêtait à marquer le troisième depuis le rond central, ce dernier a été annulé pour être remplacé par un penalty sifflé en faveur de Dortmund, en raison d'une charge illicite de Koundé. Un penalty d’abord manqué par ce même Haaland – car arrêté par le gardien sévillan – mais une minute plus tard annoncé illicite par la VAR, le gardien n’ayant pas les pieds sur sa ligne au moment du tir. Sur sa deuxième tentative, Haaland transforme le penalty et ramène son équipe à 2−0… lui donnant donc le même avantage qu’après son but refusé trois minutes plus tôt.
Concentré de controverses et d’émotions, le penalty est donc depuis 120 ans un élément phare des matchs de football. Du traumatisme (comment oublier celui sifflé à la dernière minute pour Manchester United en huitième de finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes en mai 2019), au running gag (« Penalty pour Lyon »), tout fan de foot a un souvenir particulier lié à cette action. Face à sa rationalisation à l’extrême tant par les nouvelles règles que par la VAR, la renaissance du coup franc indirect dans la surface permettrait de réintroduire une échelle de sévérité face aux fautes, et aux footballeurs de jouer sans penser à tout prix à le provoquer. Redonnant au penalty sa place à part au sein des actions d’un match de football.
Contre Attaque, épisode 3 l Les Terrao de Cima, terrains de foot et hauts lieux de la vie sociale et culturelle de São Paulo