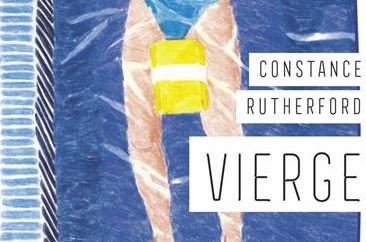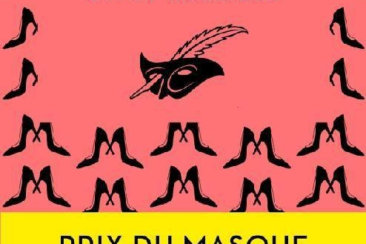En février 2020, à travers une photo postée sur Instagram et un hashtag lancé avec trois autres femmes sur Twitter, Illana Weizman libère la parole autour du post-partum. Plus que jamais déterminée à briser le tabou qui entoure la période qui suit l’accouchement, la Franco-Israélienne publie son premier livre, Ceci est notre post-partum. Et tant pis si elle bouscule, elle a l’habitude.

Pantalon de jogging, large pull-over, assise en tailleur sur son lit, une tasse de verveine-menthe à la main, des photos de son fils Dov – bientôt 3 ans – accrochées au mur derrière elle. Lorsqu’Illana Weizman allume la caméra de son smartphone pour répondre à nos questions depuis Tel-Aviv, où elle réside depuis dix ans, on est surprise par la tranquillité de la scène. Il faut dire que les dernières publications sur les réseaux sociaux de la doctorante en communication et sociologie empruntent plus au champ lexical de l’anxiété qu’à celui de la décontraction.
L’objet de son stress ? Dans quelques jours, elle se rend en région parisienne, où elle est née, a grandi et a étudié la communication, le droit puis la socio avant de rejoindre Israël pour un stage de cinéma et de s’y installer définitivement. Elle retourne souvent – hors année confinée – en France, le pays étant au cœur de sa thèse en cours d’écriture, « L’identité des Juifs français dans le monde digital : une cartographie de Facebook et un cas d’étude de deux groupes ». Mais cette fois, la visite aura une saveur différente. Illana Weizman rentre au bercail pour la promo de son premier livre, Ceci est notre post-partum.
En couche sur Instagram
À 36 ans, la Franco-Israélienne s’intéresse aux douleurs physiques et psychologiques post-accouchement, qui peuvent durer des mois, voire des années. Une phase « plus invisible que la face cachée de la Lune », alors que la période déboucherait sur une dépression pour près d’une mère sur cinq. Dans son manifeste, émaillé d’analyses d’expert·es, d’études scientifiques et de témoignages, Illana Weizman pose les bases. Le post-partum, c’est quoi ? Parce que aujourd’hui la définition ne semble claire ni pour les femmes, ni pour les professionnel·les de santé, ni pour les pouvoirs publics. De quoi[…]