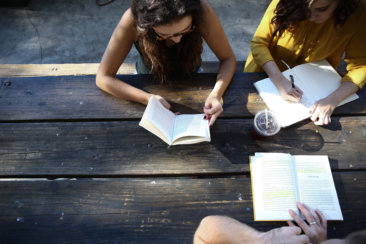Devenue en quelques années une figure du féminisme et de la lutte contre les violences, l’artiste et militante a coréalisé Quand tu seras grand, au cinéma ce 26 avril. Cette incursion auprès du troisième âge dans un Ehpad témoigne d’une crise du soin et alerte sur la négligence dans la prise en charge de nos aîné·es. Un nouveau combat à son actif.

Danseuse de formation, la Bretonne de 43 ans a émergé en 2014 auprès du grand public avec sa pièce Les Chatouilles ou la danse de la colère, adaptée au cinéma en 2018. Elle y rejouait les viols perpétrés par un ami de ses parents et qu’elle a subis, enfant. Après avoir souffert d’amnésie traumatique jusqu’à ses 17 ans, elle porte plainte à 22 ans et, à l’issue d’un procès aux assises, son agresseur est envoyé en prison. Inlassable battante, la réalisatrice et autrice monte régulièrement au créneau quand il s’agit de violences faites aux femmes et aux enfants, quitte à agacer. À l’occasion de son nouveau film Quand tu seras grand, qui orchestre la rencontre improbable entre résident·es décrépit·es d’une maison de retraite et élèves en surchauffe d’un collège voisin en mal de cantine scolaire, elle revient pour Causette sur un nouveau sujet d’indignation pour elle, désormais au cœur de l’actualité : la situation dans les Ehpad.
Causette : Comment avez-vous travaillé pour dépeindre dans le film des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) si proches de la réalité ?
Andréa Bescond : On est allés voir dans des Ehpad, mais on s’est surtout documentés en lisant beaucoup, en visionnant des reportages et des témoignages sur les réseaux sociaux et sur YouTube.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la situation dans les Ehpad ? Qu’est-ce qui vous a particulièrement alertée ?
A. B. : Avec Éric [Métayer, conjoint et coréalisateur, ndlr], c’est tout simplement parce qu’une membre de notre famille a été placée en maison de retraite et qu’on y va régulièrement. Honnêtement, là où notre proche est placée, c’est quand même un chouette Ehpad, avec des personnes très très investies, ce qui n’est pas le cas partout. On a constaté, surtout, la joie que générait à chaque fois l’arrivée de nos enfants dans les chambres et les couloirs. Alors, pour- quoi ne pas faire un huis clos dans un Ehpad ? On a donc eu l’idée de mélanger les générations pour mettre en exergue la beauté, la richesse humaine : parmi les trois générations montrées dans le film, deux sont un peu abandonnées, l’enfance et la vieillesse. Et puis, au centre, il y a tous les adultes que nous sommes, qui nous débattons avec cette société-là. Et c’est ça qui nous a interpellés, évidemment. Ensuite, il y a eu le Covid.
Vous l’aviez déjà écrit, à ce moment-là ?
A. B. : Oui, c’était un long processus. Cette crise sanitaire nous a permis de nous interroger : on a ressenti une forme de déception sur la solidarité humaine. Sans que ça soit trop gnan-gnan, on a eu envie de montrer que, si les gens et les générations se regardent, s’écoutent un peu, ça fonctionne quand même vachement mieux, l’humanité. Et le but, c’était d’essayer de créer un film qui mette en avant tout le spectre humain et une forme de générosité, mais sans éviter les sujets que sont le chagrin, la maladie, la mort. Et surtout, que se passe-t-il dans les Ehpad, quels sont les problèmes d’effectifs et les conditions de travail ? Il est évident que pour nous, c’était aussi un endroit pour mettre en avant toute la défaillance autour de ce système.

Quelles sont, selon vous, les grandes problématiques liées à ces établissements en France ?
A. B. : Ben c’est toujours pareil, hein : le capitalisme, ce n’est pas un secret... ! Les repas servis coûtent 1 euro, mais quand on voit le coût de ces pensions, ce n’est pas possible qu’autant de bénéfices soient faits sur l’humain et surtout sur la vulnérabilité de l’être humain.
Le journaliste Victor Castanet a publié en janvier 2022 Les Fossoyeurs sur le leader mondial des Ehpad, Orpea, dénonçant la maltraitance des personnes âgées et l’opacité de la gestion de ce groupe. L’avez-vous lu ?
A. B. : Oui, on l’a lu après le tournage. On a lu, on sait. On sait à quel point tout ce système est défaillant, à quel point, malheureusement, priment le côté privé, l’argent, les bénéfices. C’est compliqué d’accepter le fait que nos anciens soient des machines à fric.
Pensez-vous que cette enquête suffira à faire évoluer la situation ?
A. B. : On espère toujours... Disons qu’on est mieux informés, c’est déjà ça. Mais j’ai rencontré tellement de déception dans les sujets que je défends que je n’attends pas grand-chose au niveau politique : j’ai l’impression qu’on est dans une société en plein déclin social, une fin de système où nos dirigeants politiques n’ont pas en tête le bien- être des citoyens. Ça laisse la société politique indifférente, alors que c’est leur rôle, on les a élus pour ça ! Nous, citoyens, il faudrait aussi qu’on soit beaucoup plus impliqués dans le respect de nos droits. C’est une question de mobilisation, mais on a tellement de sujets qui nous tombent sur la gueule, entre l’inceste, l’accueil des anciens, le climat, le racisme, l’homophobie, la transphobie, que c’est très dur.
Dans un monde idéal, comment s’occuperait-on mieux de nos vieux et nos vieilles et de la question de ce qu’on appelle la dépendance ?
A. B. : C’est une question de mentalité et d’humanité : il faut avoir un regard bienveillant sur les êtres humains. Or, on a un regard méprisant, méprisable. Le respect de la dignité, c’est quand même la base. Il faut également obliger ces entreprises à être moins cupides.
Le gouvernement a annoncé un plus grand nombre de contrôles dans les maisons de retraite, ainsi qu’une plateforme de signalements en ligne. Pourtant, Victor Castanet critique l’inaction de l’État depuis le scandale et la Défenseure des droits a déclaré que ces mesures ne suffisaient pas et qu’il fallait embaucher plus de personnel...
A. B. : Oui, c’est du vent. Ça ne sert à rien de faire des contrôles si on n’a pas les effectifs suffisants, si les soignants ne sont pas payés correctement, s’ils n’ont pas le bon matériel, ou s’il n’y a qu’une couche par jour par résident. Dans le film, nous avons pris le parti de ne pas parler de la maltraitance voulue, consciente. Par contre, nous traitons de cette maltraitance involontaire causée par le manque d’effectifs et de moyens.
Emmanuel Macron promet une loi « grand âge » depuis 2018, en a reparlé en 2020, avant d’abandonner l’idée. La « grande cause nationale 2023 » du grand âge et de l’autonomie en est au stade de la proposition de loi, avec des mesures concrètes annoncées avant la fin de l’année...
A. B. : Le problème est que les lois sont rarement appliquées. Et ce n’est pas la loi qui va faire qu’on va bien traiter nos anciens. Ce qui est pathétique, c’est que politiquement, on est dans la répression (des contrôles, des lois) au lieu de se consacrer à la prévention, aux moyens donnés en amont et à la considération pour les gens. Cela n’a pas de sens.
Comment percevez-vous le rapport occidental à la vieillesse, à la fin de vie, par rapport à des modes de vie plus ancestraux et communautaires ?A. B. : On est dans un système qui valorise énormément le travail et le temps passé au travail. Quand on bosse 8 ou 10 heures par jour, on n’a pas le temps pour ses enfants ou les anciens. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit – d’ailleurs, nous aussi avons placé notre grand-mère en maison de retraite. On n’avait pas le choix, en fait. Ma tante va souvent la voir et elle est très entourée, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Mais honnêtement, c’est carrément philosophique. C’est une souffrance quotidienne pour moi : je ne comprends pas qu’on ne dégage pas des budgets pour nos anciens ou nos enfants. Je ne comprends pas ce monde.
Connaissez-vous des initiatives, comme dans le film, qui rapprochent des jeunes et des personnes âgées ?
A. B. : Avant le confinement, c’était vraiment en développement. Après, ça s’est arrêté, forcément. Et visiblement, ça reprend. Mais bon, c’est loin d’être la solution. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à traiter avant.

Votre premier roman, Une simple histoire de famille (Albin Michel), est sorti en janvier : depuis quand avez-vous envie d’écrire de la fiction ?
A. B. : Mon prof de 6e disait, en me rendant mes rédacs : « Bescond, vous écrirez des livres. » Moi, j’étais à fond dans la danse, mais j’ai toujours aimé écrire, inventer, créer, jouer avec les mots. Je ne dirais pas que j’ai toujours eu cette ambition d’écrire un roman, mais je me disais que peut-être, un jour, je le ferais.
Était-il facile de s’autoriser à écrire ?
A. B. : Le principal, c’était de me sentir légitime, de me donner le droit de pouvoir le faire en me disant que ce ne serait pas ridicule. C’est mon éditrice qui m’a donné confiance. Il y a quelques années, quand elle a vu Les Chatouilles, elle m’a parlé du texte : « Vous écrirez un roman, c’est sûr, vous pouvez le faire. » Elle me l’a proposé en 2016. Et puis j’ai mis du temps, car je jouais six fois par semaine et j’avais deux enfants en bas âge. J’ai commencé à lui parler de questions transgénérationnelles et, dans les semaines qui ont suivi, mon père m’a annoncé que ma propre arrière- grand-mère s’était défendue de son mari violent. Je me suis dit, tout ça a du sens, fonce ! Puis le confinement m’a beaucoup aidée, je me suis installée et j’ai écrit.
Qu’est-il arrivé à cette femme ?
A.B.: On ne sait pas trop... On sait qu’elle s’est défendue et qu’elle a été internée.
Comme votre film, le roman tisse un dialogue entre plusieurs générations, à travers trois personnages appartenant à la même famille. Qu’est-ce qui se transmet, exactement : la fatalité, la violence du trauma, un déterminisme familial ?
A. B. : Je crois que tout se transmet, de la plus négative à la plus positive des émotions. Par exemple, Éric et moi, en tant que parents, on a cassé le fil de nos propres traumas et donc il y a comme une nouvelle frontière avec nos enfants : je les sens tellement plus libres que nous à leur âge. Moi, j’ai mis quarante ans à me dire que je pouvais parler et que c’était normal qu’on m’écoute... ! Chez nous, on rit beaucoup et je vois à quel point ça s’est transmis chez nos mômes, qui sont toujours en train de se marrer.
À propos d’enfance : vous avez émis des suggestions concernant l’école et la prévention des violences sexuelles. Concrètement, que faut-il mettre en place ?
A. B. : Déjà, je serais d’avis qu’on ait un vrai ministère contre les violences. Avec des budgets alloués. Ensuite, concernant la prévention à l’école, il faudrait une matière consacrée à la question des violences, avec un programme et un prof qui fasse cours une à deux heures par semaine. Je sais que c’est très utopique, mais je pense que ce serait la clé d’une société bien plus ancrée dans le bien- être, plutôt que de laisser des enfants être totalement traumatisés. On parle de 18 enfants violés toutes les heures. Une fois qu’on est violé, on est violé. On est détruit. Même si, oui, on peut travailler sur soi, il faut quand même partir du principe qu’on aura toute notre vie des conséquences psychotraumatiques, que ce soit les addictions, la drogue, l’alcool, ou encore les violences qu’on peut reproduire ou s’infliger à soi-même. Enfin voilà, rien ne va.
Quant à l’après, il va falloir à un moment donné régler cette histoire d’impunité des agresseurs, ou au moins essayer d’empêcher les enfants d’être violés ou maltraités. Pour cela, il faut rentrer dans les familles et c’est à l’Éducation nationale de le faire. Sur l’in- ceste, la pédocriminalité, il faudrait des flashs info, des campagnes, ça devrait être partout, comme on l’a fait pour la sécurité routière. Quand tu rentres dans ta voiture aujourd’hui, tu mets ta ceinture, c’est un réflexe. Là, c’est pareil, il faut attaquer. On est la pre- mière génération d’adultes à connaître les chiffres. Avant, nos parents, nos arrière-grands-parents pouvaient tou- jours dire : « On ne sait pas. » Mais nous, on sait. Donc, qu’est-ce qu’on attend ?
Justement, en février, une proposition de loi sur les violences intrafamiliales a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale : elle prévoit la suspension automatique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour agression incestueuse, crime sur l’enfant ou sur l’autre parent. Elle prévoit aussi une suspension temporaire en cas de poursuites, en attendant qu’il y ait un jugement : les détracteur·rices de la loi en appellent à la présomption d’innocence. Qu’en pensez-vous ?
A. B. : Moi, je pense que c’est du vent, cette loi. Comme on condamne 0,6 % des violeurs, ça va concerner 0,6 % des pères incestueux. Le problème est d’abord qu’on ne les condamne pas. Donc tout ça permet de communiquer autour d’une loi qui a coûté zéro euro à l’État, ça ne sert à rien.
Le délai de prescription pour viol sur mineur·e est de trente ans à compter de la majorité : du côté du droit, on entend que la récolte de preuves est de plus en plus difficile avec le temps. Vous êtes pour l’imprescriptibilité. Pourquoi ?
A. B. : De toute façon, dans un viol, il y a souvent peu de preuves, alors je trouve cet argument un peu facile. Je suis pour l’imprescriptibilité parce que, malheureusement, 4 victimes sur 10 de viol dans l’enfance sont aussi victimes d’amnésie traumatique. On peut se réveiller au bout de cinq ans, dix ans... Un jour, on a un stimuli et tout réapparaît, donc à partir du moment où on a dépassé la prescription, c’est terrible. J’entends les gens de droit qui disent que la prescription, c’est pour préserver la paix sociale, mais, moi, je ne conçois pas qu’on puisse autoriser un violeur à avoir le droit à l’oubli et que la victime soit condamnée à perpétuité. Car nous, c’est à vie.
Dans Le Parisien, vous avez traité Emmanuel Macron de « mytho » soulignant l’inaction politique pour protéger les enfants, cause qui devrait a priori faire consensus.
A. B. : Il y a toujours d’autres priorités. Et puis les enfants ne votent pas. En vrai, je ne sais pas. Chacun assure être engagé dans la lutte contre les violences, mais quand, concrètement ? La loi Billon*, c’est vraiment de la merde, c’est hallucinant. C’est-à-dire que dès le début des enquêtes, la plupart des affaires de viol sont déqualifiées en agression, ou bien elles sont classées sans suite, dans 75 % des cas. Quelques cas isolés font la Une des journaux, mais c’est dérisoire.
Aujourd’hui, on ne parle plus de pédophilie, mais de pédocriminalité : il y a eu Le Consentement de Vanessa Springora, La Familia Grande, de Camille Kouchner1... Au-delà de la sémantique, qu’est-ce qui a changé dans l’appréhension de ces crimes ?
A. B. : Ce qui a changé, c’est vraiment la connaissance de la société civile : ça bouge dans les entreprises, sur les tournages... Mais politiquement, c’est le néant. Alors qu’Emmanuel Macron a eu toutes les opportunités : il a eu #MeToo et #MeTooInceste, un phénomène inédit qui n’existe que chez nous, avec des milliers de témoignages sur Twitter. Mais pour ça, il faut avoir envie d’aller chercher la thune.
Lorsque vous avez commencé à jouer Les Chatouilles, comment parlait-on de ces questions-là ?
A. B. : Quand je fais ma première au Festival d’Avignon en juillet 2014, j’ai l’impression d’être la seule à avoir été violée dans l’enfance. Personne n’en parle. Personne. Je joue d’abord 250 dates sans dire que c’est mon histoire. En 2016, seulement, je dis que c’est moi. Puis de plus en plus de gens viennent me voir pour me dire « C’est mon histoire, en fait ». Et au fur et à mesure, ça gonfle. Et je me dis, « Mais combien on est ? »Et puis après, bon bah ça explose. La suite, on la connaît.
À quel moment avez-vous décidé de porter une parole publique sur ce sujet-là et d’entrer dans le militantisme ?
A. B. : Disons que ça s’est imposé. Le vrai déclic, c’est quand je jouais à Strasbourg, en 2016 ou 2017. Un monsieur qui travaille au Conseil de l’Europe vient me voir et il me donne un énorme dossier : « Andréa Bescond, vous commencez à être une porte-parole sur les violences. On en a besoin. Prenez ça, je vous en supplie. » Je commence à lire dans le train ce travail du Conseil de l’Europe et je tombe des nues en lisant qu’un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. C’est quoi ce truc ? Je commence à suffoquer. Cela s’est imposé parce que, quand j’ai vu les chiffres, j’ai cru que j’allais crever et je me suis dit, ben vas-y, t’as pas le choix, tu vas faire quoi ? Et c’est là que je lance un appel sur les réseaux sociaux avec #StopPrescription et que le chiffre de « un sur cinq » commence à rentrer dans l’inconscient collectif. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas juste vivre ma vie de réalisatrice et basta. Donc tous les jours, je communique avec des gens, des victimes, qui m’écrivent sur les réseaux sociaux. J’ai 10, 50, 100 messages, tellement que je n’arrive pas à tous les lire.
Justement, quel usage faites-vous des réseaux sociaux, où vous êtes très active ?
A. B. : Depuis septembre 2022, je me suis engagée à faire un post « noir » par jour sur Instagram – il n’y a pas à chercher bien longtemps pour trouver un sujet. Je voudrais aussi monter un petit média vidéo, car si on parle enfin des féminicides, ce dont on ne parle pas, c’est de toutes les femmes qui ont été victimes d’une tentative de féminicide et dont la vie est gâchée à jamais.
Craignez-vous le burn-out militant ?
A.B. : Je l’ai un peu vécu après la loi Billon. J’étais vraiment, vraiment, très, très déçue, très en colère. Vidée. Là, aujourd’hui, ça va beaucoup mieux.
Subissez-vous du cyberharcèlement, comme beaucoup de femmes
et de féministes sur Internet ?
A. B. : Des gars viennent me parler, mais je reste assez pédagogue ou je me moque gentiment d’eux. Étonnamment, ça va, hormis la plainte pour diffamation dont je fais l’objet de la part d’un homme accusé d’agression sexuelle et qui a vu sa plainte classée sans suite : j’ai relayé sur les réseaux l’information, parue dans les médias, sur sa garde à vue, et il m’a attaquée [Au moment où ce journal est imprimé, le procès doit se tenir en mars]. Mais cela ne m’intimide pas, je n’ai pas peur.
Quand vous avez fait Les Chatouilles, le féminisme était-il déjà un enjeu pour vous ?
A.B. : Non ! C’est ça qui est ouf. Heureusement qu’il y a eu les féministes. À l’époque, moi je débarquais, je refusais même un peu ce discours, de peur de vexer les mecs. Mes amies, chez [le collectif féministe] #NousToutes, notamment Madeline Da Silva [cofondatrice de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles] ou Muriel Salmona [psychiatre] ont beaucoup contribué à me réveiller : elles m’ont dit, « Regarde les chiffres. » Tu regardes les chiffres et tu ne peux pas faire autrement que te dire qu’il y a un problème avec le genre masculin.
Au sujet de la violence masculine, vous militez pour des « maisons d’auteurs » pour hommes violents. De quoi s’agit-il ?
A. B. : Le principe existe déjà un peu en France, mais il n’est encore pas du tout développé. Il s’agit de réunir ces hommes-là, de les empêcher de sortir (c’est donc un autre statut que la prison), de les suivre et de revenir à la racine de leur violence. Qu’est-ce qui fait qu’ils sont comme ça ? Car on ne naît pas violent. Je n’arrive pas trop à saisir qu’on se voile la face et qu’on prenne ça comme une fatalité : « Ça va, on ne va pas empêcher les hommes de tuer les femmes. » Bah si, en fait !
Quels sont vos projets ?
A. B. : Je vais réaliser l’adaptation de mon roman au cinéma. Je tourne également ce printemps une série, Nudes, pour Amazon Prime, le remake d’une série norvégienne sur le revenge porn, avec les réalisatrices Lucie Borleteau et Sylvie Verheyde. Nous avons aussi terminé l’écriture de notre prochain film, avec Éric [Métayer], sur une jeune fille qui se perd sur les réseaux sociaux.
- Loi d’avril 2021 qui élargit les infractions sexuelles visant les mineur·es. Cette loi tire son origine de diverses affaires de pédocriminalité, dont l’affaire Duhamel révélée par Camille Kouchner dans son livre La Familia grande (Seuil) début 2021.[↩]