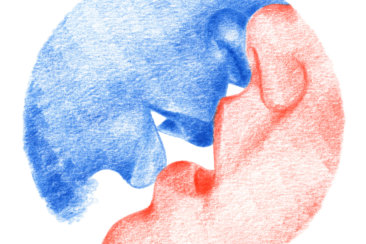Elle irradie tellement sur les planches de la Scala à Paris dans la peau de Gisèle Halimi que la pièce Une farouche liberté, adaptée du dernier entretien que la mythique avocate a donné avant sa mort, est prolongée jusqu’en avril. Ariane Ascaride y incarne une figure dont les engagements résonnent en elle, « femme de gauche », répète-t-elle : défendre les femmes, les pauvres, les victimes de la colonisation. Des combats que l’actrice mène depuis toujours, sans fin, épuisants, mais heureux !
Causette : Quel lien entreteniez-vous avec la figure de Gisèle Halimi avant de l’interpréter ?
Ariane Ascaride : Je n’avais pas d’attachement particulier à elle parce que je pense que Gisèle Halimi a tout fait pour passer pour une grande bourgeoise. Les cheveux, la manière de parler… elle a tout adapté. Cela demande un travail incroyable ! Moi, j’avais l’accent du Sud. Je n’ai pas eu ce truc de vouloir passer pour une bourgeoise. Ça tient peut-être à mon physique. Elle, elle était grande, fine, élégante. Moi, je suis partie dans un autre sens. Mais c’est quelque chose qui me touche profondément parce que je connais, je comprends.
Quelle part de l’engagement de Gisèle Halimi admirez-vous le plus ?
A. A. : Ce qu’elle a fait dans le cadre de la guerre d’Algérie. On ne mesure pas ce que son engagement voulait dire. Elle était d’un courage incroyable. Quand tu penses que dans les années 1960, elle défendait des membres du Front de libération nationale (FLN) ! On la traitait de « pute à bicot ». Comme on l’entend dire pendant le spectacle, elle a voulu être avocate pour SE défendre d’abord. Elle dit qu’elle va se battre avec les mots. Elle décide de défendre une jeune femme, Djamila Boupacha 1, pour lui éviter la peine de mort. Gisèle Halimi part au combat non seulement enétantunefemme–orilyatrèspeu d’avocates pendant la guerre d’Algérie –, mais en ayant aussi des enfants petits. Elle joue sa vie pour elle ! Car pour ça, elle se retrouve en prison et court le risque d’être fusillée par les Français. Elle qui adore la France, la littérature française, la loi française… Je pense que c’est précisément parce qu’elle a vécu ça qu’elle a pu, ensuite, faire le procès de Bobigny en 1972. Elle n’a pas eu peur parce que l’Algérie lui a donné la force pour se faire cracher dessus, se faire traiter de pute, de monstre, de salope. À Bobigny, il y avait les filles : Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig. En Algérie, il n’y avait personne.
« Il est fondamental de désobéir. »
Quand la loi n’est pas respectable, Gisèle Halimi ne la respecte pas. C’est pourquoi elle a d’ailleurs eu du mal à prêter serment, à jurer qu’elle honorerait les tribunaux… Aujourd’hui, à quoi faut-il désobéir ?
A. A. : Il est fondamental de désobéir. Mais il ne faut pas désobéir n’importe comment. Il ne s’agit pas de chercher à être original. La vraie désobéissance est une désobéissance politique, idéologique. Au départ, pour Gisèle Halimi, c’est même une désobéissance sensible. Elle ne comprend pas, enfant, pourquoi il faut se taire quand on est une fille. C’est un truc que je comprends très bien. Si tu subis le quotidien, c’est parce que tu ne l’as pas ouvert à un moment donné. Si tout le monde se met à parler, on n’a plus besoin de courage parce qu’on devient vachement plus nombreux que ceux qui se taisent.

©Thomas O'brien
Philippine Pierre-Brossolette, qui incarne Gisèle Halimi en duo avec vous, est à l’origine de cette pièce. Comment s’est développée votre collaboration ?
A. A. : Si j’ai fait ce spectacle avec elle, c’est parce qu’on est liées par un moment de vie et de mort très fort survenu dans notre entourage, que je ne développerai pas. Quand Philippine m’a proposé de jouer la pièce avec elle, je pense que j’ai accepté pour ça. C’est mon côté napolitain : la vie passe avant tout ! Au début, Philippine avait une compréhension très intellectuelle de la pièce. Il fallait qu’ensemble, nous arrivions à ne surtout pas « historiciser » la chose. Je suis exigeante. Des fois même, un peu pète-sec. C’est un grand défaut. Mais on y est arrivées. J’adore la regarder jouer.
« Pour que toute femme entre au Panthéon, il faut se mobiliser, car cela amène une résistance »
Le gouvernement n’a pas répondu à la demande populaire qui souhaitait panthéoniser Gisèle Halimi. Comment le vivez-vous ?
A. A. : Il faut se mettre en colère. On entend sans cesse « elle était une formidable avocate ». Mais de là à la mettre au Panthéon, je pense qu’il y a encore une grande distance. De toute façon, pour que toute femme entre au Panthéon, il faut se mobiliser, car cela amène une résistance. C’était une grande gueule, Gisèle… Il y a des tas de milieux dans lesquels ça ne passe pas. C’est pour ça qu’il ne faut jamais arrêter le travail sur les consciences.
Lire aussi I 50 ans du procès de Bobigny : la Seine-Saint-Denis rend « femmage » à Gisèle Halimi
Vous dites partager une culture familiale avec Gisèle Halimi. Sa famille était tunisienne, votre père italien et votre mère provençale. Toutes deux, petites, vous avez dû apporter le café au lit à vos frères… On vous refusait le droit de regarder par la fenêtre. On a refusé à Gisèle Halimi le droit d’étudier : elle a dû trouver une bourse elle-même. Et vous avez toutes deux réussi avec brio, et dû gérer votre succès. Comment s’émancipe-t-on de ce schéma patriarcal ?
A. A. : J’ai été chanceuse d’avoir ce caractère-là. J’étais une fille un peu ratée : ce qu’on appelle un « garçon manqué ». Quand mes parents m’ont fait couper les cheveux et qu’on me prenait pour un « minot » dans la rue, la vie était tellement mieux, j’étais libre ! D’un coup, tu peux courir, grimper aux arbres. Ça s’est joué comme ça. Puis, la suite, Gisèle Halimi la résume. Elle explique que le combat est une dynamique. Si on arrête, on dégringole. La lutte, c’est du lundi au lundi. C’est l’endurance du coureur de fond. J’ai beaucoup de respect pour elle car elle n’a jamais cessé de parler. C’est très, très, très fatigant. Moi, on me dit souvent « c’est formidable, continuez à parler ». OK, mais qui vient avec moi ? Il y a Corinne Masiero. Elle et moi, on n’est pas élégantes, pas bourgeoises et on parle dans un métier où 95 % de la population est bourgeoise. Quand je parle pour faire bouger les lignes, on me dit que j’agresse, alors que je ne fais que parler ! J’ai juste envie de dire : je vous en supplie, c’est dur, mais c’est tellement plus heureux, le combat !
« Je suis la fille d’une femme qui n’a rien pu réaliser de ce dont elle avait pu rêver. »
La pièce débute en évoquant l’un des traumatismes de la vie de Gisèle Halimi : son non-lien avec sa mère, qui ne l’a pas aimée. Quel était votre rapport avec la vôtre ? On connaît plutôt votre rapport avec votre père…
A. A. : Mon père était séduisant, mais vraiment infernal. Il avait un rapport à moi très aimant, mais en pointillé. Ma mère, elle, se tapait tout. Et je pense que j’ai beaucoup pris ma mère en charge. Dans le Sud des années 1960, une femme, ça n’allait pas au cinéma toute seule, ni au café seule. Je suis la fille d’une femme qui n’a rien pu réaliser de ce dont elle avait pu rêver. Ma mère était une très bonne élève qu’on a mise au travail à 15 ans parce que son père – un vrai personnage anarcho-syndicaliste – mettait en grève chaque endroit où il allait travailler et finissait donc viré. Elle était très forte. Elle s’est mariée avec un mec qu’elle aimait comme une folle, qui la trompait royalement. Elle a vécu dix ans dans une maison oùelle faisait à manger midi et soir à cet homme qui ne lui parlait pas, tout en travaillant comme une malade. Mais elle n’a jamais trouvé d’amant. Ça n’était pas possible. Parce que c’est dans les milieux populaires que l’idéologie pèse le plus. Qu’est-ce que mon père me disait quand j’étais petite fille ? « Ta virginité, c’est ton honneur. Parce qu’on n’a rien. Tu n’as que ça. » Ma mère, son honneur, c’était de ne pas être une femme avec des amants.
Vous-même, quelle mère avez-vous été pour vos deux filles ?
A. A. : J’ai été une mère exigeante. Je pense que je les ai fait chier. Sur l’école notamment. Mais c’est bien car elles se sont bien défendues. Il y avait des valeurs avec lesquelles il ne fallait pas rigoler.
« Mes filles, elles ne lâchent rien. Elles en arrivent à dire que ça n’est pas possible de vivre avec un homme. »
Lesquelles ?
A. A. : L’Autre. L’Autre existe. L’Autre est important. On ne vit pas seul. Si tu tombes face à un con, évidemment, tu l’envoies chier, mais au départ, jamais de mépris. Jamais de cynisme. Le cynisme, c’est mourir.
Partagez-vous la même vision du féminisme que vos filles ?
A. A. : Quand on arrive à mon âge, on fait plus facilement des compromis. J’ai tendance à répéter que pour les garçons, c’est difficile. Je pense qu’ils ne comprennent rien de ce qui leur arrive ! Parce qu’on leur a mal raconté ce qu’on a vécu dans les années 1970. Parce que, entre Gisèle Halimi et maintenant, il y a eu un trou où le discours féministe était un féminisme de comptoir, un truc mondain ou un peu institutionnel. Mes filles, elles ne lâchent rien. Elles en arrivent à dire que ça n’est pas possible de vivre avec un homme. Ils sont « immatures ». C’est le mot que j’entends tout le temps. Et c’est vrai.
« Je suis persuadée que c’est en partant des petites choses qu’on peut transformer la société petit à petit et que ça va aider les mecs, aussi, à la fin. »
Vous, que voudriez-vous dire aux hommes ?
A. A. : Il faut qu’ils fassent des efforts, mais ça n’est pas en leur gueulant dessus qu’ils vont en faire. Il faut un discours construit. Sinon c’est comme dire à un enfant « range ta chambre ». Au bout de trois jours, il va refoutre du bordel ! Il faut leur expliquer ce qu’on t’injecte dans la tête dès la petite enfance : le fait qu’une petite fille doit faire ses devoirs et aider sa maman et faire ceci et faire cela en même temps. Bref, même si ce n’est pas une expression que j’affectionne particulièrement : la charge mentale.
N’est-ce pas un poids de plus sur les épaules des femmes ?
A. A. : L’engagement, soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Je n’ai pas à juger ton choix. Mais si tu le prends, il ne faut jamais s’attendre à ce qu’on te dise merci.
Comment est née votre conscience féministe et comment la définiriez-vous ?
A. A. : Dans le spectacle, Gisèle Halimi dit que quand elle était petite, elle ressentait une immense perplexité face à la différence de traitement entre elle et les garçons, notamment ses frères. Que ça ne faisait pas sens. Eh bien voilà, c’est tout !
« Peut-être que les gens ont une facilité à m’aborder justement parce que je ne suis pas inatteignable, pas un canon de beauté, pas évanescente. »
Gisèle Halimi est en quelque sorte l’une des premières féministes intersectionnelles à croiser différentes luttes – décoloniale, féministe – dans ses combats. Vous reconnaissez-vous dans cette conception des choses ? A. A. : Complètement. Je suis persuadée que c’est en partant des petites choses – en défendant le cas d’UNE femme, comme elle l’a fait avec Djamila Boupacha – qu’on peut transformer la société petit à petit et que ça va aider les mecs, aussi, à la fin. C’est comme cette élue chez les Insoumis, Rachel Keke [députée du Val-de-Marne élue en 2022, ndlr], qui était femme de ménage. On dit, « elle s’exprime pas bien ». Vous savez combien de temps elle a fait grève, cette femme 2 ? Tout ce qu’elle se prend dans la tronche ? Il faut être costaud ! Et en plus, elle a la responsabilité d’être un symbole. Elle n’a pas le droit au faux pas, alors que c’est nécessaire, pour respirer.
Quel est le plus grand obstacle que vous avez eu à enjamber tout
au long de votre parcours de vie ?
A. A. : Moi-même. Je ne correspondais à aucun canon du métier que j’ai choisi. Je n’avais pas le physique qui allait. J’ai une grande gueule. Pendant vingt ans, avant Marius et Jeannette [pour lequel elle a reçu le César de la meilleure actrice en 1998], on m’a dit que j’étais atypique. Il y a un immense metteur en scène dont je tairai le nom, qui m’a dit des choses extraordinaires le jour de l’audition. Je n’ai pas travaillé avec lui parce que son assistant m’a rappelée, en me disant que je n’étais pas « son fantasme sexuel ». Je suis restée dans mon canapé deux mois, en boule. Voilà ce que c’est, être refusée en tant que personne. C’est en travaillant comme une malade et grâce au public, qui est venu dans les salles, que j’ai pu me sortir de ça. Peut-être que les gens ont une facilité à m’aborder justement parce que je ne suis pas inatteignable, pas un canon de beauté, pas évanescente. Mais ça n’est pas quelque chose que j’ai décidé.
« Au début du cinéma, il y avait déjà des filles, hein ! »
Comment avez-vous vécu #MeToo : comme une révolution dans le milieu du cinéma ou comme un échec ?
A. A. : Comme d’habitude, ça a fait « boum!»puis«plouf…».Vous en entendez parler du mouvement #MeToo dans le cinéma français en ce moment, vous ? Non ! OK, les choses ont un peu bougé. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le mouvement #MeToo qui ait changé les choses. C’est le fait qu’il y a, depuis une vingtaine d’années, beaucoup de réalisatrices. Pour une grande partie, elles ont modifié l’image des personnages féminins à l’intérieur des films. À l’intérieur des équipes aussi, ça évolue. Avant, les filles, elles étaient coiffeuses, maquilleuses, scriptes et habilleuses. Cet été, j’ai fait un film avec des filles machinos, électros… ça n’est plus la même ambiance !
Lire aussi I 50 ans du procès de Bobigny : pour l’avocate Khadija Azougach, « c’était #MeToo avant #MeToo »
Qui sont les pionnières auxquelles vous pensez ?
A. A. : Céline Sciamma, Dominique Cabrera, Claire Denis, Jane Campion… Mais j’en oublie. Je suis nulle en noms. Au début du cinéma, il y avait déjà des filles, hein ! Je pense à une femme géniale dans les années cinquante : Ida Lupino, qui a fait des films magnifiques aux États-Unis. Qui le sait, ça ?
« 0n est plus intelligent à plusieurs que tout seul »
Vous dites avoir grandi au son des chœurs de l’Armée rouge. Votre conscience politique vient-elle de là ?
A. A. : J’ai été élevée en entendant que « l’Union soviétique, c’est génial ». Ces chœurs de l’Armée rouge me faisaient vibrer. C’est fait pour ça, c’est martial, engageant. Mais ça rappelle une chose : on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et l’obligation de faire gaffe à l’autre. Pourquoi l’autre serait-il toujours un ennemi ? C’est fondamental pour moi. Quand je serai morte, je veux que les gens disent « c’était une femme de gauche ». Je vais dire un truc qui va vous faire sauter en l’air : c’est tellement beau, les idées communistes. Il faut relire la poésie de Pier Paolo Pasolini. On n’a jamais vécu le communisme et on n’est pas près de le vivre, mais ça vaut le coup de continuer à croire à cette idée. Il faut continuer à être utopiste.
On comprend pourquoi vous avez chanté un chant communiste lorsque vous avez reçu le prix d’interprétation de la Mostra de Venise pour Gloria Mundi, en 2019…
A. A. : C’était à la conférence de presse. J’ai chanté l’hymne du Parti communiste italien : Bandiera Rossa. Ça a jeté un froid dans la salle… ! J’ai vu tous les journalistes se gélifier.
« On est en train de s’habituer à ce qu’il y ait des gens qui meurent en mer. »
Vous avez dédié ce prix aux migrants morts en mer, « ceux qui vivent pour l’éternité au fond de la Méditerranée ». En 2023, qu’avez-vous envie de dire ?
A. A. : Comme dit Simone de Beauvoir, ce qu’il y a de plus scandaleux dans le scandale, c’est qu’on s’y habitue. On est en train de s’habituer à ce qu’il y ait des gens qui meurent en mer. Voilà. Ce soir, je vais lire des textes pour SOS Méditerranée. C’est difficile pour eux aussi ! Quand un bateau comme l’Ocean Viking reste en mer pendant trois semaines [en novembre], qu’il finit par être accueilli à Toulon, hop, immédiatement, on entend des horreurs. Personne ne mesure ce que c’est que de partir. Il faut arrêter les zemmouriens et les autres, parce qu’avec le réchauffement climatique, les gens vont encore plus crever, donc évidemment qu’ils vont venir. C’est là que l’humanité, par moments, me rend folle.
Comment la marraine du Secours populaire que vous êtes, et l’habitante de Seine-Saint-Denis – département souvent qualifié de « plus pauvre de France » – que vous êtes également, intègre-t-elle la lutte contre les inégalités à sa vie ?
A. A. : Je n’intègre pas ces combats à ma vie. Ils la composent. Laissez-moi vous raconter un truc. Pendant le confinement, j’ai été très malade. Covid puis pneumonie. Mon toubib m’a dit de ne pas bouger. Je ne pouvais donc pas faire les banques alimentaires du Secours populaire. À la place, ils m’ont donné une liste de numéros de téléphone de personnes âgées. J’appelais les gens pour demander comment ça allait. Je faisais ça tous les après-midi. C’est l’une des plus grandes leçons que j’ai reçues de ma vie. C’était EUX qui me remontaient le moral ! Les personnes âgées sont nettement plus dynamiques que ce qu’on croit. Elles ont énormément – mais énormément – de choses à raconter et à nous apprendre. Elles t’aident à faire la part des choses. On n’avait pas de masque, rien, ils me disaient « ben oui, je vais aller faire les courses, que voulez-vous ma p’tite dame, il faut bien manger. Bon et sinon, vous, comment allez-vous ? » Je ne remercierai jamais assez le Secours populaire de m’avoir permis de faire ça.
« Moi, quand je suis arrivée à Paris en tant que jeune fille au pair dans le VII arrondissement, j’ai eu peur : y’avait que des Blancs et des bourgeois ! Je ne comprenais rien. »
Marseille apparaît comme la ville de votre vie, notamment parce qu’elle est mixte, contrairement à Paris. Cette mixité vous semble-t-elle en danger ?
A. A. : J’espère que non. Parce que le centre-ville de Marseille est habité par une population pauvre. C’est la seule ville de France où c’est comme ça. Et où on essaie par tous les moyens de les faire partir. Moi, quand je suis arrivée à Paris en tant que jeune fille au pair dans le VII arrondissement, j’ai eu peur : y’avait que des Blancs et des bourgeois ! Je ne comprenais rien.
L’un des combats importants pour vous est le soutien à l’Arménie. Comment êtes-vous tombée amoureuse de ce pays et quel message voudriez-vous passer à son sujet ?
A. A. : C’est un tout petit pays qui n’a rien : pas de matière première, rien. La première fois, je ne voulais absolument pas y aller. Je l’ai fait car une association avait rénové un cinéma et faisait une rétrospective des films de Robert [Guédiguian, son mari]. C’était il y a vingt ans. Je suis tombée amoureuse de ce pays parce qu’il y avait de la mélancolie. Et la manière dont les Arméniens nous ont reçus m’a bouleversée. En ce moment, il y a cette guerre avec l’Azerbaïdjan [les deux pays sont en conflit depuis 2020]. Ils n’ont rien pour se défendre. Pas de chaussures. Ce sont les mômes qui meurent. Ils font des trous dans la montagne comme en 14–18. Les autres, eux, ont des drones. Et ils sont sous influence de la Turquie, qui veut que les Arméniens disparaissent… Donc nous, on envoie des chaussures, des gilets pare-balles…
« Il faut être sincère : la célébrité m’a aidée à dire non. »
Avec quel qualificatif préféreriez-vous que l’on vous désigne : résistante, féministe, engagée ?
A. A. : Citoyenne. Parce que ça englobe tout ça. Quand t’es citoyenne, t’es engagée, tu résistes à des choses, et effectivement tu résistes au fait qu’on emmerde les filles. La cité, elle est à toi. Faut jamais l’oublier. On passe son temps à nous faire croire que c’est pas vrai.
Quelles autres femmes auriez-vous envie de célébrer à l’avenir ?
A. A. : Germaine Tillion. Elle est incroyable. Imaginez : elle a 22 ans. Elle s’en va en Algérie toute seule en tant qu’ethnologue-anthropologue. Elle y vit presque deux ans [de 1934 à 1936] avec des bergers. Ensuite, elle devient résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se retrouve à Ravensbrück. Et là, elle écrit une opérette à partir des poèmes et scènes de Molière qu’elle connaissait par cœur et, comme elle voit tout le monde dépérir, elle la fait jouer à ses camarades de bloc, à l’intérieur du camp de concentration. Elle raconte leur quotidien sur des airs d’opérette qu’on connaît. Elle a vécu jusqu’à 100 ans. Pendant des années, je me disais, il faut que j’aille sonner à sa porte. Je n’ai jamais osé.
Et vous, avez-vous toujours su dire non ?
A. A. : Absolument pas. C’est mon paradoxe : j’affirme des tas de trucs, mais il m’est difficile de dire non. Il faut être sincère : la célébrité m’a aidée à dire non. Parce que d’un coup, j’avais la reconnaissance. Beaucoup de gens ont ce problème de reconnaissance.
Gisèle Halimi. Une farouche liberté, mise en scène de Léna Paugam, avec Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette. À la Scala (Paris X ) jusqu’au 21 décembre les mardis et mercredis à 19 h 30, du 15 janvier au 2 avril le dimanche à 18 h 30. À la Scala Provence-Avignon en juillet lors du Festival d’Avignon.
1. Djamila Boupacha est une militante du FLN arrêtée en 1960 pour une tentative d’attentat à Alger, torturée et violée par des militaires français pour obtenir ses aveux.
2. La grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles (Paris) a duré 22 mois (2019−2021).