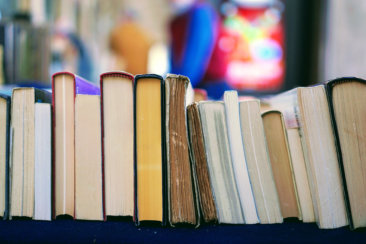Le 12 mai, l’actrice américaine Alyssa Milano invitait les femmes à entamer une « grève du sexe ». En réponse aux lois anti-IVG –récemment votées en Alabama, en Géorgie et au Missouri– très commentées et critiquées jusque dans les hautes sphères de l’État… français. « Faire la grève du sexe, c’est aussi se priver soi-même », rétorquait notre secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Alors, doit-on, comme d’autres femmes avant nous dans l’Histoire, mettre nos corps au service d’une cause politique ?
Camille Froidevaux-Metterie
Professeure de science politique
« Cette proposition de “grève du sexe” me pose problème parce qu’elle réduit les femmes à leur corps et, ce faisant, elle perpétue l’assignation sexiste des femmes à leur génitalité. Elle restaure le lien entre sexualité et procréation, qui est précisément le lien que l’avortement a permis de défaire. Par ailleurs, cette proposition laisse entendre que, si certaines femmes tombent enceintes, c’est nécessairement dans le cadre d’une relation sexuelle consentie. Cela entretient l’idée que les femmes sont responsables des grossesses non désirées, mais surtout, cela invisibilise le fait que l’IVG peut être consécutive à un viol. Et puis, enfin, l’idée renvoie à une représentation très hétéronormée de la sexualité, soit une sexualité à visée reproductive, à[…]