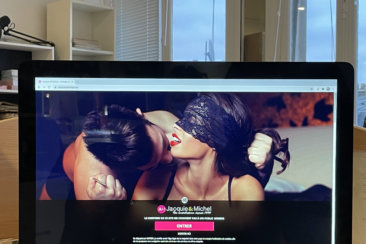Onze millions de Français·es, dont 58 % de femmes, s’occupent d’un·e proche malade ou handicapé·e. À l’occasion de la Journée nationale des aidant·es, ce 6 octobre, Causette a proposé à ses lecteur·trices en situation d’aidant·e une carte blanche pour raconter ce qu’ils vivent et souhaitent partager. Surmenage, manque d’aide extérieure, souffrance de voir son proche s’amoindrir, culpabilité de penser à soi… Les histoires racontées ici montrent à quel point le statut d’aidant·e relève d’un quasi-sacrifice, même s’il est bien sûr ponctué de petits bonheurs, quand l’enfant, le ( grand-) parent ou le·la conjoint·e dont on s’occupe semble apaisé·e.
« Elle retrouve ses chères
disparues à travers moi »
Annick, 63ans,
s’occupe de sa mère, 89 ans
« Mon travail ? Veiller à tout… à hauteur de trois jours et quatre nuits par semaine passés à m’occuper de ma mère. Le reste du temps, une aide à domicile prend le relai. J’ai cessé mon activité professionnelle plus tôt que prévu.
Ma mère voudrait tout gérer, mais elle n’en a plus les capacités. Il n’y a pas eu de réel diagnostic, mais ses troubles neuro-dégénératifs évoquent bien sûr Alzheimer. Je pallie en douce : éviter les manques… ça va du rouleau de papier toilette au pot de confiture pour les biscottes du petit déjeuner. Préparer les vêtements, faire couler l’eau de la douche pour qu’elle n’ait pas froid.
J’anticipe, mais ne lui enlève pas les activités qu’elle peut toujours accomplir : se savonner certaines parties du corps, essuyer la vaisselle, rentrer le linge sec, nettoyer la table, réunir les paires de chaussettes et les plier, repasser quelques torchons, faire son lit, attacher son tablier dans le dos, se coiffer, éplucher les carottes ou les pommes de terre… Par-ti-ci-per, c’est essentiel ! Essentiel pour sa propre estime d’elle-même, essentiel pour se sentir utile et vivante. Car, souvent, l’angoisse est palpable, le vide, la perte des repères, la confusion. Son obsession : le travail.
« Il faut que j’aille au bureau ! » Je la contredisais, maintenant, je la conforte. Et puis il y a les moments où elle multiplie les « merci, merci ». Je ne suis plus sa fille, je suis sa mère, ou sa sœur aînée qu’elle croit toujours en vie… Elle retrouve ses chères disparues à travers moi. Si mon père n’est pas encore rentré, c’est qu’il est parti jouer aux boules. Pourtant, mon père n’a jamais pris le temps de le faire de son vivant. C’est ma façon de créer un univers rassurant pour ma mère : mes affabulations s’ajoutent aux siennes et son monde reprend vie ! »
« On s’octroie des temps de balade, mais il n’est pas possible de partir en vacances ou même un week-end sans elle »
Sophie et Thierri, 67 et 69 ans, s’occupent de leur fille, 29 ans, atteinte de polyhandicap
« Mon petit fil à la patte ! C’est le surnom affectueux que je donne à notre cadette, Bertille. Elle aura 30 ans en novembre, mais elle est toujours une petite fille à mes yeux. D’ailleurs, elle a encore la candeur de l’adolescence.
J’ai très tôt compris qu’il y avait un problème. Bébé, elle était moins vive que ses sœurs et son frère. Après quelques examens à Paris, nous avons appris qu’elle était atteinte d’une anomalie chromosomique rare. Nous avons vécu au Maroc, puis en 2000, nous nous sommes installés à Hongkong pour dix ans. Ces circonstances de vie en expatriation m’ont naturellement amenée à être mère au foyer. Ce qui m’a permis aussi de m’occuper pleinement de notre fille, avec le soutien permanent de ma famille. À l’étranger, nous avons reçu des aides précieuses et un vrai accompagnement pour Bertille. Elle avait une « seconde maman » philippine extrêmement dévouée !
Depuis notre retour au Pilat, nous avons des auxiliaires de vie grâce au conseil régional, quatre jours par semaine de 10 à 19 heures. Le quota d’heures est calculé en fonction de la gravité de la pathologie. Il faut tout faire pour et avec elle, sauf manger. Nous préparons son assiette mais elle sait s’alimenter. Nous partageons ce temps d’accompagnement avec mon mari, de façon parfaitement équilibrée. Un véritable travail d’équipe, d’autant que nos autres enfants se montrent aussi présents et investis, en particulier notre fils qui a dix-huit mois de plus que Bertille. On s’octroie des temps de balade, mais il n’est pas possible de partir en vacances ou même un week-end sans elle. Le plus difficile ? Certainement le manque de liberté, et aussi la fatigue, à la fois physique et mentale. Thierri et moi-même avons eu la Covid fin août. Du coup, les auxiliaires de vie ont suspendu leurs visites. Nous étions à la fois malades et en pleine charge de Bertille, un épisode plutôt compliqué et épuisant.
Nous cherchons un établissement d’accueil permanent dans notre région pour que notre fille accède à une forme d’autonomie. Elle est très sociable et aime être entourée. Nous ne sommes pas éternels, on pense à son avenir ! Pour l’instant, elle est sur liste d’attente, et nous attendons patiemment une réponse d’un organisme de qualité. »
Lire aussi : Aidant·es : un congé désormais rémunéré, mais toujours pas de répit
« Placer mon père en Ephad a été très douloureux, mais en restant aidante, je mettais en péril ma vie de famille »
Céline, 35 ans, s’occupe de son père, 60 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer
« Il y a quelques années, j’ai remarqué que mon papa avait quelques soucis de mémoire. Au début, avec sa conjointe de l’époque, nous avons mis ça sur le compte d’une dépression.
Nous avons fini par consulter et les médecins nous ont parlé de « maladie dégénérative ». J’ai senti ce jour-là qu’on voulait nous préparer à quelque chose sans le nommer. Un an après, alors que mon père n’avait que 58 ans, le verdict tombe : c’est la maladie d’Alzheimer.
Les premiers temps, c’est sa compagne qui s’occupe de lui. Elle me fait part plusieurs fois de ses difficultés à gérer la situation, car mon père est dans le déni et se met facilement en colère. Elle suivra une formation auprès de l’association France Alzheimer, inadaptée à notre situation. En cas de déclaration précoce de cette maladie, les patients sont moins bien encadrés que les patients plus âgés, avec lesquels le corps médical et associatif a plus d’expérience. Quelque temps plus tard, la conjointe de Papa a décidé de partir. Commence alors pour moi un saut dans le vide… Mes filles, à cette époque, ont seulement 1 et 4 ans. J’ai décidé de réduire mon activité professionnelle à 80 % et ce congé me sert surtout à m’occuper de mon père.
Lorsque je l’ai installé dans son nouvel appartement afin de le rapprocher de moi, beaucoup de personnes ont cru que je n’y arriverai pas, qu’il fallait le placer. J’ai donc mis en place des infirmières, des aides à domicile, je l’ai accompagné à tous ses rendez-vous médicaux. Je suis devenue sa référence et il voulait que je sois présente constamment.
Mon papa a été accueilli au bout de deux ans en centre d’accueil de jour et ce fut un soulagement au quotidien. Je suis partie en vacances, mais j’ai pleuré pendant deux jours à l’idée de l’avoir laissé.
Aujourd’hui, il est en Ephad. Ce choix a été très douloureux, mais je mettais en péril ma vie de famille. Son état s’est dégradé très vite.
Cette maladie a complètement chamboulé nos vies, a désuni une partie de ma fratrie et j’ai perdu tant d’énergie dans cet accompagnement. »
« La vie de petite-fille au foyer ressemble beaucoup à celle de jeune mère au foyer »
Elsa, 25 ans, s’occupe de sa grand-mère, 94 ans
« Au début de l’année, alors que j’étais partie à l’étranger depuis un an et demi, j’ai décidé de rentrer et de m’installer chez ma mamie. Mes parents m’avaient avertie : « Elle perd de plus en plus la tête. » Une décision plutôt bien inspirée, puisque les mesures de confinement se mettaient en place et j’ai pu profiter de ma famille, car nous sommes tous voisins, et de la forêt alentours pour de belles promenades.
La vie de petite-fille au foyer ressemble beaucoup à celle de jeune mère au foyer : faire la cuisine, les lessives, changer les couches, parlementer afin de sortir se promener et expliquer l'importance de l’hygiène. À une différence près : contrairement à l’enfant qui fait des progrès chaque jour, j’observe, de mois en mois, le déclin des capacités de ma grand-mère. Chaque combat est à recommencer et est de plus en plus difficile à remporter. Le quotidien est devenu difficile, mais ma cousine s’est proposée pour prendre le relai au mois d’août. J’ai eu de la chance de partir en vacances avec mes amis. Je suis revenue reboostée et je le suis toujours ! »
« Après neuf mois d’accompagnement de mon conjoint, mon état psychique s’altère progressivement et mon énergie n’est plus au rendez-vous »
Sophie, 42 ans, s’occupe de son mari François, 63 ans, atteint d’un cancer
« Depuis décembre de l’année dernière, j’ai vu mon mari amaigri, épuisé. J’ai pris rendez-vous chez des spécialistes, retardés par la crise du Covid. Verdict : cancer du rectum, prostate, ganglions … Bingo !
Entre l’annonce aux enfants, à la famille, aux amis, aux collègues pour qu’on arrête de me dire "Alors qu’est-ce qu’il a ?”, j'ai choisi de jouer carte sur table, en nommant les choses simplement.
Après neuf mois d’accompagnement de mon conjoint, mon état psychique s’altère progressivement et mon énergie n’est plus au rendez-vous. Les traitements lourds changent les gens et, au risque de paraître déplacée, j’ai l'impression de vivre avec l’ombre de mon amoureux. François a une chimio tous les quinze jours et rentre le soir même à domicile. Mes nuits sont rythmées par l’angoisse.
Je continue pourtant de travailler, mes collègues sont bienveillants. En revanche, ma chef de service me met la pression, me prend la tête dès qu’elle le peut, ça n’aide pas …
Les gens peuvent être parfois maladroits … J’ai fait face à des réflexions surprenantes : « Tiens, mais tu souris, ton mec n’est pas très malade ? », « Et ton mari, il va mieux ? ». Ça part d’un bon sentiment, mais j’ai envie de répondre : « Mais ouais, super, il fait 40 kilos, il est jaunâtre, il pète le feu, vive la chimio ! »
Quant à mon quotidien, il a réellement changé. J’attends vivement de trouver une aide-ménagère, et la Ligue contre le cancer, que j’ai contacté récemment, propose des solutions. Mais en milieu rural, tout est plus compliqué. Je m’octroie une soirée entre copines tous les quinze jours. Ce n’est pas assez pour décompresser… Je rêve secrètement d’aller faire un tour à la Burning Man, même si l’avenir reste incertain. »
« Enfant unique et très proche de mes parents, j’ai vu nos liens changer »
Manon, 25 ans, s’occupe de sa mère, 53 ans, victime d’une hémorragie cérébrale
« Malade, en situation de handicap, accidentée par la vie, dépendante : les dénominations que je dois employer pour parler de ma mère me mettent toujours mal à l’aise. En 2017, une hémorragie cérébrale due à une malformation dans le cerveau l’a plongée dans le coma, puis a entraîné une hospitalisation d’une année entière. Dans le couloir de la Salpêtrière, j’attendais avec crainte et appréhension la fin des soins : va-t-elle-me regarder ? Cligner des yeux pour communiquer ? Pourra-elle un jour marcher, manger ? Mais surtout son rire, unique et communicatif, pourrai-je le réentendre à nouveau ? L’angoisse permanente te coupe du monde, c’est à ce moment-là que je suis devenue spectatrice de ce qui m’entourait avec l’impression de ne plus appartenir à une société qui continue tout simplement de vivre. Heureusement, nous sommes deux, avec mon père. Soutenus et aimés, à chaque instant par nos proches. Ces moments d’errance dans le système hospitalier n'ont fait que conforter ce pour quoi on se battait dans la famille depuis des années : assister, impuissants, à la souffrance quotidienne du personnel de santé, de toutes ces femmes soumises à un rythme de travail effarant et à des conditions de travail des plus précaires.
Après la peur, l’espoir est venu nous rendre l’existence plus légère : les premières paroles, les premières cuillères d'eau gélifiée, le premier pas dans le centre de rééducation.
Nous avons dû apprendre à vivre autrement. Enfant unique et très proche de mes parents, j’ai vu nos liens changer, s’inverser. Je suis devenue « la fille courageuse ». Ce rôle est usant plus les années passent, mais il me rend fière, d’elle, de lui et de moi aussi. Mon master en sciences politiques m’a amenée à me questionner sur notre société où la norme reste la validité et où les déficiences en matière de santé, transports et culture sont grandissantes.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble avec mes parents. Je voulais pouvoir m’investir au maximum auprès de ma mère. Nous alternons nos activités, temps de travail et de déplacements avec la présence des auxiliaires de vie. J’ai fait une demande pour être dorénavant complètement en télétravail. Les soirs, lorsque mon père rentre du travail, je sors souvent, et les moments passés tous les trois sont toujours chaleureux malgré les tensions exacerbées par notre situation. Comme dans toute famille au final ! »
« L’année dernière, pour recruter un accompagnement scolaire pour notre fille handicapée, nous avons dû nous en remettre à la justice »
Alice, 32 ans, s’occupe de sa fille, 5 ans, atteinte du syndrome de Rett
« Nos problématiques concernent la rééducation et la scolarisation d’Apolline. Sa maladie ne touche quasiment que les filles et provoque un polyhandicap. Les petites filles atteintes se développent normalement jusqu’à 12–18 mois, puis ont une phase de régression pendant laquelle elles perdent des facultés motrices. La maladie affecte leur capacité à marcher, parler, respirer et manger. Elles comprennent tout, mais sont bloquées dans leur corps, à cause de l’apraxie, un trouble du mouvement qui les empêche de bouger volontairement.

Si on met en place une rééducation adaptée, les filles sont capables de beaucoup de progrès : apprendre à marcher, courir, nager, sauter, lire, écrire. Le planning d’Apolline comprend de la kiné ou du sport tous les jours, de l’équithérapie, pour muscler le tronc, de la musicothérapie pour travailler la communication et du travail à table avec une orthophoniste et un éducateur spécialisé avec un logiciel de commande oculaire avec écran tactile. Être avec ses pairs, des enfants neurotypiques du même âge, est aussi essentiel pour ces enfants. Sans rééducation constante, les filles régressent.
Or, en France, la rééducation proposée dans les centres est insuffisante, faute de moyens. Nous avons tout organisé en libéral. Et mon mari a arrêté de travailler pendant un an et demi pour emmener notre fille à tous ses rendez-vous.
Depuis l’an dernier, Apolline va à l’école et nous avons l’espoir et l’ambition de mettre en place un beau projet : son établissement vient de proposer le prêt d’une petite pièce pour les professionnels de santé afin qu’ils puissent faire leurs séances à l’école. Cela permettrait à Apolline d’aller à l'école le matin et de repartir le soir comme tous les enfants de son âge, et toute la famille retrouverait une vie normale. C’est le rêve de la vraie école inclusive. Grâce à cette organisation et pour la première fois, l’enfant en situation de polyhandicap ne serait pas exclu de l’école après 6 ans. Nous attendons actuellement la mise en œuvre de cette proposition.
Cette année, Apolline a une AESH – accompagnant·e des élèves en situation de handicap – et a pu effectuer sa rentrée de septembre. Son AESH est formidable, nous sommes ravis !
L’an dernier, le parcours a été plus chaotique : nous devions avoir une AESH après les vacances de la Toussaint. L’enseignante référente handicap nous a alors appelés pour nous dire qu’elle n’arrivait pas à recruter et qu’elle n'avait aucune visibilité. Nous avons décidé de porter l’affaire devant le tribunal de Nice, le droit à l'éducation étant fondamental et Apolline étant privée d'école sans AESH. Nous avons obtenu une AESH quarante-huit heures plus tard. C’est très dommage et injuste que le système fonctionne ainsi, beaucoup de parents baissent les bras.
Octobre est le mois de sensibilisation au syndrome de Rett, et nous espérons vivement faire bouger les lignes. Il faut que l’État s’engage auprès des enfants en situation de handicap, finance la rééducation et autorise les professionnels de santé à exercer à l’école pour que les enfants évitent de nombreux déplacements. »