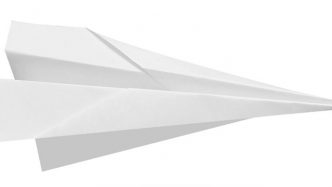Pour la journée mondiale des donneurs du sang (JMDS) ce mardi 14 juin, Causette s’est rendu dans une maison du don de l’Etablissement Français du Sang. L’occasion de rencontrer les donneur·ses et d’alerter quant aux difficultés de les mobiliser depuis les deux dernières années.
A la maison du don Crozatier dans le 12ème arrondissement de Paris, vingt rendez-vous sont prévus au total pour la matinée. A côté de l’accueil, les quelques donneur·ses présent·es remplissent leur fiche médicale avant de passer un entretien avec un·e médecin pour déterminer s’iels respectent toutes les conditions. 11 heures, et dans le centre de don, on s’active : la Journée mondiale des donneurs du sang a lieu le lendemain, le 14 juin. L’occasion pour le président de l’Etablissement Français du Sang, François Toujas, d'appeler les Français·es à venir sacrifier un peu de leur temps pour offrir leur sang avant la période estivale. Mais aussi de remercier les donneur·es et les bénévoles pour leur participation et leur fidélité, tout en rappelant l’engagement principal de l’EFS : aider à sauver un million de patient·es par an. « Les produits dérivés du sang utilisés pour les malades sont irremplaçables. Si nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas les soigner », souligne Hervé Meinrad, directeur des collectes et de la production de l’EFS présent ce jour-là.
Lire aussi l Don du sang : fin de la période d'abstinence pour les hommes gays et bis
Un rappel de l’ambition de l’EFS plus que nécessaire. « Nous rencontrons beaucoup de difficultés à recruter des donneurs, car le don du sang, c’est aussi le don du temps. Le Covid a induit un changement structurel qui a mis à mal notre capacité à attirer les donneurs et le personnel soignant. Les gens ont beaucoup changé d’habitude et prennent sans doute moins le temps de venir. » Une tendance qui peine à s’améliorer. L’Etablissement Français du Sang nécessite 10 000 dons par jour pour avoir les stocks de sang nécessaires aux traitements des malades. Sauf que depuis deux ans, les stocks fluctuent de manière instable pour atteindre parfois seulement 9000 poches par jour. Depuis 2019, l’EFS reçoit 40 000 poches de sang de moins chaque année. Alors, l’objectif : « mener des campagnes de sensibilisation jusqu’au 12 juillet pour accueillir encore plus de donneurs et continuer de solliciter les fidèles, pour obtenir au moins 30 000 dons d’ici le début de l’été », indique le directeur des collectes.
« Nous travaillons en permanence sur l’attractivité de nos métiers, et nous menons des actions pour la revalorisation de ces emplois. »
Hervé Meinrad
Les difficultés à mobiliser
L’été représente un défi de taille, puisque les Français·es affluent encore moins durant les périodes de vacances. « Mais les malades, eux, ne sont pas en vacances », lance Hervé Meinrad. Même si l’EFS organise tous les étés des collectes de dons mobiles sur les plages et autres lieux de loisirs, les moyens mobilisés pour les collectes restent limités. « On peut mettre en place des campagnes de mobilisation d’urgence mais cela demande tellement de ressources déployées que l’on préfère vraiment ne pas en arriver là », confie le directeur. Pour cause, en plus des obstacles pour recruter les donneurs, l’EFS peine à embaucher du personnel soignant. « Nous travaillons en permanence sur l’attractivité de nos métiers, et nous menons des actions pour la revalorisation de ces emplois. Malgré tout, on a encore sur l'ensemble du territoire français 65 postes de médecin vacants, et 45 pour les infirmières », déplore Hervé Meinrad.
Malgré ces difficultés, Hervé Meinrad assure pourtant qu’aucun·e patient·e n’a manqué de poche de sang pendant les deux ans de Covid. Même si la situation a parfois été très tendue, les objectifs ont toujours été atteints.
Le processus est pourtant simple. Un simple questionnaire d’antécédents médicaux et d'informations à remplir, puis un court entretien avec un·e médecin, durant lequel la capacité à donner son sang est évaluée. L’on peut renoncer à tout moment, sans jugement. Le prélèvement de sang prend ensuite autour de quinze minutes, puis le ou la donneur·se patiente une vingtaine de minutes pour se rafraîchir, prendre une collation et vérifier que tout va bien avant de repartir. En tout, il faut compter au maximum une heure. « Et en plus, c’est une très petite aiguille qui ne fait pas mal du tout ! », assure le cadre de l’EFS.

Pour remobiliser les donneur·ses, tous les moyens sont bons : cibler les jeunes sur les réseaux sociaux via des campagnes de communication et des applications simplifiées à utiliser, proposer des collectes de dons dans des lieux de culture prestigieux comme le Musée d’Orsay – un partenariat avec le Centre des monuments nationaux doit démarrer en septembre -, élaborer des événements spéciaux : en novembre, la « semaine des sangs rares » vise par exemple à sensibiliser toutes les populations pour prendre conscience des spécificités des groupes sanguins peu fréquents.
Moins de donneur·ses en entreprise et dans les écoles
Un autre axe de travail, la reconquête des territoires de collecte en entreprise et dans le milieu de l’enseignement. Hervé Meinrad le reconnaît : « C’est l’équivalent de 175 000 dons de perdu en une année dans les universités et les entreprises. » Le retour des collectes dans ces lieux s’effectue progressivement, mais le télétravail reste un obstacle de taille. L’EFS mise aussi depuis 2020 sur la téléassistance médicale, des collectes sans médecin, que les infirmier·es habilité·es sur place peuvent contacter à tout moment à distance. Ces consultations en distanciel représentent désormais 20% des collectes, comme l’a annoncé le directeur lors de la conférence de presse organisée par l’EFS le 7 juin dernier.
« Je parle un peu des dons du sang autour de moi, mais ça ne convainc pas beaucoup. »
Valentin, donneur
Parmi les étudiant·es que le Covid n’a pas rebuté, il y a Valentin. Dans la salle dédiée aux donneur·es de la maison Crozatier, il est venu donner son plasma, le composant liquide du sang. Le jeune homme de 24 ans patiente confortablement 45 minutes, le temps que son plasma soit extrait. Mais pendant l’attente, pas le temps de s’ennuyer : « Quand je viens, je lis un article pour ma thèse, je regarde une série, ou je lis un livre… Le temps passe super vite, et en plus on est super bien accueilli ! », nous garantit le jeune homme allongé sur le lit d’hôpital. Véritable fidèle du centre de don, Valentin vient au moins quatre fois par an depuis le lycée. Pourquoi ? Tout simplement pour « contribuer à aider des gens, explique le futur chercheur en biologie. Comme je ne serai jamais en contact avec des malades dans mon métier, donner mon sang c’est ma façon à moi d’être un intermédiaire, de me rapprocher un peu d’eux. » Le jeune homme est un habitué des aiguilles, connaisseur du monde médical grâce à ses études de sciences. Il s’est toujours senti rassuré et très bien accompagné par les soignant·es. « Et puis ils donnent toujours à manger à la fin, c’est sympa ! »
Néanmoins, Valentin est lui-même conscient d’être un cas à part. Autour de lui, il reste l’un des seuls parmi ses proches à prendre le temps de donner son sang. « Certains de mes amis en biologie le font aussi, mais c’est parce qu’on connaît bien ce monde-là. J’en parle un peu autour de moi, mais ça ne convainc pas beaucoup. » Les pubs de l’EFS sur Facebook lui servent de petit rappel. « J’ai vu passer un post de l’EFS sur mes réseaux sociaux et je me suis dit “ah, c'est le moment d’y aller !” » Même s’il retourne au centre tous les trois mois, Valentin ne le perçoit pas comme un engagement envers l’EFS, mais bien comme un engagement envers lui-même. A la fin de notre discussion, Valentin se tourne vers sa série, le bras tendu, l’air tranquille. Il lui reste 30 minutes pour finir son épisode.