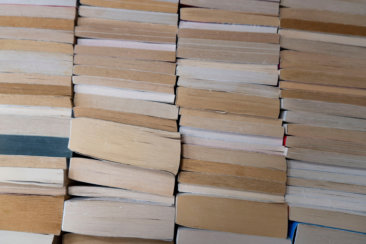Entretien avec Marcello Quintanilha, l’auteur brésilien qui a reçu le week-end passé le Fauve d’Or pour sa bande dessinée Écoute, jolie Márcia lors du festival d’Angoulême.

Dans le foyer des Regina Santos Lima, au coeur d'une favela brésilienne, on retrouve la mère, Márcia, infirmière qui se bat contre la fatalité, la fille, Jaqueline, mœurs légères et fréquentations lourdement armées et le beau-père, Aluísio, faux mou au vrai grand cœur. En filigranes derrière cette famille branlante que seul tient l’amour : Marcello Quintanilha. Le trio d’Écoute, jolie Márcia, ses couleurs explosives et dialogues truculents au service d’une intrigue déroulée sans accroche lui ont valu le Fauve d’Or 2022 lors du dernier festival de bande dessinée d’Angoulême. Rencontré dans un café parisien, le quinquagénaire brésilien au français fluide préfère garder son masque. Pas grave, ses yeux qui rient suffisent à témoigner de toute l’humanité qu’il insuffle à ses personnages, toujours ambivalents, jamais essentialisés.
Causette : Y a‑t-il une vraie Márcia à l’origine de cette histoire, dont vous vous seriez inspirée ?
Marcello Quintanilha : Pas vraiment. J’avais surtout envie, depuis très longtemps déjà, de faire une histoire sur l’amour maternel, sur une mère qui veut sauver sa fille et qui pour ça est prête à prendre des décisions radicales. Je crois beaucoup en le fait que l’amour nous permet de faire des choix très durs mais nécessaires. Ce n’est pas tant que la mienne a dû faire des choix extrêmes me concernant [rires] mais elle a inspiré en partie ce personnage par sa personnalité intransigeante. Et le visage de mon personnage est celui d’une amie, qui s’appelle Márcia elle aussi et que je ne peux voir sans que la chanson Écoute, jolie Márcia ne me vienne en tête.
"Ma mère n'a aucun sens critique me concernant : d’après elle, tout ce que je crée est la plus belle œuvre qu’un être humain ait jamais conçue dans l’histoire de l’humanité"
Quelle a été la réaction de votre mère, justement, quand elle a lu Écoute, jolie Márcia ?
M.Q. : Ma mère… Ma mère n'a aucun sens critique me concernant : d’après elle, tout ce que je crée est la plus belle œuvre qu’un être humain ait jamais conçue dans l’histoire de l’humanité. Maman, écoute ça n’est pas tout à fait vrai [rires]. Mais j’aime bien lui rendre hommage, d’ailleurs on la retrouve aussi à la fin de ma BD Les lumière de Niterói [qui retrace la vie du père de Marcello, ndlr].
Comment expliquez-vous la force de votre œuvre, ce qui vous a fait gagner le Fauve d’Or ?
M.Q. : Sans doute l’humanité des personnages. Mes histoires se passent au Brésil, dans la culture brésilienne, avec des personnages brésiliens… mais personne n’a besoin d’être Brésilien ou de connaître la société brésilienne pour se familiariser avec le récit. C’est cette universalité qui fait que ça fonctionne.
Bien que vous ayez quitté le Brésil il y a presque vingt ans, les favelas restent un thème récurrent dans vos albums. Vous abordez cette fois la question du point de vue des femmes qui y vivent, d’où vient cette obsession ?
M.Q. : Plus que la favela, c’est la question de la pauvreté au Brésil qui me colle à la peau : elle est d’une telle prédominance qu’aucun Brésilien ne peut fermer les yeux dessus. Et même si je ne suis pas retourné là-bas en créant Écoute, jolie Márcia à cause de la crise sanitaire, je n’ai qu’à plonger dans mon for intérieur pour recueillir, voir des choses de ce pays, parce que le Brésil est toujours avec moi, il m’a constitué comme être humain.
En fait, ce qui m’intéresse le plus c’est de travailler la façon dont mes personnages sont façonnés par le cadre sociétal, comment leurs conditions sociales les enveloppent et les limitent en même temps.
Les femmes particulièrement ?
M.Q. : Je crois que oui, les femmes sont toujours beaucoup plus sacrifiées que les hommes dans la société, de façon générale mais encore plus dans une société où l’État n’est pas présent. Parce que c’est ça, la réalité de la favela : l’absence béante de l’État, et les femmes qui se retrouvent à assumer son rôle.
Après, en ce qui concerne mon travail, je ne choisis pas de façon consciente le genre de mes personnages, l’histoire s’impose à moi. Mais je constate quand même que ça crée des réactions très différentes dans mon public. Par exemple, dans Talc de verre [sorti en 2016, ndlr], une série de lecteurs m’ont parlé de Rosalina [le personnage principal, dont on suit la descente aux enfers, ndlr], en me disant qu’elle était malade, folle, qu’on ne pouvait croire en ce personnage car elle se comporte comme aucune femme ne le ferait. Je trouve ça fabuleux que quelqu’un sache avec exactitude ce qu’est capable de faire ou non une femme. Rien que ça ! [rires] Et tous ceux qui m’ont dit ça… étaient des hommes. Aucune femme ne m’a jamais tenu un discours pareil. Au contraire, elles semblaient apprécier la complexité du personnage.
Et honnêtement, ça me gave de travailler avec ces histoires d’« univers féminin » ou d’« univers masculin » parce je ne sais pas comment une femme pense, je ne sais pas comment un homme pense.
"J’aime beaucoup qu’on sente dans mon travail l’influence de la technique, qu’elle soit perceptible. Ça vient d’une tradition de la peinture"
Dans vos précédents albums, vous utilisez des palettes de couleurs très différentes de ce qu’on retrouve ici. On passe du noir et blanc et des tonalités plutôt froides à des couleurs « carnavalesques » dans Écoute, jolie Marcia. Quel est l’effet que vous vouliez créer ?
M.Q. : J’avais envie de transmettre quelque chose de très spécifique : cette forme de déconnexion avec la réalité qu’il y a aujourd’hui au Brésil, au niveau politique précisément. C’est ce qui a permis l’élection de Bolsonaro et qui s’explique probablement par les crises du capitalisme et les révolutions numériques. C’est pour ça que j’ai choisi de ne pas faire correspondre les couleurs de l’histoire [ les peaux sont violettes, le ciel vert, etc., ndlr] aux couleurs du monde réel.
Et puis, ce rapport à la couleur vient aussi de mon évolution de parcours avec les outils numériques. J’aime beaucoup qu’on sente dans mon travail l’influence de la technique, qu’elle soit perceptible. Ça vient d’une tradition de la peinture, qu’on retrouve par exemple chez Vermeer mais aussi dans la bande-dessinée avec Roy Crane.
Vous avez parlé des couleurs, qui sont très différentes de ce qu’on constate dans vos précédents albums, mais le trait aussi a changé : il est simplifié, pourquoi ?
M.Q. : À nouveau, c’est parce que je voulais vraiment que la couleur soit l’acteur principal. Que le lecteur, quand il ouvre le livre, ressente une explosion de teintes. Le trait est plus discret, presque inexistant pour donner l’impression que j’ai « dessiné avec la couleur ».
Je suis autodidacte mais j’ai beaucoup d’influences qui viennent de la bande-dessiné, notamment franco-belge : Edgar P. Jacobs [créateur de Blake et Mortimer, ndlr] , Jean-Louis Floch [dessinateur de la série des Jacopo, ndlr], François Boucq [à l’origine des Aventures de Jérôme Moucherot, ndlr].
Et pourquoi cette ressemblance graphique entre Marcia et Jaqueline ?
M.Q. : C’est comme si Marcia se parlait à elle-même tout le temps. Elle se reconnaît dans sa fille : d’une certaine façon, elle lui rappelle un aspect enfoui de sa propre personnalité. Peut-être qu’elle veut se sauver elle-même à travers Jaqueline.
Écoute, jolie Márcia, de Marcello Quintanilha, aux éditions Çà et là, 128 pages, 22 euros.
Lire aussi l Grand Prix d'Angoulême : Julie Doucet, pure consécration de la ligne crade