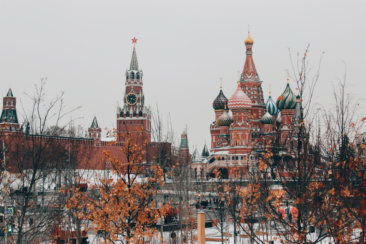Début mars, une femme victime d'un viol en 2016 a obtenu le droit d'euthanasie par un médecin et deux psychiatres en Belgique. Une question qui relance le débat sur la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles. Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, explique à Causette le parcours psychotraumatique des victimes.

« Je ne pouvais plus être avec ma famille. Je ne supportais plus que mon mari dorme avec moi, je ne supportais plus de manger à table avec eux. J'ai eu des crises de panique et d'anxiété, j'ai fini par avoir des pensées suicidaires et j'ai effectivement fait une tentative de suicide » a raconté Nathalie Huygens dans un entretien accordé au quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws, relayé et traduit par le site d'informations 7sur7. Cette femme, violée en 2016, a obtenu début mars le droit à l'euthanasie par un médecin et deux psychiatres. Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie a accepté d'expliquer à Causette le parcours psychotraumatique des victimes de violences, les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elle aborde également la question de l'euthanasie pour les victimes.
Causette : Quels sont les symptômes psychotraumatiques créés par les violences sexuelles chez les victimes ?
Muriel Salmona : Que ce soit à court ou à long terme, les violences sexuelles créent un état de stress traumatique, avec des mécanismes de survie qui s’installent dans la durée pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, suivant les cas. Le symptôme immédiat, c’est un état de sidération au moment des violences. Puis les victimes vont mettre en place des mécanismes de sauvegarde, dans lesquels le cerveau déconnecte les émotions, pour éviter un stress intense. Cette déconnexion, entraîne une dissociation, un état d'anesthésie émotionnelle. C'est-à-dire que les évènements n'ont pas d'existence réelle. Lorsque les victimes sont dans cet état de conscience modifiée, elles sont en incapacité de contrer des violences, sachant que, la plupart du temps, les violences sexuelles sont commises par des proches. En même temps que cette dissociation, se met en place une mémoire traumatique, c'est-à-dire que le circuit de la mémoire se déconnecte lui aussi. Mais dès qu'un lien peut s'établir avec ces violences, cette mémoire traumatique ressurgit, ainsi que les cris, les paroles, la haine, la détresse, la peur, la sensation de mourir, l'horreur ... Non seulement vous avez dû survivre à des violences extrêmes, mais en plus, vous devrez survivre aux conséquences de ces violences, qui font que vous les revivez continuellement.
Et quelles sont les conséquences des symptômes psychotraumatiques sur la vie sociale, professionnelle, familiale, et amoureuse ?
M. S. : Sur la santé mentale et physique, les conséquences sont très lourdes, avec un risque de suicide important. Les victimes avancent sur un terrain miné et ne voient pas comment elles pourront en sortir, ce qui les plonge dans des dépressions graves. L'immense majorité des victimes ont des troubles anxieux, des troubles du sommeil, et alimentaires, des troubles cognitifs importants et des troubles de la sexualité. Cela entraîne un stress perpétuel et des maladies qui y sont liées, comme des dysfonctionnements cardiovasculaires, immunitaires, endocriniens, digestifs. C'est un problème de santé publique majeur, reconnu par l'OMS. Et plus généralement, ce sont toutes les sphères de la vie qui sont touchées. Il y a un impact sur la scolarité, la profession, avec un risque de précarité, un risque de chômage accentué, un risque d'invalidité, de handicaps. La vie amoureuse, affective et sexuelle sont aussi particulièrement touchées à cause d'un manque de confiance en autrui.
À lire aussi I Enquête : dans le cadre de violences conjugales, des femmes internées abusivement par leur conjoint violent
Est-ce qu’il y a une conduite chronique qu’on retrouve chez toutes les victimes de violences sexuelles ?
M. S. : Le choix des stratégies est différent suivant les victimes. Il y a deux grandes stratégies. Toutes sont en situation plus ou moins d'hyper-vigilance et de contrôle à un moment ou à un autre, mais elles peuvent aussi privilégier des conduites qu'on appelle « dissociantes ». Pour éviter les phobies, les angoisses, tous ces contrôles permanents épuisants, les victimes peuvent avoir recours à des anesthésiants -l'alcool, la drogue- ou à des conduites à risque. Par exemple, elles se brûlent, elles se scarifient, ou ont des relations sexuelles dangereuses. Certaines victimes de violences sexuelles, notamment dans l'enfance, vont possiblement retourner ces violences, soit contre elles-mêmes, soit contre autrui. Les femmes, en général, seront plutôt violentes envers elles-mêmes et les hommes auront plutôt, en possession dominante, des conduites dissociantes qui s'exerceront contre autrui.
Combien de temps s’écoule entre le moment où les victimes subissent des violences et le moment où elles viennent consulter ?
M. S. : Il n'y a que 10% des personnes ayant subi un viol qui recevront les soins d'urgence nécessaires. Or, le viol est une urgence absolue. Les violences créent des atteintes neurologiques et neuro-endocrinologiques très importantes. Ce sont des blessures qui sont d'ailleurs visible sur les IRM. Il faut également prendre en compte le risque de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles. Donc 10%, c'est très faible. Pourtant, les victimes disent que le premier recours, lorsqu’elles ont subi une violence sexuelle, ce sont le médecin et le psychiatre. On sait qu'en moyenne, les victimes mettent entre 10 et 13 ans pour accéder à des soins spécialisés, d'après les dernières enquêtes. Alors qu'il faudrait que dès les premières violences, on agisse.
Est ce que le travail thérapeutique est le même lorsque la victime se présente immédiatement, ou après plusieurs années ?
M. S. : Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un continuum de violence, chez les femmes particulièrement. Une femme qui a subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance a un risque multiplié par 16 de subir des violences conjugales et des violences sexuelles à l'âge adulte. Donc plus on donne des soins efficaces tôt, plus on évite la reproduction de ces violences.
Qu’est-ce qu’une prise en charge médico-psychologique de qualité ?
M. S. : Il faut qu'elle soit précoce. Pour ça, il faut être très attentif à tous les symptômes, tous les signes qui peuvent surgir de la souffrance. Mais il faut aussi, même si on a l'impression qu'on ne voit rien, poser des questions. Il faut qu'il y ait ce dépistage systématique et universel, adapté à toutes les victimes, à leur âge, à leur handicap, à leur langue. Et après le dépistage, les victimes doivent recevoir une protection, une psychoéducation, qui est essentielle pour leur expliquer le principe de la mémoire traumatique. Cette protection doit être combinée à un traitement pour retrouver des liens, rechercher ce qui s'est passé et comprendre. Il faut aussi faire diminuer le stress et résoudre les problèmes de santé. Une bonne prise en charge est donc pluridisciplinaire.
Dans votre article « Les violences sexuelles : un psychotraumatisme majeur », vous écrivez que 79% des professionnel·les de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patient·es et leur état de santé, comment l'expliquez-vous ?
M. S. : Il y a le manque de formation, qui est effarant. Les formations pour les violences sexuelles n'existent pas du tout dans les facultés. Cela vient à la fois du déni au sujet des violences, dont bien entendu les femmes en sont les principales victimes, et au-delà du déni, l'existence d'une culture du viol qui met systématiquement en cause les victimes et utilise les symptômes psychotraumatiques pour les retourner contre elles. Comme dans la majorité des cas, aucun lien entre le comportement de la victime et ce qu’elle a subi n'est fait, les professionnels de santé mettent souvent les victimes sous des traitements inappropriés, dissociants qui aggravent les risques d'être, de nouveau, victime de violences. Non seulement on ne fait rien pour les victimes de violences sexuelles, mais en plus on les maltraite ! Aujourd'hui, on n'a aucune garantie que ces formations existeront un jour. Le milieu médical est hyper machiste et il s'agit d'un des milieux où il y a le plus de violences sexuelles.
À lire aussi I Le contrôle coercitif, cette notion qui pourrait révolutionner la lutte contre les violences conjugales
Vous écrivez aussi que les comportements des victimes sont jugés paradoxaux par les professionnel·les qui les prennent en charge ?
M. S. : On entend des questions inappropriées : « Pourquoi elle est restée ? » « Pourquoi elle est revenue ? » ... En fait, quand la victime part, elle est enfin protégée de l'agresseur, donc elle est moins dissociée et sa mémoire traumatique va l’envahir de façon très violente. Si personne n’est là pour lui expliquer ce qu’il se passe, elle peut avoir le sentiment que sa situation est pire qu'avant. Elle se persuade que c'était une erreur de partir. Et les professionnels de santé utilisent ce comportement paradoxal pour le retourner contre les victimes. On a inventé dans le passé des symptômes comme les troubles de la personnalité liés à leur sexe, la fameuse "hystérie féminine", qui n'était que la manifestation de troubles psychotraumatiques. Ces mauvais diagnostiques n'arrêteront pas tant qu'on n'aura pas déconstruit les inégalités, les stéréotypes sexistes, les représentations, toute la propagande anti-victimaire de culture du viol.
Que pensez-vous du droit d'euthanasie qui a été accordé à cette femme victime de viol en Belgique ?
M. S. : C'est absolument intolérable. Quelle est la garantie qu'elle ait eu une prise en charge avec des soins efficaces ? Aucune. Et tout ça, c'est décidé par des médecins qui ne sont pas formés. C'est inhumain. Derrière toute volonté de mort, il y a eu une volonté extérieure de destruction de la personne. Et c'est ça qu'il faut soigner.
Avez-vous déjà eu l'occasion de travailler avec des hommes auteurs de violences sexuelles ?
M. S. : Oui, avec de très jeunes ados et les résultats ont été très bons. Ils ont eu des prises de conscience de leur addiction à la violence, et également de leur capacité ensuite à ne plus exercer cette violence. Je n'exerce pas auprès d'adulte car je ne peux pas me retrouver face à de grands criminels. C'est un choix personnel pour me protéger. Quand ils sont jeunes, ils peuvent encore aspirer à une autre vie et je pense qu'il est important d'intervenir à ce moment là.
À lire aussi I Selon le ministère des Solidarités, le nombre de victimes de violences sexuelles en Ehpad pourrait être « monstrueux »