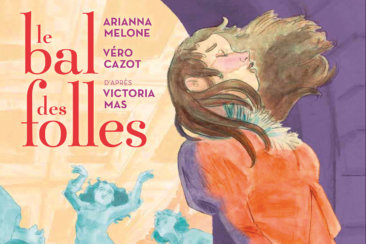Chaque mois, un·e auteur·e que Causette aime nous confie l’un de ses coups de cœur littéraires.

Assez compliquée, cette histoire de pépite. Rien que ces derniers temps, entre La Petite Lumière, d’Antonio Moresco, chez Verdier ; D’acier, de Silvia Avallone, chez Liana Levi ; Une histoire de France, de Joffrine Donnadieu, chez Gallimard ; Le Ghetto intérieur, de Santiago H. Amigorena, chez P.O.L, j’ai croulé sous les pépites. Mais non, râlait Causette, on veut du moins connu, du rarissime. J’ai dit je n’ai pas ça en magasin et j’ai raccroché.
Puis, je me suis souvenu. Ça s’appelait Retenir les bêtes. D’un certain Magnus Mills. Un Anglais. Ça ne racontait absolument rien, mais c’était pourtant le suspense des suspenses ! J’en suis resté scotché dans mon fauteuil jusqu’à sauter mon déjeuner et rater le dentiste. Paralysant, tant chaque page donnait envie de lire la suivante. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Ma matinée dévorée, j’ai perdu l’après-midi à écumer les librairies pour offrir ce chef‑d’œuvre à tous les amis, des fois qu’il disparaisse trop vite et qu’il n’en reste plus pour ma tribu…
Bon, voilà l’histoire. Elle sera approximative. Je préfère m’en tenir au souvenir de mes sensations plutôt que de vous servir un résumé pêché dans Wikipédia. Comme aurait dit Coluche, c’est l’histoire de trois mecs. Trois types au front plutôt bas dont le boulot consiste à dresser des enclos pour « retenir les bêtes ». Deux ouvriers et un contremaître. Des Écossais. Qui, d’un bout à l’autre du roman, tendent du fil de fer barbelé dans des paysages absolument désolés avant d’aller se taper des pintes de Guinness dans des pubs non moins sinistres. C’est tout ce que je peux vous raconter. Ah ! si ! Il y a deux événements importants, tout de même. Toutes les deux ou trois heures, l’un des ouvriers demande à l’autre s’il n’aurait pas un clope. L’autre laisse tomber le boulot, sort un paquet de sèches de sa poche pectorale et en offre une à son collègue. Qui la glisse entre ses lèvres. Ici intervient le deuxième événement. Après un temps de réflexion, le premier demande au second s’il n’aurait pas du feu. Le second cherche alors son briquet dans la poche de son jean. Mais le jean est tellement serré qu’il met un bon quart d’heure à en extraire le briquet. Le contremaître, qui observe la scène, se pose alors la question capitale de savoir pourquoi ce gars ne range pas son briquet avec ses cigarettes, ce qui, tout bien réfléchi, leur ferait perdre moins de temps. Voilà. C’est tout ce que je peux vous raconter. Vous en dire plus, ce serait lire à votre place. Ce qui serait très cruel de ma part.
Retenir les bêtes, de Magnus Mills. Éd. Cambourakis (2014), 240 pages, 11 euros.
En librairie · La Loi du rêveur
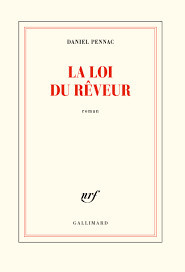
Rêveur. Ce n’est ni un passe-temps ni une profession pour Daniel Pennac. C’est lui tout entier. Au début de son nouveau roman, La Loi du rêveur, il campe un petit narrateur de 10 ans qui, un jour, fait un drôle de rêve : une ville engloutie sous les eaux. Déterminé à tout décortiquer, à comprendre ce que ce rêve peut avoir de prémonitoire, quitte à y passer sa vie entière, ce gamin éclatant de drôlerie et de sagacité parvient, par la puissance de son imagination, à mener le monde en bateau : son meilleur ami, ses parents, des années plus tard son épouse, ses enfants… et, bien sûr, nous, ses lecteurs et lectrices. Blagueur devant l’éternel, Pennac nous raconte-t-il une histoire vraie, un rêve éveillé, ou entièrement réinventé ? Peu importe. Il profite surtout de cette fable exaltante pour rendre hommage à celui qu’il considère comme son maître en tout, le « champion des rêveurs », le cinéaste Federico Fellini. C’est une déclaration d’amour à l’art et à la littérature, à ces spectacles qui, comme le dit Fellini, commencent « dès qu’on ferme les yeux ». Lauren Malka
La Loi du rêveur, de Daniel Pennac. Éd. Gallimard, 176 pages, 17 euros. Sortie le 3 janvier 2020.