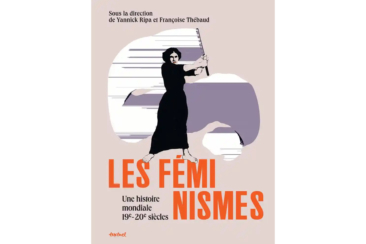Les éditions Textuel publient un superbe ouvrage collectif, Mémoires de nos mères, des femmes en exil. Dedans, neuf autrices issues de l'immigration livrent leurs visions subjectives, tendres, parfois déchirantes, de l'exode de leurs aînées et des silences qui les racontent.

« Cela fait plus de vingt ans qu'elle est morte, et elle reste enracinée dans ma tête, écrit Véronique Tadjo dans La beauté de ma mère. Peut-être que si je l'avais mieux aimée, elle serait partie en laissant sur son passage un souvenir doux-heureux. Au lieu de cela, elle tambourine contre la porte de ma mémoire. Elle sait que les morts ne vivent qu'à travers les vivants. Sans eux, ils ne sont que des os ensevelis dans la caverne du sol. » Ce texte compose, avec huit autres, le beau livre Mémoires de nos mères, des femmes en exil, publié le 9 novembre aux éditions Textuel.
Sous la direction de Laurence Campa, huit autrices françaises d'origine étrangère – Denitza Bantcheva, Ananda Devi, Hélène Frappat, Sorour Kasmaï, Leïla Sebbar, Véronique Tadjo, Jeanne Truong, Laura Ulonati – et elle-même retracent les parcours d'exode des femmes de leurs familles. Qu'elles viennent du Viet-Nam, de l'Iran, du Cambodge, de l'Italie, de l'Inde, qu'elles soient mères ou grand-mères, … ces figures maternelles ont peu dit du bouleversement que la grande Histoire a provoqué sur leurs histoires personnelles en les contraignant au départ. Elles ont peu parlé, ou à demi-mots, du déracinement ou encore de la nécessaire lutte pour l'adaptation sur une terre inconnue. Charge à leurs héritières de recomposer ce récit grâce aux bribes de souvenirs, aux photos, aux objets apportés ou racontés. Grâce à l'imagination, à l'interprétation des silences et au talent littéraire, surtout. Le résultat est un superbe ouvrage collectif dans lequel ces récits de diasporas féminines par leurs descendantes ont le goût universel de la transmission mère-fille, entre amour absolu et douloureux non-dits.
Causette : Comment est né le livre ?
Laurence Campa : Je suis obsédée par les mondes perdus et j'ai commencé à lire un certain nombre d'autrices qui les transforment en littérature. J'ai discuté très longuement avec beaucoup d'entre elles, qui ont toutes en commun que leurs familles, ou une partie d'elles, viennent d'ailleurs. Je me suis alors rendu compte des ressemblances et nous avons poursuivi ces échanges en formant une sorte de petit groupe qui se comprenait, comme si ses membres se connaissaient depuis longtemps. L'idée a germé ainsi. Il m'a semblé évident que ce genre de recherches sur les récits qui forment notre identité peut être mené en solitaire mais qu'à plusieurs, cela produirait d'autres résultats et cela serait d'autant plus puissant. Je leur ai donc proposé de raconter dans un livre collectif ces histoires familiales très différentes mais aux nombreuses résonnances.
Pourquoi ce choix de ne sélectionner que des femmes autrices ?
L.C. : J'ai choisi l'angle de la transmission féminine, qu'il s'agisse de récits portant sur des mères, des grands-mères ou des tantes. Ce qui m'intéressait, c'était d'entendre la parole des filles de ces femmes exilées. Cela n'empêche pas qu'au final, il y a beaucoup d'hommes dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour.
L'exil féminin a‑t-il quelque chose de particulier ?
L.C. : Le récit de cet exil oui, car dans cette génération, la parole était essentiellement masculine. Il arrivait des choses dans le foyer, dans l'intimité qui ne relevait pas de la parole officielle mais de la parole à bas bruit. La plupart des femmes dont il est question dans le livre ont laissé peu de traces et se racontent assez peu. Par exemple Ananda Devi, Jeanne Truong ou moi-même on a très peu de photos personnelles. Il a fallu qu'on comble ces vides autrement.
L'exil des femmes, c'est une sorte d'histoire parallèle à l'Histoire officielle, que les filles doivent reconstituer par des gestes, des sensations, des sentiments, à défaut de parole. En fait, c'est difficile de partager une vraie intimité avec ses parents ou ses enfants. On peut parler beaucoup et d'un tas de choses, mais faire passer des choses plus intimes, surtout pour les femmes de cette génération, c'était pas du tout évident. Cela ne veut pas dire que le silence est intrinsèquement dans la nature de la transmission féminine mais que c'est comme ça que nous, les autrices du livre, avons vécu les choses.
Quels autres points en commun voyez-vous entre ces récits ?
L.C. : La question de la langue maternelle ou, formulé autrement : dans quelle langue on nous a parlé. Par exemple, Denitza Bantcheva raconte que sa mère bulgare et lettrée a tenu à lui parler allemand, qui est devenu une sorte de seconde langue maternelle. Sorour Kasmaï, elle, nous explique que l'épopée familiale fait que, bien qu'Iranienne, c'est le russe qui est devenu la langue de transmission propre aux femmes dans sa famille. Quant à moi, dès la maternelle, ma mère m'apprend le français, qu'elle ne parle pourtant que depuis quinze ans. Je ne parle donc pas viet-namien. Dès lors, quelle est donc ma langue maternelle ? Aujourd'hui, nous écrivons toutes dans une langue qui est plus ou moins la nôtre : le français.
Autre trait commun évident entre ces récits d'exil : l'instabilité. C'est un livre qui essaie de se tenir comme un funambule sur un fil tiré entre le passé, le présent et le futur, un ailleurs et un ici.
Certaines de ces mères [celle de Véronique Tadjo et celle de Leïla Sebbar] sont Françaises et ont connu l'exil en allant vivre dans les pays de leurs époux : la Côte d'Ivoire et l'Algérie. C'est un autre trait commun de ces récits, les histoires d'amour contre vents et marées.
Dans votre texte, on comprend que votre mère ait mis un point d'honneur à vous parler français plutôt que viet-namien pour que vous réussissiez à l'école. Le regrettez-vous ?
L.C. : J'ai arrêté de le regretter. Il ne s'agit pas forcément que d'une seule question de langue maternelle : les ados sont toujours en train de reprocher quelque chose à leurs parents. Je comprends des mots, je l'ai dans l'oreille mais comme le catalan ou l'italien, langues parlées du côté de mon père. A un moment, j'ai demandé à ma mère d'essayer de rattraper le temps perdu. Nous avons essayé, avec des choses simples comme « bonjour monsieur » ; « quelle heure est-il ? » mais cela m'a semblé totalement hermétique. C'est une langue tellement différente de la nôtre, avec des tas d'accents, c'est compliqué. Au final, je me dis que ce n'est pas très grave.
Vous racontez qu'à leur arrivée dans le port de Marseille, votre grand-mère et ses enfants changent de prénom. Est-ce un choix ou est-ce imposé ?
L.C. : D'après ce que j'ai compris – il faut bien avoir en tête que nos textes ne constituent pas une vérité mais une reconstitution de vérités éparses – ils ont dû refaire des papiers d'identité, qu'ils n'avaient plus à cause de la guerre. Ils ont alors choisi de franciser les prénoms pour que ça soit plus facile à prononcer dans leur nouveau pays. Cela montre leur volonté d'intégration mais aussi qu'ils savaient qu'ils partaient sans espoir de retour.
En vous lisant, on comprend aussi que votre famille a une situation relativement bonne au Viet Nam. Au-delà de l'aspect matériel, y a‑t-il eu un sentiment de déclassement ?
L.C. : Oui, le mot est tout à fait juste. Mais comme dans ma famille, les caractères et la culture font que les gens ne se livrent pas, c'est moi qui interprète ce départ comme une souffrance, une perte de quelque chose, sans pouvoir être sûre. Je me suis approprié cette perte peut-être au-delà de leurs propres ressentis. Ma tante me disait ainsi que je me racontais des contes quand je parlais de l'histoire de ma famille. Je crois que ce qui est intéressant, c'est le récit qu'on se fait, qui nous construit. C'est notre vérité à nous, cela ne veut pas dire qu'elle est fausse mais qu'elle est faite de bribes, de choses partagées par des gens de la même famille, de reconstructions. Tout le monde élabore son propre récit et on ne peut pas retracer une vraie vérité, elle se dérobera toujours. L'Histoire est elle-même une mise en récit.
D'ailleurs, vous êtes professeure de lettres modernes mais vous vous intéressez aussi à l'Histoire, en tant que membre du conseil scientifique du Centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre de Péronne (Somme). Un hasard ?
L.C. : Probablement pas mais avant l'histoire, je me suis intéressée à la littérature française et particulièrement à Apollinaire [Laurence Campa lui a consacré plusieurs ouvrages dont Passion Apollinaire : La poésie à perte de vue].
Je crois que ce qui m'a tant interpelée chez lui, c'est que c'est un étranger, né Wilhelm de Kostrowitzky à Rome de père inconnu et d'ascendance polonaise par sa mère, qui fait le choix de devenir un écrivain français. Il a épousé la langue française, a changé de nom pour écrire, a beaucoup voyagé, était un peu instable… j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de commun entre nous, à sa façon d'être toujours un peu sur la crête. Pour moi, sa figure et son œuvre nous questionnent : comment on est libre ? Quelle est notre marge de manœuvre ?
Dans Mémoires de nos mères, la liberté réside dans notre façon de raconter les choses, de recomposer les récits, de rendre des hommages.
Avez-vous des enfants et comment envisagez-vous la transmission de votre histoire par rapport à la façon dont votre mère vous a, elle, transmis les choses ?
L.C. : J'éduque mes enfants très différemment de la façon dont j'ai moi-même été éduquée. Pour autant, ma fille et mon garçon ont tous les deux apprécié le livre, ils y ont reconnu des choses qui se sont transmises oralement, car dans les familles, c'est toujours un peu les mêmes rengaines. Je crois que les autrices de ce livre sont des sortes de chaînons entre les générations, par-delà les mers. Ce sera à nos enfants de raconter par la suite ce qu'ils retiennent de nos transmissions.
Les mères dont parle l'ouvrage l'ont-elles lu et quels ont été leurs retours ?
L.C. : Me concernant, seule ma tante a lu. Elle a aimé, même si elle m'a signifié qu'elle n'aurait pas raconté les choses de la même façon. Mais ce ne sont pas des portraits de mères, ce sont des récits de filles. Le titre, Mémoires de nos mères, c'est la mémoire qu'on en a.
Je n'ai pas encore de retour des autrices dont les mères sont toujours là mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce travail collectif a représenté une forme de réparation, par-delà les ruptures et les silences. Lors de la préparation des textes, certaines d'entre nous ont questionné leurs mères et ont eu du mal à obtenir des renseignements. Certaines mères avaient peur qu'on dévoile des secrets de famille ou qu'on s'approprie des choses qui n'appartenaient qu'à elles. Mais nous avons respecté les silences, je pense que nous avions toutes la sensibilité nécessaire pour ne pas faire infraction dans l'intimité de ces femmes qui comptent tant.
Dans votre introduction, vous expliquez qu'on a aujourd'hui une facilité à se mettre en récit, à parler de soi, notamment sur les réseaux sociaux. Au-delà de la dimension de souffrance qu'a pu représenter l'exil, n'y a‑t-il pas juste une différence entre générations, avec une génération précédente qui n'a jamais appris à parler de soi ?
L.C. : Absolument. J'ai la conviction que quand on raconte une histoire, c'est comme en musique, les silences et les soupirs sont importants. Si une musique n'avait ni silence ni soupir, serait-elle aussi belle ? Je n'en suis pas sûre.
Avec ce livre, on a mis en relation la petite histoire et la grande, on les a mis en jeu, vous savez, comme on dit quand il y a un jeu dans un mécanisme. C'est peut-être dans ce je(u) que les choses sont intéressantes, parce qu'elles ne sont pas figées mais en mouvement.
Mémoires de nos mères, des femmes en exil, sous la direction de Laurence Campa, éd. Textuel, 168 p., 39 €.