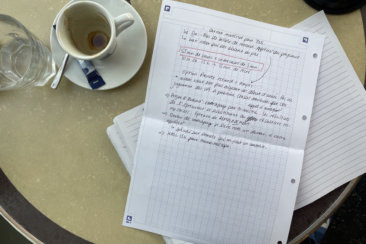Causette est associée au site The Conversation, qui regroupe des articles de chercheur·euses de différentes universités et permet à des médias de republier les textes. Aujourd’hui, la chercheuse espagnole en philologie française Ana María Iglesias Botrán nous raconte comment les grands magasins sont devenus un espace de liberté pour les femmes, et c'est passionnant.
Ana María Iglesias Botrán, Universidad de Valladolid
La Samaritaine vient de rouvrir ses portes à Paris. Fondée en 1860, c’est l’une des enseignes historiques de la ville, avec le Bon Marché (1838), le plus ancien des grands magasins de la capitale. Ces temples commerciaux sont devenus, à partir du milieu du XIXe siècle, des oasis de liberté pour les femmes, qui y ont trouvé un lieu où elles pouvaient enfin agir de manière indépendante.

Désir et sensualité comme moteurs des ventes
Les grands magasins résultent directement de la révolution commerciale et industrielle, qui a provoqué de profonds changements sociaux Avec un seul objectif, vendre, la cible était claire : les femmes. Surtout les plus riches et les plus oisives d’entre elles. Toutes les stratégies commerciales visaient à prolonger la présence des femmes sur les lieux d’achat. Pour y parvenir, il fallait transgresser, toujours dans les limites de la décence, les usages bourgeois – ou victoriens, au Royaume-Uni.
Avoir touché, senti et même goûté un objet en rendait l’attrait irrésistible, surtout lorsque son prix était abordable.
Les concepteurs des grands magasins avaient déjà compris la nécessité de ce qu’on appelle aujourd’hui le « storytelling », en présentant le grand magasin comme un lieu sûr, élégant et policé. Comme une seconde maison où tous les rêves des femmes pourraient se réaliser – même s’il s’agissait avant tout de créer des modes de toutes pièces et de créer de nouveaux besoins.
Un lieu de promiscuité
Au XIXe siècle, les femmes bourgeoises ne sortaient pas seules de la maison. Si elles le faisaient, ce n’était que pour des visites de courtoisie, de petits achats, pour aller à la messe, mener des œuvres de charité – toutes activités soumises à une morale rigide.

Cependant, le shopping étant devenu un loisir de la société industrielle, aller seule dans un grand magasin était autorisé. Les prix fixes et abordables, les catalogues, les bonnes affaires et la possibilité de retourner les articles attiraient ces femmes aisées.
Les ouvrières, les prostituées, les artistes, etc. s’y rendaient également en grand nombre. Toutes les femmes avaient donc accès au même choix de produits, ce qui créait une forme d’ambivalence. La prostituée, et la demi-mondaine pouvaient parfaitement acheter la même robe, le même parapluie et les mêmes gants que la femme respectable d’un homme d’affaires ou d’un politicien. C’est le début de la démocratisation de la mode : il n’est plus aussi facile de savoir qui est qui, juste par les vêtements.
C’est désormais le grand magasin qui dicte une certaine forme de prestige social.

Pouvoir toucher, sentir, goûter
Émile Zola, dans son roman Au bonheur des dames (1883), raconte avec précision comment l’univers visuel du grand magasin a été conçu au millimètre près. C’était un palais des sens, plein de tissus colorés, de rubans de toutes sortes, de parfums, de robes, de chapeaux, de sacs à main, de gants, de chapeaux… Et surtout, les femmes pouvaient enfin toucher la marchandise.
Jusqu’alors, l’expérience d’acheter des vêtements était plutôt froide. Une couturière venait à la maison, ou bien cela se faisait dans une petite boutique mais toujours avec le filtre de ce que le vendeur ou la couturière décidait de montrer. Il y avait peu de place pour le choix.
Dans un grand magasin, au contraire, la clientèle se promène à l’aise, touche tout, essaye, et est toujours accompagnée d’une vendeuse qui l’aidera à se débarrasser de ses éventuelles inhibitions… et la convaincre d’acheter.

La vendeuse, de l’ouvrière à la femme d’affaires
Les vendeuses représentaient cette image de décence et de propreté. Vêtues d’un uniforme, elles devaient être bien soignées, discrètes et polies. Elles avaient appris les manières des bourgeoises pour pouvoir les fréquenter,et montrer une soumission polie à leurs désirs. Il ne fallait pas être trop coquette non plus, car la protagoniste devait toujours rester la cliente, qui devait se sentir belle, spéciale et propriétaire de son expérience d’achat.
Pour les vendeuses, c’était un travail difficile ; elles ne pouvaient jamais s’asseoir pendant des journées de travail interminables et devaient être constamment en mouvement. En contrepartie, outre leur salaire, elles étaient logées et nourries dans le grand magasin même.
Il leur offrait donc la sécurité et un revenu régulier. Dans certains cas, leurs économies leur permettaient de quitter ce travail, de rentrer chez elles et d’ouvrir leurs propres magasins, car la province était friande de cette élégance moderne à la parisienne.
« Où sont les toilettes, s’il vous plaît ? »
Les grands magasins étaient immenses, lumineux, avec de larges allées, des plafonds en verre pour profiter de la lumière du jour, et des ascenseurs qui facilitaient les déplacements entre les étages. Mais il y avait un obstacle qui limitait le temps consacré aux achats.

Les femmes ont toujours eu du mal à rester hors de la maison pendant de longues heures parce qu’elles ne pouvaient pas aller aux toilettes. À l’époque, les architectes ne prêtaient aucune attention aux toilettes dans les maisons, et il était difficile de se déshabiller seule avec tant de jupons, corsets, dentelles, nœuds, etc. Le Bon Marché était conscient de cet obstacle et a fait construire d’élégantes toilettes de style art déco.
Autre facteur qui réduisait le temps consacré aux achats : les maris, quand ils les accompagnaient. On a découvert que les femmes faisaient davantage leurs emplettes avec des amies qu’avec leur époux. C’est pourquoi Le Bon Marché a aménagé une salle de lecture, avec des livres et des journaux, où les hommes pouvaient attendre tranquillement en lisant et en fumant.
Tourments existentiels
La vie quotidienne des femmes bourgeoises du milieu du XIXᵉ siècle pouvait être étouffante. Elles n’étaient pas considérées comme des adultes et dépendaient des hommes pour tout.
Le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856), raconte justement l’agonie existentielle d’une femme qui vit tourmentée entre un monde extérieur vide et un monde intérieur plein d’aspirations frustrées, et sans aucune vie sexuelle. Une existence soumise à l’angoisse de vivre dans une cage sociale, sans possibilité d’évasion.
Beaucoup de ces femmes étaient taxées d’hystérie : une maladie nerveuse qui provoquait des sautes d’humeur, des bouffées de chaleur, de la colère et de la tristesse.
Cette vie émotionnelle et sexuelle des femmes était théorisée par des médecins : Paul Briquet publie ainsi Le Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie (1859) où il interprète la maladie comme une « névrose de la portion de l’encéphale destinée à recevoir les impressions affectives et les émotions ». Le neurologue Jean‑Martin Charcot, lui, essaye de les guérir grâce à l’hypnose. Il organise des démonstrations de crises d’hystérie dans ses leçons du mardi à l’Hôpital de la Salpêtrière devant un public choisi, comme s’il s’agissait d’une représentation théâtrale. Pendant ce temps, les femmes continuaient à souffrir et à déprimer.

C’est pourquoi les grands magasins étaient remplis de femmes avides de se déplacer seules pour voir, toucher, désirer et acheter. Leurs rêves semblaient se matérialiser, elles pouvaient avoir l’impression de s’évader, et les stratégies de vente apaisaient leur désir de liberté. Dans le grand magasin, tout tournait autour de la satisfaction de leurs caprices. Elles étaient écoutées, choyées et désirées : enfin, elles se sentaient exister.
La cleptomanie, un mal féminin ?
Cette libération des émotions a fait naître la cleptomanie, considérée à l’époque comme une pathologie féminine.

L’étude de Nacho Moreno Segarra Ladronas Victorianas. Cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes, Les voleuses de l’époque victorienne. Cleptomanie et genre aux débuts des grands magasins (2017) explique comment les grands magasins comptaient sur le fait que chaque jour, il y aurait un nombre spécifique de vols. On comptait alors des centaines de voleuses à l’étalage à Paris. Certains médecins ont voulu attribuer ce phénomène à la ménopause ou aux menstruations – pathologisant un peu plus le corps et les comportements féminins. Ce qui semble certain, c’est que pour beaucoup d’entre elles, le plaisir de voler – et donc de transgresser les règles – était plus fort que celui de payer.
Les cleptomanes – le plus souvent bourgeoises – étaient traitées avec beaucoup de courtoisie et de discrétion. Si les maris l’apprenaient, ils étaient étonnés de découvrir que leur femme semblait incapable de contrôler ses pulsions et de résister à la tentation. Cette transgression des règles de la moralité et de la décence, associée à la peur du qu’en-dira-t-on, les effrayait au plus haut point.
Ils ne se doutaient pas que cet espace, encombré par le va-et-vient des robes issues de toutes les classes sociales, contribuerait à éveiller en elles un désir de liberté de plus en plus grand.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.