L’univers de la mode, Audrey Millet l’a étudié sous toutes ses coutures. Après l’avoir observé de l’intérieur en travaillant comme styliste pour Dior et d’autres marques de luxe, elle a opéré un virage à 360 degrés pour devenir docteure en histoire, spécialiste de l’habillement. Elle vient de publier son Livre noir de la mode, dans lequel elle ne mâche pas ses mots.
« L’industrie de la mode est au monde ce que la thanatopraxie est au cadavre : un joli cache-misère ! » La formule est cinglante et reflète bien l’esprit d’Audrey Millet, cette historienne de 39 ans au franc-parler qui détonne. Ses cheveux rose bonbon et ses lunettes « Fantômette », qui changent de forme et de couleur chaque jour, la distinguent déjà des professeur·es qui l’entourent dans les différents centres de recherche où elle enseigne – dont l’EHESS à Paris, l’université d’Oslo et l’Institut universitaire européen de Florence. « C’est sûr que dans le milieu de la mode, à 20 ans, j’avais plus la tête de l’emploi ! »
Dans son Livre noir de la mode, paru en mars, la chercheuse opère un relevé scientifique de tous les scandales qui jalonnent l’histoire de la mode depuis sa naissance jusqu’à nos jours et raconte la fabrique d’un système pourri jusqu’à l’os. Pour elle, cette discipline, devenue une industrie avant même que le mot n’existe, dès le XVIIe siècle, reflète ce qu’il y a de pire et de plus immuable dans l’évolution du capitalisme. L’esclavage, la tyrannie des puissants, la violence misogyne, le mensonge organisé pour asservir l’humanité, les drames sociaux, sanitaires, environnementaux… tout y est. Un « paradoxe du bonheur » à l’état pur « dont tout le monde profite et dont tout le monde crève ».
Du dessin à l'écriture
Petite-fille de mineurs originaires du nord de la France, où elle vit toujours, fille d’un militaire et d’une fonctionnaire, Audrey Millet n’a pas été biberonnée à l’Histoire et n’a jamais rêvé de conquérir les diplômes. Après une enfance passée à « dessiner les bonnes femmes » en s’inspirant d’Egon Schiele, tout en développant, d’après ses proches, une passion « inattendue » pour les romans de Zola, elle s’inscrit en arts plastiques et en modélisme avant d’être engagée, très jeune, comme styliste indépendante pour Dior, Jérôme Dreyfuss et d’autres marques de couture. Cette expérience, qui a duré deux ans, lui inspire ses premières désillusions vis-à-vis d’un métier qu’elle croyait aimer. « J’ai vu des jeunes filles de 18 ans se faire arracher les dents du fond pour avoir le visage plus fin, des directeurs de défilés abuser de leur pouvoir de façon abjecte, des créateurs piller allègrement le travail de leurs concurrents. J’ai vu l’excès de drogue, de sexe, d’argent… et tout ce à quoi il faut se plier pour intégrer ce monde. »

Très vite, elle sent que sa place est ailleurs. Elle veut s’intéresser au travail bien fait. Connaître l’histoire des gestes, des techniques, des injonctions sur les corps – ceux des couturier·ières dans leur espace de travail et ceux des consommateur·rices qui achètent les vêtements. Elle se lance alors dans un master en histoire de l’art, qu’elle double d’un Capes en histoire-géographie. Puis, passionnée de littérature et allergique aux étiquettes, elle décide de passer un double doctorat histoire et lettres. À 34 ans, la voilà prête pour sa nouvelle carrière, qu’elle inaugure en se lançant dans un premier livre : Fabriquer le désir. Une histoire de la mode de l’Antiquité à nos jours, puis en enseignant à la fac et dans le secondaire.
Pour son ami et confrère Pascal Brioist, historien des sciences et des techniques, spécialiste de Léonard de Vinci, « elle est la seule historienne française à pouvoir mener une recherche “totale” sur la mode. Elle ne s’intéresse pas qu’aux chiffres et aux données factuelles. J’ai tout de suite senti qu’on était du même monde et aimé son profil hybride. Elle est très originale, issue d’un milieu populaire, ce n’est pas courant dans le milieu de la recherche. Elle n’est pas dans le moule Sciences Po, Normale Sup, c’est une créative, une passionnée ». Il complète : « Audrey a absorbé des bibliographies sociohistoriques, mais a aussi appris à manier les ciseaux, à prendre les mesures. Elle est passée par le monde de la fabrication, elle sait ce que c’est. Elle est capable de vous parler du processus industriel, technique, c’est très rare ! C’est également pour cela qu’elle est aussi empathique avec les collégiens et les lycéens qu’elle a eus en REP [réseaux d’éducation prioritaire, ndlr] lorsqu’elle vivait à Paris. Pour cela aussi qu’elle s’est intéressée, dans d’autres travaux universitaires plus confidentiels, à la douleur au travail. Je sais ce que c’est, car je suis moi-même petit-fils de serrurier… Certains savoirs sont dans la main de l’ouvrier et nulle part ailleurs. »
Déni sanitaire, environnemental…
À l’origine de ce « livre noir » qu’Audrey Millet vient de publier, il y a donc les premières révoltes, qu’elle ne raconte plus, car il lui semble pour l’instant improbable d’assister à l’émergence d’un fashion gate, mais sur lequel il y aurait pourtant beaucoup à dire. « Cela fait plus de vingt ans qu’on dénonce les horreurs sexistes, sexuelles et la pédopornographie dans le milieu de la mode. Et rien ne change. Ce qui m’intéressait dans ce livre, c’était justement d’élargir le cadre. »
Ouvrir le cadre, selon elle, c’est étudier à la loupe trois dénis criminels. Le premier est sanitaire : « La vraie colère est venue de là, explique-t-elle. Lorsque j’ai découvert que des articles scientifiques, accessibles à tous, prouvaient le lien de cause à effet entre l’explosion de la stérilité, de l’autisme, de maladies comme le cancer du rein, de l’utérus, du sein et l’utilisation, dans la chaîne de production textile, de pesticides et de produits aussi répandus que les métaux lourds comme le chrome et le mercure (dans les dissolvants et les teintures). Dans certaines régions productrices du sud de l’Inde, ce sont des villages entiers qui sont décimés. » À l’autre bout de la chaîne, dans les pays riches comme les nôtres, on retrouve ces mêmes vêtements imprégnés de colorants toxiques aux coins de nos rues. Ils maculent les corps des vendeur·euses et, bien sûr, les nôtres.
Deuxième dérive dans le viseur d’Audrey Millet : les catastrophes environnementales engendrées par l’industrie de la mode. Comme le rappelle l’historienne, « ces mêmes colorants et teintures toxiques pour nos corps le sont aussi pour l’environnement. Les rejets des usines font du textile la deuxième industrie la plus polluante juste derrière les transports ».
… et social
Troisième dérive : côté social et humain, où la situation est tout aussi dramatique. D’abord pour les fabricant·es : travailleur·euses forcé·es, parfois déporté·es dans des camps en Chine, les ouvrier·ières qui récoltent le coton par exemple (lequel compose 70 % des textiles dans le monde) sont transformé·es en esclaves au vu et au su des autorités du monde entier, qui profitent de leur travail bon marché. On rejoint ici les problématiques sanitaires, puisque les ouvrier·ières du textile, dans les pays pauvres comme dans les pays riches, sont empoisonné·es par les produits chimiques et menacé·es de mort au quotidien par des conditions de travail inhumaines. « Les médias annoncent régulièrement les catastrophes liées au manque de sécurité dans les usines, s’indigne Audrey Millet. Les bâtiments vétustes s’écroulent au Bangladesh et ailleurs, les horaires sont insoutenables, le temps de travail des enfants ne décroît pas… À chaque nouveau drame, on crie “plus jamais ça” et rien ne change. Je veux comprendre pourquoi ces scandales ne “prennent” pas, pourquoi on en arrive à nier ces crimes massifs et même à s’y asservir en toute connaissance de cause. D’après moi, la raison est simple : ces crimes forment les ressorts indéboulonnables d’une industrie qui continue de se porter comme un charme, de baisser ses prix et de jouir d’une bonne santé dont nous croyons tous, à tort, profiter. »
« Je veux comprendre pourquoi on en arrive à nier ces crimes massifs et même à s’y asservir en toute connaissance de cause »
Audrey Millet
Dans les pays riches, les créateur·rices sont de moins en moins respecté·es. Sommé·es de « créer » jusqu’à vingt-quatre collections par an – et non plus une par saison comme au fondement de l’industrie – et de s’inspirer de vêtements concurrents, celles et ceux que l’on continue d’appeler « stylistes » ou « designers » sont tombé·es de leur piédestal. Lorsqu’ils parviennent à se distinguer, comme Christian Lacroix ou Ralph Lauren, leurs créations ne sont pas protégées juridiquement, ce qui permet aux marques dites de « fast fashion » de piller leurs modèles librement. « Tous finissent le plus souvent par rendre leur tablier ou pire, comme Alexander McQueen, par se suicider », remarque l’historienne.
« Je veux prouver que le système d’oppression est le même entre le Shanghai actuel et le Paris du XIXe siècle. »
Mais alors, que faire ? Comment s’habiller ? Audrey Millet l’admet, elle n’a pas la réponse. « Le problème est systémique. » À l’échelle individuelle, il est bien sûr possible de chercher des échappatoires. « D’abord, en s’informant, indique-t-elle. Mais aussi, lorsqu’on en a les moyens, en privilégiant des matières plus naturelles comme le lin, le chanvre ou le Tencel, un tissu produit à partir du bois. En se tournant vers les produits de qualité et de seconde main. Mais surtout en achetant moins ! »
Enfin, un dernier conseil, le nôtre : suivre de près les travaux d’Audrey Millet. Car cette historienne, non contente d’avoir synthétisé tous les savoirs sur la mode depuis l’Antiquité, se lance dans une aventure risquée, sous l’égide de l’université d’Oslo et de l’Union européenne : « Je pars à Shanghai, nous confie-t-elle, pour observer les entreprises de couture chinoises de l’intérieur. Ce que je veux prouver, c’est que le système d’oppression est le même entre le Shanghai actuel et le Paris du XIXe siècle. » Un sujet brûlant cousu main et au millimètre près par cette amoureuse de Zola, qui ne veut rien d’autre que sauver la mode sans déshabiller l’humanité.
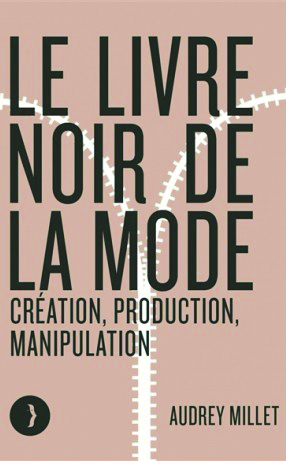
Le Livre noir de la mode. Création, production, manipulation.
Éd. Les Pérégrines, 250 pages.
Fabriquer le désir. Une histoire de la mode de l’Antiquité à nos jours.
Éd. Belin, 472 pages, 2020.






