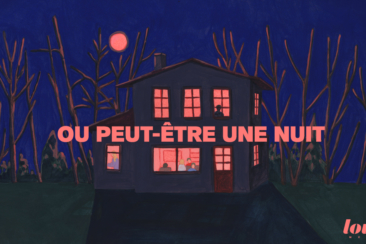Cinquième et dernier épisode d'une série de chroniques de l'association féministe Politiqu'elles publiées sur Causette.fr, qui décrypte les programmes des candidat·es à l'élection présidentielle 2022 en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, focus sur la représentation des femmes dans la sphère publique.

En 2022, le nombre de prétendantes à la fonction présidentielle n’a jamais été aussi élevé. Néanmoins, cette meilleure représentation ne garantit pas la prise d’engagements réels pour améliorer la place des femmes en politique, dans les médias ou la culture. Cet article passe donc à la loupe les propositions des différents programmes des candidates et candidats pour assurer une représentation plus juste des femmes dans la sphère publique.
Parité dans les institutions publiques et partis politiques
Le principe de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » a été inscrit dans la Constitution dès 1999 puis consacré dans son premier article lors de révision constitutionnelle 2008. De ce principe, l’objectif de parité s’est progressivement imposé au cœur des institutions politiques depuis la première loi parité en 2000 qui contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d’hommes et de femmes pour les élections régionales, municipales, sénatoriales et européennes. Néanmoins, encore aujourd’hui, de nombreux partis politiques continuent de préférer perdre des milliers voire millions d’euros en financements publics plutôt que d’investir le nombre de candidates requis. Par ailleurs, le Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes souligne que plusieurs types de collectivités territoriales (communes de moins de 1000 habitants et intercommunalités).
Le choix de la composition d’un gouvernement, y compris en termes d’équilibre femmes/hommes, demeure à la discrétion des chefs ou cheffes d’Etat et de gouvernement.
Les deux derniers quinquennats ont mis en place des gouvernements paritaires pour la première fois dans l’Histoire. En cohérence, le président-candidat s’engage une nouvelle fois à mettre en place un gouvernement paritaire en cas de réélection comme l’a confirmé Bérangère Couillard, membre du groupe égalité femmes-hommes de l’équipe de campagne, lors de son entretien avec notre association. La systématisation de la nomination de gouvernements paritaires est une étape importante pour la place des femmes en politique. Néanmoins, certains analystes tels que la politologue Réjane Sénac regrettent une répartition encore genrée des responsabilités et portefeuilles, se matérialisant par des femmes plus représentées parmi les secrétariats d’Etat ou dossiers sociétaux à l’inverse des ministres de plein exercice et régaliens. En outre, au cœur du pouvoir, les cabinets ministériels demeurent très loin de la parité : 80% des directeurs de cabinets sont des hommes selon Oxfam. Enfin, en 2017, Emmanuel Macron s’était engagé à nommer une Première ministre à la tête de son gouvernement, engagement non suivi d’effet en 5 ans. Face à cette critique, Emmanuel Macron répondait lors de l’émission « Face aux Françaises » sur LCI qu’il avait tenté « tout au long de ce quinquennat de nommer aux postes de responsabilités quelques qu’ils soient les personnes les plus compétentes ». Malgré ces limites, le bilan d’Emmanuel Macron peut en revanche se prévaloir d’une avancée assez marquante : le bon du nombre de femmes élues députées qui passent en 2017 à 38,7% contre 26,9 % en 2012, notamment par le respect de la parité dans le groupe majorité.
De nombreux candidats ont aussi fait part de leur volonté de mettre en place la parité dans leur gouvernement. Jean-Luc Mélenchon qui estime que l’Etat doit “être exemplaire dans la promotion d’une culture d’égalité” prévoit l’instauration d’un gouvernement paritaire, comprenant une répartition des responsabilités et ministères régaliens également plus égalitaire. Plus largement, le programme du candidat insoumis appelle à imposer la parité entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Du côté des écologistes, Yannick Jadot souhaite instaurer la parité réelle au sein du Parlement et au sein du gouvernement. Valérie Pécresse a pris à plusieurs reprises la parole pour célébrer les mérites de la parité sans formuler d’engagement concret sur la composition de son gouvernement. Lors de l’entretien de Politiqu’elles avec sa porte-parole Florence Portelli, cette absence a été expliquée par une volonté de ne pas préempter les résultats de avant l’heure. L’ensemble des candidates et candidats mentionnés ci-dessus ont exprimé un soutien de principe à la nomination d’une Première ministre, seul Yannick Jadot s’y est engagé formellement dans les déclarations analysées par notre association.
Nous n’avons pas noté de déclaration récente de Philippe Poutou, de Jean Lassalle, de Nicolas Dupont Aignan ou de Nathalie Arthaud sur la parité. Néanmoins, en 2017, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste rappelait que les statuts du parti prévoient une obligation de parité dans les instances dirigeantes. Nicolas Dupont-Aignan avait pris la parole sur ce principe en 2017 assurant avoir le sentiment en politique « qu’il y a d’énormes progrès » grâce aux mesures mises en place, changement de ton par rapport à certaines de ces déclarations en 2012. Marine Le Pen s’est longtemps opposée au principe de parité mais a néanmoins déclaré avoir changé d’avis face à l’efficacité du dispositif existant ayant permis l’émergence de plus de femmes en politique comme elle le souligne dans un entretien pour le magazine Elle, sans pour autant formulé d’engagement sur la composition de son gouvernement.
Un candidat fait exception en s’opposant de façon claire au principe de parité. Eric Zemmour a déclaré qu’il « trouv[ait] la parité humiliante pour les femmes » et reste fidèle à ses propos tenus en 2013 selon lesquels « les femmes n’incarnent pas le pouvoir. » Il confirme qu’il n’y aura pas d’obligation de parité dans son gouvernement lorsque la question lui est posée dans un entretien avec le vidéaste Hugo Décrypte.
D’autre part, la parité dans les postes à responsabilité dans les équipes de campagne n’est pas acquise dans toutes les organisations. Une polémique avait émergé à ce propos lorsque Valérie Pécresse avait présenté son équipe de campagne comme partiaire alors que celle-ci comprend seulement 31 femmes pour 59 hommes. Les équipes d’Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel rapportaient à notre association une organisation paritaire de leur équipe de campagne respective. Le président-candidat Emmanuel Macron est souvent critiqué par le fait que sa garde rapprochée et les poids politiques de LREM seraient essentiellement des hommes, y compris dans la présente campagne. Lors de notre entretien avec Bérangère Couillard, la membre du groupe égalité femmes-hommes dans l’équipe de campagne nous rapporte que le parti présentiel n’avait pas publié d’organigramme de campagne mais que le mouvement avait bien nommé des femmes à des postes clés. Ainsi, il apparaît assez complexe de vérifier certaines déclarations de principes avec la réalité sur le terrain de la campagne.
Violences sexistes et sexuelles en politique Dans une tribune publiée dans Le Monde en novembre 2021, 285 femmes engagées en politique appellaient à un #MeToo politique notamment en écartant les auteurs de violences sexistes et sexuelles de la vie politique. Cette initiative fait écho à un constat alarmant : le sexisme en politique se manifeste aussi par une certaine impunité des responsables politiques visés par des accusations pour violences sexistes et sexuelles.
Plusieurs candidates et candidats s’engagent ainsi à lutter contre les violences sexistes et sexuelles en politique à la fois dans leur programme et au sein de leur propre formation. Dans son programme, Yannick Jadot s’engage à écarter « les auteurs et les mis en examen pour des faits de violences sexistes et sexuelles de la composition du gouvernement, de leurs équipes et des postes de la haute fonction publique ». Il souhaite également mettre en place des cellules d’alerte, d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violences au sein des administrations publiques. Philippe Poutou souhaite pour sa part, l'inéligibilité des élus condamnés pour violences faites aux femmes et propose la suspension de toute fonction de représentation pour les hommes accusés de ces violences le temps de la procédure. Même idée du côté du parti communiste : Fabien Roussel s’engage pour la mise en place d’une peine d'inéligibilité requise par les parquets contre les élus condamnés pour violences sexistes et/ou sexuelles. Valérie Pécresse souhaite écarter de son gouvernement tout ministre mis en examen, y compris pour violences sexistes et sexuelles, mais alerte contre les dangers de prise de décision sur des accusations non instruites par la justice.
Nous n’avons pas à jour connaissance de mesure spécifique à ce propos dans le programme du candidat-président bien que celui-ci souligne l’importance de l’exemplarité des structures politiques. Lors de son quinquennat, Emmanuel Macron a été très critiqué quant à son absence de réactions au moment des accusations pour violences sexistes et sexuelles formulées à l’encontre de deux de ses ministres : Nicolas Hulot et Gérard Darmanin (un non-lieu a été requis par le parquet de Paris contre Gérald Darmanin). Le président assume aujourd’hui cette décision invoquant le principe de présomption d’innocence, et les risques d’une « République du soupçon » si celui n’était pas respecté. Gabrielle Siry-Houari, porte-parole d’Anne Hidalgo, rappelait le soutien de la candidate au #MeToo politique, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. La candidate socialiste est donc favorable à la prise de sanctions au sein du parti en cas d’accusation, sans décision de justice nécessaire. On peut noter que cette orientation, si mise en place lors de la polémique autour de Christophe Girard accusé d’abus sexuels, l’adjoint au maire aurait dû être écarté de la majorité en place, ce qui ne fut pas la position d’Anne Hidalgo au début de l’affaire.
En complément de ces engagements ou déclarations, plusieurs partis politiques ont instauré en leur sein des mécanismes visant à mieux prendre en charge les potentielles victimes de violences sexistes et sexuelles. Le parti communiste, a créé en interne un dispositif Stop Violence et a signé une convention avec le Collectif Féministe Contre le Viol. Lors de notre entretien, l’équipe de campagne de Fabien Roussel précisait que la question des violences sexistes et sexuelles était intégrée dans tous les stages de formation du parti. La France insoumise a aussi mis en place un comité de suivi des violences sexistes et sexuelles, centre d’écoute indépendant dans le mouvement animé par des associations spécialisées. EELV, le parti socialiste et LREM ont également mis en place des cellules d’écoutes en ce sens.
Par ailleurs, le collectif #MeToo politique mettait en lumière le fait que plusieurs candidats étaient accusés de violences sexistes et sexuelles, visant sans les citer ou présager de leur culpabilité Eric Zemmour et Jean Lassalle. Le premier a fait l’objet du témoignages de 8 femmes qui rapportaient comportements inappropriés et d’agressions sexuelles pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. Jean Lassalle quant à lui, a fait l’objet de plusieurs dénonciations en 2017 pendant la vague #MeToo pour harcèlement ou violences sexistes et sexuelles.
Manque de représentation des femmes dans les médias
Les femmes ont également une place minorée dans les médias, représentant seulement un tiers du temps de parole. Cet écart se creuse encore davantage lorsqu’il s’agit de parler de sujets spécifiques comme d’économie, de politique ou encore de culture. Seuls 27% des invités politiques en 2020 étaient des invitées selon l’ARCOM (anciennement CSA). La crise a d’autant plus mis en exergue cette répartition inégalitaire du temps d’audience. La députée Céline Calvez a rendu en 2020 un rapport sur la place des femmes dans les médias pendant la crise aux ministres Roselyne Bachelot, Elisabeth Moreno et Marlène Schiappa. La députée LREM y formule plusieurs recommandations parmi lesquelles la création d’un observatoire de la parité et de l'égalité femmes-hommes dans les médias, la définition de meilleurs indicateurs ou une plus grande représentativité des femmes dans les médias.
Néanmoins, ce sujet apparaît relativement sous-investi dans les programmes des candidates et candidats. L’équipe d’Anne Hidalgo a ainsi garanti vouloir renforcer les moyens de l’ARCOM y compris dans son action pour assurer une plus grande mixité dans les médias. La candidate critique également la concentration des médias et souhaite défendre davantage de pluralisme qui serait, d’après son programme, favorable à l’égalité femmes-hommes. Sabrina Nouri, responsable thématique égalité femmes-hommes dans le parti LFI énonçait à notre association l’engagement du mouvement à promouvoir la place des femmes dans sa
communication par exemple par l’instauration de semaines dédiées où le parti n’envoient que des représentantes sur les plateaux, malgré les réticences de la part de certains médias. Jean-Luc Mélenchon souhaite aussi lutter contre les représentations discriminantes des femmes dans les industries culturelles et créatives ainsi que dans la publicité, notamment en conditionnant les aides publiques au respect de critères favorisant la diversité.
Sexisme dans la sphère numérique
La place des femmes dans la sphère publique est également mis à mal par les cyberviolences dont les figures publiques, journalistes, élues et militantes sont régulièrement victimes dans l’espace numérique : elles seraient 27 fois plus sujettes à être cyberharcelées qu’un homme selon le documentaire Arte #SalePute qui alerte de ces comportements visant à silencier les femmes lorsque présentes dans la sphère publique.
Une grande partie des candidates et candidats se sont engagés à lutter contre le cyberharcèlement. Valérie Pécresse souhaite renforcer les sanctions en cas de cyberharcèlement et propose la mise en place d’un cyber-paquet qui s’attaquerait notamment à cette problématique. Le candidat Nicolas Dupont Aignan l’importance d’améliorer la place des femmes dans les médias sociaux en luttant contre les violences en ligne. Emmanuel Macron souhaite aussi renforcer l’arsenal judiciaire pour les cas de harcèlement. Anne Hidalgo appelle dans son programme à lutter contre toutes les formes d’harcèlement qu’elles soient en ligne ou non et souhaite créer une commission nationale de suivi des réseaux sociaux auprès du Défenseur des droits. La lutte contre le cyberharcèlement est bien présente dans le programme du candidat communiste Fabien Roussel. Lors de notre entretien, son équipe de campagne nous a fait savoir que leur candidat était très attentif aux cyberviolences subies par les élues. Yannick Jadot s’engage dans son programme à renforcer les moyens de lutte contre le cyberharcèlement, notamment de la plateforme Pharos. L’équipe de campagne du candidat Jean-Luc Mélenchon a affirmé l’importance pour la structure de dénoncer ces violences y compris lorsqu’elles touchent des femmes élues, particulièrement visées sur Twitter. Nous regrettons néanmoins que la notion du cybersexisme et la dimension fortement genrée des violences en ligne ne soient généralement pas assez mises en avant dans ces propositions
Représentation des femmes dans le récit national
L’invisibilisation des femmes dans l’Histoire a été documentée reste un enjeu majeur pour notre mémoire collective. Déjà en 1970, le Mouvement pour La Libération des Femmes adoptait le slogan choc suivant pour dénoncer ce problème : « Il y a plus inconnu que le Soldat, c’est sa femme. » Féminisation des rues, programmes scolaires, culture… de nombreuses pistes sont mises en avant par les spécialistes pour célébrer davantage les femmes illustres qui sont très peu reprises dans les programmes analysés. Lors d’un entretien avec Politiqu’elles, la porte-parole de Yannick Jadot, Mélissa Camara mentionnait la volonté du candidat d’une plus grande place du « matrimoine » dans les programmes scolaires. Le candidat Nicolas Dupont-Aignan mentionne également vouloir "rééquilibrer les programmes scolaires” pour mieux représenter les femmes. Sur cet aspect, nous n’avons pas noté d’engagement du président-candidat mais on peut noter dans son bilan la panthéonisation de Joséphine Baker en 2021 qui fut un événement marquant pour la mémoire collective.
Lire aussi l #Femmes2022 : égalité femmes-hommes à l'école, demandez les programmes
Nos conclusions et ce qu’il manque à ce stade
Le sujet de la place des femmes dans la sphère publique est très peu investi par les candidates et candidats à l’élection présidentielle 2022. Lorsqu’on les interroge sur le sujet, beaucoup de prétendants et prétendantes à l’élection ont le réflexe de mentionner le nom de femmes membres de leur mouvement ou occupant une fonction à responsabilité, sans mettre en question les freins systémiques qui perdurent et restreignent les voies d’accès des femmes aux postes de décision politique ou de représentation médiatique. Par ailleurs, en se penchant plus près sur la structure de certains partis, les velléités de parité ne sont parfois pas réellement suivies d’effets, avec une surreprésentation des hommes aux postes les plus stratégiques. La question du « matrimoine » ou autrement dit, d’une place plus grande donnée aux Femmes illustres de l’Histoire parmi nos figures nationales, ne fait pas l’objet de mesures détaillées dans les déclarations et programmes analysés. On peut néanmoins se réjouir du fait que le principe de parité n’est plus remis en cause, à une exception près. Un célèbre leitmotiv du féminisme des années 60 scandait que « le privé est politique ». De la même manière, nos institutions publiques reflètent notre société : notre système de valeur et nos représentations personnelles façonnent notre sphère publique. La plus juste représentation des femmes dans la sphère publique devra donc passer par une vraie révolution culturelle engageant toutes les parties prenantes, des responsables politiques, médiatiques en passant par le monde académique et bien-sûr, les citoyennes et citoyens.