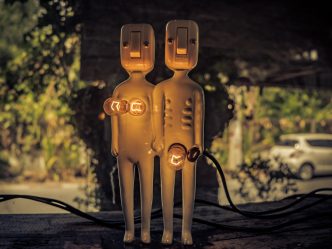Second épisode d'une série de chroniques de l'association féministe Politiqu'elles publiées sur Causette.fr, qui, toutes les deux semaines, décrypte les programmes des candidat·es à l'élection présidentielle en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, focus sur l’égalité professionnelle et l'émancipation économique.
Le 3 novembre dernier à 9 h 22, les Françaises commençaient à travailler gratuitement. Cette date symbolique, estimée à partir des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes (16,5% en 2021 selon Eurostat) avance chaque année. Les inégalités salariales ne sont pas les seules manifestations du sexisme dans le milieu du travail : la division sexuée des tâches, les comportements paternalistes ou remarques hostiles, le plafond de verre pour les fonctions de direction ou encore la précarisation des métiers les plus féminisés sont autant de ressorts limitant la place des femmes dans la sphère professionnelle et leur émancipation économique. Ainsi, 82% des Françaises salariées estimaient en 2021 que les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes dans le monde du travail.
De surcroît, la crise sanitaire et les périodes de confinement ont eu un effet catalyseur sur ces disparités professionnelles et économiques avec par exemple une répartition des tâches domestiques plus inégalitaire en période de télétravail généralisé et des arrêts d’activités plus récurrents pour les femmes. La pandémie a aussi mis en lumière le manque de reconnaissance et la nécessaire revalorisation des métiers de première et seconde ligne, majoritairement occupés par des femmes et au cœur de la résilience de notre société. Comme le rappelle l’OCDE, à l’échelle mondiale, les femmes représentent 70% du personnel médical et de soutien et 85% du personnel infirmier des hôpitaux à l’échelle mondiale.
Dans ce contexte, la majorité des candidates et candidats à l’élection présidentielle reconnaissent l’égalité professionnelle comme un enjeu de société majeur. Il s’agit du sujet relatif aux droits des femmes le plus traité dans les programmes après la lutte contre les violences sexuelles et conjugales.
Lire aussi l #Femmes2022 : lutte contre les violences faites aux femmes, que prévoient les candidates et candidats ?
Cependant, le niveau de précision et d’ambition des mesures prévues diffère largement entre les différents partis. De la simple défense du principe d’égalité à la formulation de dispositifs complets pour assurer une égalité réelle, que prévoient les principaux candidates et candidats à l’élection présidentielle pour une économie du travail plus féministe ?

L’égalité salariale : un sujet relativement consensuel
Le sujet de la lutte contre les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes a été particulièrement mis en avant pendant le mandat du président actuel Emmanuel Macron, encore non déclaré à sa succession. L’une des mesures les plus médiatisées a été l’instauration de l’index d’égalité professionnelle par la loi sur l’avenir professionnel en 2018. Son calcul a été rendu obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés et a conduit à 300 mises en demeure et 11 pénalités financières début 2021. Bien qu’utile, cet outil a été jugé insuffisant et perfectible par de nombreux spécialistes sur certains aspects notamment l’absence de prise en compte des écarts d’augmentations individuelles et des temps partiels.
Les candidates et candidats de l’opposition sont plusieurs à proposer des mesures visant à pallier ces manques et à accélérer l’atteinte de l’égalité salariale. Le candidat Jean-Luc Mélenchon propose ainsi de renforcer les contrôles et les sanctions pénales pour les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale, et d’étendre cette obligation à toutes les entreprises (et non à celles de plus de 50 salariés). Yannick Jadot, quant à lui, prévoit d’étendre cette obligation aux entreprises de plus de 20 salariés et dans les administrations publiques. Les entreprises ne respectant pas cette règle s’exposeraient à une amende de 330 euros par jour et par employée concernée. Anne Hidalgo s’inspirant du modèle islandais propose de publier la liste des entreprises qui laissent perdurer les discriminations ainsi que de les pénaliser et préconise une “inversion de la charge de la preuve”, en faveur des salariés. La candidate socialiste propose également de conditionner toutes les aides publiques à un engagement formel des entreprises de respecter des critères sociaux dont l’égalité salariale femmes-hommes (principe "d'éga-conditionnalité"). De son côté, le candidat Fabien Roussel souhaite rendre l’égalité salariale effective dans les six premiers mois de la mandature dans la fonction publique et prévoit d’utiliser la méthode “CLERC” pour déceler les discriminations qui empêchent l’évolution des carrières des femmes. Le candidat Nicolas Dupont-Aignan propose la création d’un “label FH” et un allégement de cotisations pour les entreprises respectant l’égalité salariale.
Alors que 62% des salariés gagnant le SMIC sont des femmes (elles ne représentent pourtant que 42% de l’ensemble des salariés), plusieurs candidats s’engagent pour sa revalorisation : Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Christiane Taubira et Valérie Pécresse. A l’heure actuelle, seuls les quatre premiers candidats cités adoptent une lecture genrée de cette mesure et revendiquent ce levier comme bénéficiant en priorité aux femmes.
La question du plafond de verre, corollaire des différenciations de rémunération, n’est que très peu abordée par les prétendantes et prétendants à la présidentielle. La récente adoption de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle portée par la députée Marie-Pierre Rixain prévoit en ce sens la mise en place de quotas pour les cadres dirigeants ainsi qu’au Codir et Comex des entreprises, demande de longue date par les réseaux professionnels féministes. Le Haut Conseil à l'égalité a salué l’adoption de cette mesure mais regrette un délai d’application trop long et un seuil d’application fixé aux entreprises de plus de 1000 salariés.
Le congé parental et la politique familiale : des thèmes récurrents et plusieurs avancées récentes
Après des années de plaidoyers des associations et organisations spécialistes, le congé du second parent (aussi appelé “congé paternité”) a été allongé en France, porté à 28 jours en 2021. Cette réforme a plutôt été plébiscitée, bien que les 4 semaines restent en dessous d’autres exemples européens tels l’Espagne ou la Finlande. Du côté des candidats déclarés, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot souhaitent aller plus loin en alignant la durée du congé du second parent à celle du congé maternité, soit 16 semaines. La candidate socialiste souhaite que six semaines du congé du second parent soient obligatoires, et le candidat écologiste souhaiterait aller plus loin avec huit semaines obligatoires. Nicolas Dupont-Aignan propose la création d’un congé parental rémunéré à 75% du SMIC pour une durée de 9 à 36 mois, réparti entre les deux parents et un droit à la formation consécutif.
En matière de soutien à la parentalité, le candidat insoumis veut créer 500 000 places de garde pour les enfants sur cinq ans et créer un droit opposable à la garde. C’est également le cas d’Anne Hidalgo qui souhaite créer 130 000 places de crèches en dix ans. La candidate Valérie Pécresse défend également l’instauration de davantage de places en crèches et souhaite défiscaliser les pensions alimentaires pour le parent seul pour soutenir les familles monoparentales et particulièrement les femmes qui représentent 97% de ces familles. Si l’on revient sur le bilan du quinquennat actuel sur ce dernier sujet, on peut souligner la création depuis le 1er janvier 2021 d’un service public des pensions alimentaires qui prévoit le versement automatique de la pension par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) si l’ex-conjoint n’honore pas ses obligations. Par ailleurs, si le programme du futur candidat LREM n’est pas connu au moment de la rédaction de cet article, certaines propositions ont néanmoins été dessinée par le président, notamment la création d’un droit opposable à la garde permettant aux parents qui n’auraient pas de solution de garde d’être indemnisés pour avoir recours à la garde à domicile.
Lutte contre la précarité des femmes : un effet certain de la crise sanitaire sur les mesures proposées
A la lumière des enseignements de la crise sanitaire, les candidats et candidates se sont saisis du thème de la revalorisation des corps de métiers essentiels à la société qui sont majoritairement féminisés et précarisés. Les candidats Roussel et Mélenchon souhaitent revaloriser les métiers du soin qui sont particulièrement féminisés (aides-soignantes, sages-femmes), sur le plan financier mais aussi des conditions de travail et du statut. La candidate Taubira s’est également prononcée sur le sujet, jugeant nécessaire le recrutement de 100 000 soignants. Anne Hidalgo s’est aussi exprimée en faveur de la revalorisation des salaires “des métiers qui sont occupés par une majorité de femme”. À droite, seule la candidate Valérie Pécresse à ce jour a affirmé souhaiter également revaloriser financièrement des carrières infirmières et des sages-femmes. En outre, plusieurs candidats mettent en avant la réduction du temps de travail et notamment pour les métiers pénibles, notamment Mélenchon, Roussel et Hidalgo.
La lutte contre les contrats précaires et les temps partiels subis sont également identifiés comme un levier d’émancipation économique des femmes par certaines équipes de campagnes. Le candidat Mélenchon souhaite légiférer sur ce sujet en limitant par la loi les CDD et les contrats précaires : la limite serait fixée à 10% de CDD pour les grandes entreprises et à 5% pour les petites entreprises. Le candidat Roussel souhaite également la fin des temps partiels, et faire du CDI la norme. C’est également le cas de Yannick Jadot qui prévoit de favoriser le recours à des groupements d’employeurs pour favoriser les CDI et en limitant la contractualisation dans la fonction publique. La candidate Hidalgo veut mettre fin aux temps partiels subis.
Le sujet des retraites, de la fiscalité et des allocations sont également mis en avant comme levier de lutte contre la précarité des femmes dans certains programmes. Valérie Pécresse prévoit de porter une réforme des retraites dans laquelle l’accent serait mis sur les femmes qui n’ont pas pu avoir de carrière complète. L’équipe d’Anne Hidalgo appelle également à repenser la réforme des retraites au prisme du genre, critique en creux de l’agenda initial d’Emmanuel Macron sur le sujet. Les candidats Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira se sont exprimés en faveur de la déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) réclamée de longue date par les associations de défense des personnes en situation de handicap et féministes.
Ce qu’il manque et nos premières conclusions sur le volet égalité professionnelle et émancipation économique des candidates et candidats
De façon générale, les propositions apparaissent plus étoffées qu’en 2017 (voir notre précédent rapport “Femmes 2017”) notamment sous l’effet de la crise sanitaire. Quelques exceptions sont cependant à relever. Contrairement à la campagne de 2017, Marine Le Pen ne s’est pas exprimée à l’heure actuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Jean Lassalle et François Asselineau n’ont pas non plus communiqué sur le sujet. Le candidat Éric Zemmour a déclaré en 2021 que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes étaient quasi inexistantes et de surcroît causées par les choix professionnels des femmes. Ce discours, prononcé en 2022 par un candidat réunissant près de 15% des intentions de vote, montre que l’égalité professionnelle n’est ni acquise, ni universellement défendue.
Chez les autres candidates et candidats, la nécessaire résorption des écarts salariaux et la politique familiale sont ainsi les axes les plus développés. Nous notons également que certaines mesures économiques et sociales d'ordre général sont présentées comme un pas vers une plus grande égalité socio-économique entre les femmes et les hommes, telles que l’augmentation du SMIC. On peut se réjouir d’une place plus importante accordée aux analyses genrées dans les volets sociaux et économiques des programmes pour la présidentielle. Néanmoins, il faudra être attentifs à ce que ces potentielles réformes soient effectivement mises en œuvre et évaluées en prenant en compte leurs bénéfices réels sur la situation économique des femmes pour éviter tout risque de “feminist-washing”.
Certains sujets sont cependant absents des programmes présentés par les équipes de campagne. Par exemple, les quotas et la parité économique ne sont pas mentionnés malgré leur rôle efficace pour lutter contre les inégalités structurelles d'accès aux postes de directions. Pour rappel, en 2022, sur les 120 plus grosses entreprises françaises, seulement 14 sont dirigées par des femmes tandis que le CAC 40 ne compte qu’une femme à sa tête (elles seront deux avec la prise de poste de Christel Heydemann à la tête d’Orange en avril prochain). L’absence de mesure sur la représentation des femmes dans l’entreprenariat et dans les secteurs d’avenir, tel que le numérique, peut aussi être soulignée. Seules 5% des start-ups sont fondées par des équipes féminines, et les start-ups dirigées exclusivement par des femmes ont 30% de chance en moins d’être financées.
En complément des outils de nature quantitative, très peu de candidates et candidats présentent des mesures ambitieuses contre les biais culturels et stéréotypes de genres au travail qui constituent pourtant parmi les principaux freins aux carrières des femmes. On soulignera notamment le danger des discours essentialistes sur un management “féminin” ou sur une complémentarité des genres, ressort d’un nouveau sexisme au travail se présentant comme “bienveillant”. Comme le souligne la politologue Réjane Sénac, l’égalité notamment professionnelle ne doit pas être assortie de conditions de performance différenciée qu'impliquerait son genre. La formation et sensibilisation aux biais de genre en entreprise et la mise en place de mécanismes de sanction effectifs et proportionnés apporteraient de premières réponses vers une économie du travail féministe.
Cet article a été réalisé par l’association transpartisane Politiqu’elles dans le cadre du cycle de chroniques « Femmes 2022 » en partenariat avec Causette. L’association s’appuie sur l’analyse des programmes et déclarations des candidates et candidats ainsi que sur des auditions des responsables thématiques au sein des différentes de campagnes. L’équipe projet est pilotée par le binôme Sandrine Elmi Hersi et Agathe Hervey.
La présidente-fondatrice de l’association Fatima El Ouasdi, également élue LREM locale, n’a pas souhaité prendre part au projet compte tenu de ses engagements politiques actuels, afin de garantir la neutralité politique de l’analyse.
Dans un souci de transparence les membres de l’équipe du projet ont également tenu à partager leurs précédentes activités en lieu avec la politique. Agathe Hervey a été collaboratrice parlementaire d'Erwan Balanant (MODEM) jusqu'au 11 février. Sandrine Elmi Hersi a été collaboratrice de la députée Paula Forteza en 2020, ainsi que candidate lors des dernières municipales sur la liste Nouveau Paris (portée par Cédric Villani). Mathilde Lebon, également membre du projet, a participé aux primaires du parti réunionnais Banian en 2021.
Un premier rapport, “Femmes 2017”, avait été publié par l’association lors de la précédente campagne présidentielle. Plus d’infos : [email protected]