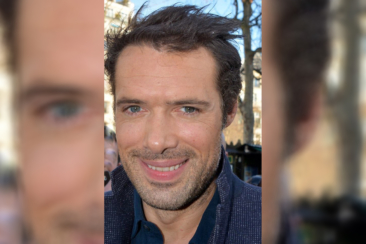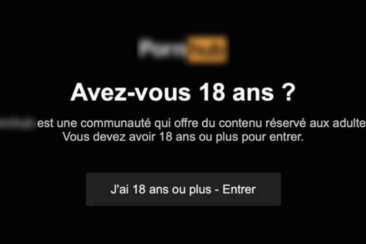Popularisé par le succès de l’émission Drag Race France sur France 2, l’art du drag, étendard de la communauté LGBTQIA+, questionne les normes de genre et séduit un large public, jeunes comme vieux et vieilles, hétéros et queers confondu·es. Alors que les performeuses fortes en gueule de l’émission partent en tournée triomphale à travers la France, retour sur ce phénomène feel-good.
Un dimanche d’août, une foule bigarrée se presse au bar À la Folie, dans le parc de La Villette (Paris 19e) pour assister sur grand écran à la finale de Drag Race France. L’organisatrice, la drag queen Minima Gesté, choucroute, faux seins pigeonnants et maquillage outrancier, commente en direct les épisodes avec une répartie savoureuse : « J’espère que vous avez passé un aussi bon été que moi à regarder des travelottes sur le service public ! » Les travelottes en question sont les drag queens qui se sont affrontées chaque semaine, cet été, dans cette compétition cathodique. Contre toute attente, le programme a fédéré jusqu’à 7 millions de téléspectateur·rices sur France 2. « C’est dingue ce qui s’est passé, commente le scénariste Raphaël Cioffi, qui a bataillé cinq ans pour importer et adapter cette émission américaine en France. J’ai 40 ans et je n’ai jamais vécu des moments qui ressemblent autant à une Coupe du monde pour célébrer la communauté queer. C’est comme le Mondial, sauf qu’il y a un but toutes les minutes. »
Club kids et comedy queens
On doit donc à France 2 d’avoir récemment popularisé le drag, performance artistique dans laquelle des hommes, généralement gays, se glissent, sur scène, dans la peau d’un personnage féminin exagéré jusqu’à la caricature. Devenir une queen implique de mobiliser toute une panoplie comprenant perruques, rembourrage, maquillage et costumes élaborés. Aux unes le bagout, aux autres l’outrance ou le mauvais goût : chacune a son style propre – il y a les reines de beauté, les club kids (fêtardes), les comedy queens (comiques)... « Mon personnage est une version libérée de moi-même, détaille Minima Gesté, performeuse bien connue des salles parisiennes, qui a postulé plusieurs fois sans succès pour participer à l’émission. Mon style est coloré et bruyant. Je fais 1,83 m, donc en talon et perruque j’arrive à 2 mètres facilement. Quand je me maquille, c’est pour qu’on me voie depuis le dernier rang ! » Femmes trans, personnes racisées, barbues, grosses... la communauté drag s’est également ouverte, au fil des années, à des profils variés.
La pratique du drag s’ancre dans une tradition française haute en couleur, celle du transformisme. « La France a été le pays qui a vu naître des cabarets connus dans le monde entier, dans les années 1940 à 1970, comme Madame Arthur, Michou ou Elle et lui », contextualise Paloma, gagnante de la première saison de Drag Race France. « À l’époque, précise-t-elle, ça ne s’appelait pas du drag, il s’agissait d’une culture du travestissement consistant à ressembler à des vedettes. » Cette scène riche en personnalités excentriques jusqu’au tournant des années 1990 tombe en désuétude à la fin des années 2000. Lorsque Paloma, Hugo Bardin dans le civil, emménage à Paris en 2009, elle déchante : « Le drag, c’était devenu hyper ringard, limite sordide et personne ne connaissait. À ce moment-là, dans le Marais [quartier gay parisien, ndlr], on voulait voir des mecs musclés, pas des hommes efféminés. »
Sofian Aïssaoui, journaliste et auteur du seul ouvrage
"Ce sont toujours des artistes qui jouent avec la féminité, mais leur style est plus déconstruit, il questionne le genre et l’identité"
français consacré au drag
L’heure est aux éphèbes bodybuildés plutôt qu’aux folles, remisées au placard. Journaliste et auteur du seul ouvrage 1 français consacré au phénomène, Sofian Aïssaoui découvre, lui, une scène drag parisienne en pleine mutation, en 2015 : à l’époque, aucun éditeur ne veut publier son livre sur le sujet. Il résume : « On considérait que c’était un sujet de niche très superficiel, pas sérieux. » Une nouvelle vague est pourtant en train d’émerger, par l’entremise de soirées parisiennes pétaradantes comme House of Moda et Jeudi Barré, organisée par Cookie Kunty, une participante à Drag Race France saison 2. Tout aussi frénétique, cette nouvelle génération change pourtant de ton : « Ce sont toujours des artistes qui jouent avec la féminité, mais leur style est plus déconstruit, il questionne le genre et l’identité », décrypte le journaliste. Surtout, ces performeuses suivent la voie, tonitruante, tracée par les Américaines de l’émission RuPaul’s Drag Race, diffusée chez nous sur Netflix et existant depuis 2009 aux États-Unis. Car, au même moment, la scène américaine est en pleine ébullition. Aux États-Unis, alors que le drag existe depuis le XIXe siècle et a pleinement participé aux mouvements pour les luttes des droits LGBTQIA+ dans les années 1960 et 1970, la scène connaît un renouveau inédit par le biais de la télévision.
Des “ballrooms” à RuPaul

Fringant sexagénaire afro-américain, ex-égérie de boîtes de nuit et interprète de quelques tubes reconverti en vedette cathodique, RuPaul anime alors avec panache Drag Race, établissant les principes d’une compétition entre drag queens. Sofian Aïssaoui contextualise : « L’émission est passée d’une petite chaîne LGBTQIA+ du câble, Logo TV, à VH1 puis MTV et est devenue un show diffusé mondialement, avec des stars de premier plan. C’est dingue comme parcours. » Le scénariste Raphaël Cioffi a découvert l’émission en vacances aux États-Unis : « J’ai eu un choc. C’est la première fois que j’avais l’impression de me voir à la télé : c’est-à-dire une personne gay flamboyante qui aime le divertissement ayant du sens. »
Ce concours émaillé de défis à réaliser (chant en playback, défilé de mode...) s’inspire d’une autre sous-culture voisine, la ballroom, née à Harlem (New York) dans les années 1920. Dans les années 1960 et 1970, il s’agit de soirées endiablées dans lesquelles des Afro-Américain·es queers s’affrontent, dansent et défilent sur la scène des clubs. « On ne peut pas parler du drag sans parler de la ballroom », confirme Sofian Aïssaoui. La gagnante de Drag Race France saison 2, Keiona, 31 ans, en est l’une de ses plus éclatantes représentantes dans l’Hexagone. Elle se souvient : « J’ai commencé à me mettre en drag dans la ballroom. J’avais découvert cet univers par pur hasard, en regardant une émission sur MTV, qui m’a donné envie. J’ai été là au tout début de la scène ballroom à Paris, j’ai commencé à m’entraîner et on était plusieurs à organiser des événements dans de tout petits endroits, dans des bars. Au début, on devait être quarante personnes. Maintenant, on remplit la Gaîté lyrique [salle de spectacle parisienne]. » Désormais à la tête de la très en vue House of Revlon (une « famille » ou équipe dans le jargon), elle avait déjà fait ses armes et représenté la France sur le plateau de l’émission américaine Legendary, consacrée au voguing, la danse pratiquée dans les balls.
Raphaël Cioffi, scénariste, à propos de l’émission américaine Drag Race
"C’est la première fois que j’avais l’impression de me voir à la télé : c’est-à-dire une personne gay flamboyante qui aime le divertissement ayant du sens"
Pendant ce temps, l’empire Drag Race s’est décliné à l’envi à l’étranger, de l’Espagne aux Philippines. En France, Raphaël Cioffi, le scénariste de Catherine et Liliane sur Canal+, élabore pour la production un « talent show » à la française, axé sur la mode, avec des personnalités bien de chez nous. Il s’amuse : « On a acheté la recette du hamburger, mais on le fait avec du pain bagnat et du foie gras. » Au casting, la présentation est assurée par Nicky Doll, ancienne participante à l’émission américaine, entourée d’un jury composé de la journaliste Daphné Bürki et du chanteur Kiddy Smile, avec d’autres invité·es de marque (Virginie Despentes, Zahia Dehar...). « On a été les premiers dans le monde à lancer une saison en linéaire sur le service public, l’impact est puissant », se félicite le scénariste. Succès surprise de l’été 2022, la saison 1 de l’émission était en effet, à l’origine, réservée à la plateforme pour jeunes adultes France TV Slash, avant d’être finalement programmée en troisième partie de soirée sur France 2, après Fort Boyard.
Les hétéros regardent aussi
Jeunes, vieux et vieilles, hommes, femmes, homos, hétéros se pressent ainsi devant leur petit écran, des paillettes plein les yeux. Yoann, jeune homme queer de 25 ans venu assister à la diffusion de la finale au bar À la folie « pour l’ambiance », se dit séduit par ces « artistes très complètes qui savent tout faire, chanter, danser, divertir ». Les jeunes de son âge, selon lui, dis- cutent volontiers de l’émission : ses parents, en revanche, la connaissent mais ne la regardent pas. Non loin de lui, Erika, hétéro de 39 ans, dit avoir été « happée » par la deuxième saison, son « mélange d’humour, d’émotion et de bienveillance. L’émission est très bien faite, estime-t-elle. Je ne suis pas une personne queer et pourtant j’y trouve des choses qui me parlent sur la famille, ou le fait de se sentir un peu à côté de la plaque ».
Un succès fédérateur, qui répond à une forte demande, longtemps négligée par les diffuseurs. « Moi, ce que j’ai ressenti, c’est que les gens avaient besoin de ça, analyse Sofian Aïssaoui. En France, en termes de représentation LGBT, on est à la ramasse. Drag Race change la donne et ça fait du bien. C’est une émission d’utilité publique qui répond à un besoin de la société. » Raphaël Cioffi confirme : « C’est plus qu’une émission, c’est une communauté qu’on montre rarement et rarement bien. » Entre chaque épreuve, les participantes s’épanchent ainsi face caméra, révélant violences et discriminations subies. « Tous les ven- dredis, la France entière a pu apprendre et comprendre les enjeux de la communauté LGBT : la séropositivité, les thérapies de conversion, les agressions, se félicite Minima Gesté. C’est l’essence du drag : militer en faisant la fête. »
Allié·es de la cause

gagnante de la saions 2 de Drag Race France, diffusé cet été.
Nicky Doll, mythique présentatrice du show, se rappelle que, quand elle pré- parait la saison 1 avec son équipe, elle se demandait : « Est-ce que la France est prête pour tout ce qu’on présente ? » Elle se réjouit aujourd’hui que l’émission ait réussi à atteindre toute sorte de public, bien au-delà de la communauté LGBTQIA+ : « Une mamie de 76 ans m’a écrit sur Instagram pour me remercier de lui avoir enfin apporté les outils pour comprendre ce qu’était une drag queen, mais aussi ce qu’était le mal-être qu’une personne queer pouvait vivre au quotidien. Il n’y a rien de plus fort que le divertissement pour ouvrir des débats et faire bouger les lignes. On a réussi à créer des conversations à travers du rire, des larmes, de la danse, du chant, du théâtre... Je pense que c’est beau et que c’est comme ça qu’on fait avancer des points de vue. » Le programme « participe plus largement à normaliser les vécus des personnes LGBT+, à les rendre accessibles », ajoute Cookie Kunty, participante de la saison 2.
Avant de poursuivre : « Les gens qui nous rejettent et ne veulent pas nous regarder ne le feront pas. Mais le public qui veut faire avancer les choses va se plonger dans l’émission pour en savoir plus et devenir un meilleur allié de nos causes. »
Forte de sa nouvelle notoriété, cette pratique artistique longtemps confidentielle suscite aujourd’hui des vocations et a occasionné une professionnalisation du métier. Certain·es, comme Paloma, ont débuté sur scène, au théâtre ou par la danse. D’autres ont bifurqué sur le tard, comme Keiona, qui fut d’abord vendeuse : « J’ai commencé le drag pour pouvoir travailler dans les magasins et faire de la vente haut de gamme, explique-t- elle. La professionnalisation est venue par le fruit du hasard, ce n’était pas prévu. » À la Fête de la musique en 2018, elle se produit à l’Élysée, devant Emmanuel Macron, aux côtés du chanteur Kiddy Smile arborant un tee-shirt au slogan mémorable, « Fils d’immigré, noir et pédé ». Minima Gesté, Arthur Reynaud dans le civil, 33 ans, était, quant à elle, ingénieure en colorimétrie. Arrivée à Paris en 2013, elle souffre de solitude et découvre la communauté drag par l’entremise de soirées LGBTQIA+. Elle se lance en regardant des tutoriels sur YouTube, jusqu’à quitter son emploi en 2022 et animer aujourd’hui des bingos, des brunchs et autres blind tests dans différents lieux de la capitale. Maquillage, perruques, costumes, Minima Gesté a acquis les rudiments du drag sur le tas :
« On apprend de ses erreurs : je ne m’étais jamais maquillée de ma vie, donc mes premiers looks étaient dégueulasses. Je ne sais pas coudre ou faire des perruques, mais il y a une énorme sororité entre drags : on se donne des astuces, on apprend au fur et à mesure... »
Sous les paillettes, la dèche
Si quelques rares queens ont reçu l’onction providentielle de l’émission de France 2, des centaines d’autres vivotent dans l’ombre, cumulent les jobs et souffrent de la précarité. Car, dans le domaine du divertissement, cette pratique artistique reste peu réglementée. « Parfois, les employeurs nous mettent dans la case animation, alors qu’on devrait avoir le même statut que les acteurs, regrette Paloma, qui a la chance d’être intermittente depuis des années. La plupart des lieux qui accueillent le drag sont des boîtes de nuit ou font de l’événementiel et n’ont pas accès à l’intermittence. » Sans compter, pour les heureuses élues, que participer à un concours télévisuel implique des sacrifices financiers importants : se libérer plusieurs semaines, voire quitter un emploi, ou encore financer l’achat de nombreuses tenues élaborées...

Le large succès de l’émission devrait pourtant, in fine, bénéficier à la communauté. Le journaliste Sofian Aïssaoui est formel : « Drag Race a changé la donne du tout au tout. » « En 2015, on faisait du drag pour sortir en boîte entre copines et se faire payer un verre, remarque Minima Gesté. Aujourd’hui, je vois la différence, je bosse beaucoup plus depuis Drag Race. Ça a permis de booster la scène drag. » La première saison, en 2022, a propulsé au firmament Paloma et ses performances riches en références intellos. Comblée, celle-ci croule depuis sous les projets et entame une tournée des grands ducs avec un spectacle en solo 2 : « J’ai fait des trucs que je ne pensais pas faire dans ma vie : aller à la Fashion Week, chanter... C’est Paloma qui m’a permis de les faire. En civil, je n’y aurais même pas pensé. » Tout aussi demandée, Keiona, son impériale successeuse, vient elle aussi de diffuser un single et, sans dévoiler ses projets, assure « courir partout ».
Désormais adoubée par une large audience, cette sous-culture de niche, longtemps réservée aux happy few, n’est toutefois pas immunisée contre le formatage. « C’est le risque, reconnaît Paloma, car Drag Race donne une certaine vision du drag adaptée au grand public. On peut perdre le côté politiquement incorrect et politique. C’est à nous de ne pas nous laisser acheter par le système. » D’autant que, en dépit de l’enthousiasme de fans frénétiques et dévoué·es, dans le cénacle artistique et le milieu du spectacle vivant, le drag continue de pâtir d’un certain mépris institutionnel. « Il est parfois difficile pour le drag d’être considéré comme un art et pas juste comme un hobby », regrette Paloma.
Cibles de l’extrême droite
Autre paradoxe : cette nouvelle visibilité de la communauté LGBTQIA+ n’a pas fait diminuer l’homophobie ambiante. Au contraire, elle a parfois attisé l’ire des conservateur·rices de tout poil : « Aux États-Unis, le drag est devenu énorme et tellement grand public qu’il est au centre des discussions politiques et ciblé par l’extrême droite, met en garde Sofian Aïssaoui. C’est devenu un bouc émissaire. C’est le revers de la médaille. » En France, des lectures de contes de fées à des enfants, organisées par des drag queens, ont aussi subi les attaques de groupuscules d’extrême droite, vent debout contre cette offense faite, selon eux, aux bonnes mœurs. « Quand je faisais des sketchs chez Quotidien [sur TMC], à une heure de grande écoute, je recevais des menaces de mort à la pelle, s’agace Paloma. Pour ces gens, un homo qui porte une robe, c’est forcément un pervers. »
Tandis que l’équipe de Drag Race France emprunte les routes de France et de Navarre pour une tournée triomphale 3, l’émission – dont la troisième saison reste à confirmer – a encore de beaux jours devant elle : pour preuve, la version originale américaine en est à sa... seizième saison, sans essoufflement en vue. « Vu le vivier de talents, c’est une émission qui pourrait durer très longtemps et va se renouveler naturellement », promet pour sa part le scénariste Raphaël Cioffi. « Le drag est amené à devenir de plus en plus populaire, le moment de bascule a déjà eu lieu », conclut Sofian Aïssaoui. Selon lui, l’avenir réserve également des surprises aux drags kings, ces femmes grimées en mâles, que l’on voit encore trop peu.