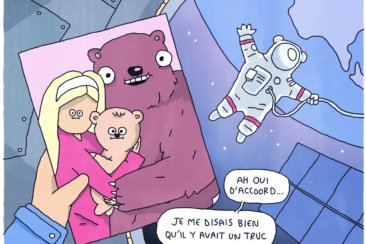La sociologue Ya-Han Chuang publie ce 15 avril Une minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-Asiatiques (éd. La Découverte). Derrière ce titre académique se cache un texte touchant, truffé de portraits de personnes d’origine chinoise en France, dont les histoires aident à mesurer l’ampleur du problème. À l’heure où se redéfinit la lutte antiraciste des communautés asiatiques et où émerge l’asioféminisme, la lecture est indispensable. Interview avec l’autrice.

Causette : Le titre de votre ouvrage peut paraître antinomique : vous parlez du terme « minorité modèle » pour dénoncer le racisme anti-Chinois et plus largement, anti-Asiatiques. En quoi cette image est-elle stigmatisante ?
Ya-Han Chuang : Le stéréotype de « minorité modèle » est commun pour désigner les personnes asiatiques dans les pays occidentaux. En France, Nicolas Sarkozy a ouvertement utilisé cette expression lors du Nouvel An chinois en 2010, en avançant que la communauté asiatique incarnait la « valeur travail », moteur d’une intégration réussie… À partir du moment où on utilise les origines ethniques ou raciales de quelqu’un pour le définir, c’est un acte de racialisation. Comme dire que les personnes asiatiques seraient forcément bonnes en maths, douées dans le business. Cela pose un danger : celui d’essentialiser un groupe. D’autant que ça crée une porte ouverte vers des stéréotypes bien plus stigmatisants : les personnes asiatiques seraient dociles. On entend parfois qu’elles ne s’exprimeraient pas et seraient donc sournoises, pas fiables.
Vous rappelez que le racisme anti-Chinois et anti-Asiatiques s’est révélé au grand jour au début de la crise du Covid-19. Cela a-t-il mené à une prise de conscience du phénomène dans la société ?
Y-H. C. : Oui. Et ce, à la fois chez les personnes asiatiques et du côté des pouvoirs publics, des médias et des organisations antiracistes. L’image de minorité modèle avait tendance à éloigner les personnes concernées du champ du militantisme. Ça occultait la possibilité d’être victime en faisant passer les agressions pour des événements exceptionnels, qu’on n’articulait pas avec la notion de racisme systémique. Depuis un an, il y a enfin une prise de conscience. Ça a même favorisé l’émergence d’une identité panasiatique, qui dépasse les frontières de la communauté chinoise et des autres, car beaucoup de personnes se sont identifiées comme victimes de la stigmatisation liée à l’origine du Covid-19. C’est ce qu’on a vu avec le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus.
Y a-t-il un racisme anti-Chinois et anti-Asiatiques spécifiquement français ?
Y-H. C. : L’histoire de la France en Indochine pèse dans l’imaginaire collectif et renforce l’image de docilité, de soumission des personnes asiatiques. On voit aussi que la France utilise la Chine pour défendre son modèle. En dénonçant le régime autoritaire chinois, il s’agit de s’affirmer en tant que démocratie. Mais cela implique que « Chinois = ennemis ». Ce raisonnement se retrouve beaucoup dans la presse hebdomadaire. Dans Le Point, Marianne ou L’Express, il y a régulièrement des couvertures sur les prétendus « dangers » de l’expansionnisme chinois. On l’a vu dans un autre registre, mais de manière très forte avec le Covid. Ces sous-entendus sont dangereux, car ils peuvent facilement remettre en cause le sentiment d’appartenance des Français d’origine asiatique et les pousser à « choisir leur camp ».
Dans votre livre, vous dressez le portrait de personnes vivant en région parisienne, au milieu d’une forte communauté asiatique, mais aussi de personnes vivant dans des petits villages de Normandie. En quoi le racisme du quotidien est-il différent en ville et en milieu rural ?
Y-H. C. : Dans les provinces, les personnes asiatiques sont souvent plus isolées. Ce sont des profils de commerçants individuels. Souvent, ils doivent passer du temps pour tisser une clientèle et convaincre les habitants de les accepter. Il faut plus de temps, mais souvent, ça finit par bien se passer. En Île-de-France, la très forte concentration spatiale renforce les fantasmes associés aux personnes asiatiques. Par exemple, dans le XIe arrondissement, près de Popincourt, on observe une grande présence de commerçants et grossistes chinois. Ça a renforcé l’idée « ils rachètent tout » et nourri l’imaginaire des « envahisseurs ».
De tous les portraits que vous rapportez, lequel vous a le plus touchée ?
Y-H. C. : Celui d’Ailing, dans les trois premiers chapitres. Ailing est née en 1965 en Chine et a perdu son mari à 33 ans. Elle est venue en France pour travailler et financer la vie de ses deux enfants. Elle a commencé comme domestique dans une famille d’entrepreneurs, dans une situation précaire, sans contrat. Elle se faisait licencier du jour au lendemain à cause de désaccords ou de disputes. Puis elle a commencé à travailler dans un salon de manucure géré par des patrons africains, dans le quartier de Château d’eau. À ce moment-là, elle vivait avec un petit-ami chez un couple à Aubervilliers. Mais son copain a été arrêté et renvoyé en Chine, car il n’avait pas de papier. Elle devait donc de nouveau se débrouiller seule. Je l’ai accompagnée dans quelques démarches légales, mais on s’est perdues de vue. Un jour, on m’a informée qu’il y avait une grève dans les boutiques de manucure à Château d’eau. C’était en 2014. Comme je faisais du bénévolat à la CGT pour aider les travailleurs chinois, je me suis demandé qui étaient ces femmes qui se mettaient en grève. Car il faut savoir que parmi les travailleuses sans papiers, certaines sont plus stables que d’autres : travailler dans un restaurant est la situation sans papiers la plus « stable ». La plus instable, là où l’on ne vous fournit aucune preuve de travail, aucune fiche de paie, là où on ne vous paie pas toujours le salaire, ce sont les salons de manucure. Je suis donc allée voir ces personnes en situation de vulnérabilité extrême. Et là, quand j’ai poussé la porte de la boutique, j’ai vu le visage d’Ailing. Je lui ai dit : « Si c’est toi qui as initié cette grève, ça ne m’étonne pas du tout ! » C’est une femme très courageuse, qui a un fort sens de la justice. Elles ont obtenu victoire.
On oublie la difficulté de ces parcours de migration en provenance d’Asie. Certaines personnes dont vous parlez, comme Pierre (le prénom français de Jiaming), ont fait six mois de route et ont été enfermées dans des caves au milieu de leur chemin, alors que les passeurs leur avaient promis deux semaines de trajet. Est-ce courant ?
Y-H. C. : Ça a été assez courant à un moment. Pour la Chine, entre les années 1980 et le début des années 2000. Les migrations se faisaient largement par des réseaux « en tête de serpent ». C’est-à-dire des organisations avec plein de ramifications, difficiles à tracer, par des voies non légales et très risquées. Aujourd’hui, la voie privilégiée d’immigration est celle du visa-cadre. Elle permet à des employés de rester sur le territoire après trois à six mois de délai. Mais il existe toujours des drames. Vous vous souvenez du conteneur en Angleterre, il y a deux-trois ans, dans lequel on a trouvé les corps de trente-neuf personnes vietnamiennes ? Voilà.
Le livre n’aborde que brièvement la sexualisation des jeunes femmes asiatiques, qui fait pourtant partie du problème. Pourquoi ce choix ?
Y-H. C. : Parce qu’il faudrait écrire un livre entier dessus. Je ne voulais pas n’en faire qu’un chapitre. Je me suis donc focalisée sur ma spécialité, qui est le monde du travail. Mais il est crucial de rappeler que les femmes asiatiques sont soumises à un regard masculin qui a tendance à les hypersexualiser d’une part et à une hiérarchie raciale qui les exclut du canon de beauté occidental d’autre part. Dans le porno notamment, les femmes asiatiques sont présentées comme des objets sexuels, parfois utilisées à des fins sadomasochistes. En matière de contrôle des corps des femmes asiatiques, on peut aussi parler du colorisme. On nous rappelle constamment que notre peau n’est pas suffisamment claire. J’ai grandi à Taïwan et j’ai passé ma jeunesse à acheter des crèmes éclaircissantes. Chaque année, quand j’y retourne, ma mère me rappelle d’utiliser de la crème solaire…
Qui pourrait incarner la lutte en France ?
Y-H. C. : Les acteurs les plus importants sont les assos comme Association des jeunes Chinois de France ou le comité Sécurité pour tous, constitué de personnes de la première génération. Sur les réseaux sociaux, c’est surtout Grace Ly [coréalisatrice du podcast Kiffe ta race avec Rokhaya Diallo et autrice de Jeune Fille modèle (éd. Fayard, 2018), roman sur la vie d’une adolescente de la seconde génération d’Asiatiques français, ndlr]. Sinon, il y la chanteuse Thérèse et le « Collectif Asiatiques Antiracistes », né depuis l’automne 2020. Il n’y a pas – encore – de grande figure comme Assa Traoré.
L’asioféminisme est-il une voie pour le militantisme de demain ?
Y-H. C. : C’est une voie importante. On résumait souvent le racisme anti-Asiatiques comme un problème de microviolences. L’émergence de l’asioféminisme depuis un ou deux ans permet d’inclure l’approche intersectionnelle. En plus, l’asioféminisme s’inspire beaucoup du black feminism, donc il permet d’opérer une convergence des luttes intéressantes. On peut s’informer à ce sujet en suivant le compte @Sororasie, un réseau d’aide entre femmes asiatiques. C’est sur ce genre de plateforme que l’on peut faire circuler des informations, transmettre des savoirs aussi. Si jamais j’ai un entretien d’embauche, je peux demander à des femmes du réseau, potentiellement recruteuses, de m’aider à faire un entretien blanc. Voilà comment on peut s’entraider. Sinon il y a aussi @Monfilsenrose, une personne adoptée qui recommande des livres pour enfants représentant le mieux les personnes asiatiques, en déconstruisant à la fois les stéréotypes de genre et de race.
Changer la représentation des personnes d’origine chinoise ou asiatique, cela passe-t-il par plus de présence dans l’art, le cinéma ? Ou y a-t-il d’autres moyens à privilégier ?
Y-H. C. : Je pense que c’est important d’en parler à l’école. On pourrait commencer par proposer des formations aux professeurs. Car c’est quand on est petit que l’on apprend à assigner la différence. Il faudrait enseigner où se situe la ligne de démarcation entre racialité et discrimination.
Finissons par analyser un gros cliché : celui du bar-tabac tenu par un·e buraliste asiatique. Vous expliquez dans votre livre que c’est un fort facteur d’intégration. Dans quelle mesure est-ce un commerce empouvoirant ?
Y-H. C. : Déjà, le fait d’avoir un statut d’entrepreneur est signe de mobilité sociale, pour ceux qui ont moins accès aux postes de travail classiques de la classe moyenne supérieure, comme cadre en entreprise. Ensuite, le bar-tabac est un secteur empouvoirant, car il permet de se débarrasser d’une dépendance au réseau de production chinois. Dans le commerce international avec la Chine, il y a beaucoup de facteurs difficiles à contrôler, comme le taux de change, le transport… Et puis ça ne correspond plus aux goûts des consommateurs, qui se tournent vers des produits locaux. Le bar-tabac est une stratégie plus sûre. Un commerce « essentiel » de proximité, qui permet de tisser des liens avec la population locale et de mieux s’intégrer. Petit à petit, ça change l’image collective des Asiatiques aussi. Symboliquement, le café-brasserie est important dans le mode de vie français. Comme le ticket de PMU… Les buralistes asiatiques à qui j’ai pu parler étaient extrêmement fiers d’apprendre à cuisiner des plats français, qu’ils n’auraient de fait pas pu proposer en ouvrant un restaurant chinois. Ce rapport de proximité est très touchant.