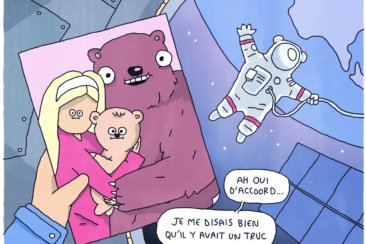S’assurer que l’autre est d’accord, respecter son refus sans insister. Le consentement sexuel est une notion encore loin d’être acquise. Et cela ne vaut pas que pour les hétérosexuels. Les lesbiennes et les bisexuelles peuvent aussi être auteures ou victimes de violences sexuelles. Et sur ce sujet, l’omerta est totale.
Elles étaient en couple depuis un an et demi quand Anaïs1, 24 ans, a été violée par sa partenaire. « Elle a commencé à me mordre, à me faire mal, elle m’avait coincé les mains dans le dos pendant qu’elle me touchait. Il y a aussi eu une pénétration digitale assez douloureuse », se souvient-elle. Sur son ventre et ses cuisses, des marques violacées témoignent de la brutalité de l’acte. Elle a demandé à sa partenaire d’arrêter, en vain. Face à cette personne « beaucoup plus forte physiquement », elle a fini par se résigner. « C’est affreux de dire ça, mais il y a un moment où tu arrêtes de te bagarrer, car tu sais que ça va se passer quand même. »
Une fois chez elle, Anaïs n’a pas réalisé tout de suite ce qu’il s’était passé. D’autant que les deux femmes, féministes, avaient souvent discuté du consentement. Comme beaucoup de victimes de violences sexuelles, elle a d’abord douté d’elle-même. Pour le Dr Muriel Salmona, psychiatre, le cas n’est pas rare. Le fait que l’agresseur ne soit pas un homme plonge ces femmes dans l’incompréhension et rend la violence plus difficile à identifier. « Pour elles, il y a, théoriquement, un terrain d’égalité au départ, qui rend les choses d’autant plus impensables. » Les patientes croient échapper aux « situations de domination habituelles », ajoute-t-elle. Des situations de domination qui peuvent aussi s’appuyer « sur des questions de génération, de classe, ou de racisation », explique Natacha Chetcuti, sociologue et auteure de Se dire lesbienne (éditions Payot).
Pour parvenir à leurs fins, les agresseurs, quels que soient leur orientation sexuelle ou leur genre, n’emploient pas forcément la force physique. Faire culpabiliser la victime pour organiser leur impunité est un grand classique. Nathalie *, 23 ans, a du mal à refuser certaines pratiques car elle craint que sa partenaire ne se sente pas aimée et désirable. Elle se souvient d’un soir où elle était exténuée et n’avait pas envie d’avoir un rapport sexuel. Sa petite amie du moment le lui a reproché. « Elle me disait qu’elle se sentait mal, et moi, j’ai pensé qu’en lui faisant l’amour je la consolerais. C’est stupide, hein ? Alors, je lui ai dit que j’étais d’accord pour faire l’amour, mais que je n’avais vraiment pas envie de faire un cunnilingus. Elle m’a répondu que c’était la seule façon pour elle de jouir. Quand elle a eu ce qu’elle voulait, elle s’est recouchée. Je me suis sentie comme un objet sexuel et j’ai fondu en larmes. »
Des victimes silencieuses
Un autre soir, alors que Nathalie se changeait dans les toilettes lors d’une soirée entre amis, sa partenaire lui a baissé sa culotte, sans son accord, pour lui faire un cunnilingus. Elle était tétanisée. « Elle me disait que j’étais “vraiment trop bonne” et me demandait si elle pouvait “me mettre un doigt”. Elle me disait : “Allez, juste un”, décrit-elle avec dégoût. J’ai fini par lui dire d’arrêter, arguant qu’il y avait du monde à côté. » Ce jour-là, Nathalie, qui se définit comme androgyne, avait décidé de jouer avec les codes de genre, « pour déconner ». Au début de la soirée, elle incarnait un « mec super macho », avant de changer de vêtements pour se mettre dans la peau d’une « femme super féminine ». Et c’est précisément au moment où elle s’est changée que l’agression a eu lieu. D’après elle, ce n’était pas une coïncidence : « Elle ne m’avait jamais parlé comme ça auparavant. J’étais dans une hyperféminité, elle m’a vue sous cet angle-là et ne m’a pas laissé le choix, parce que la société considère que les femmes sont là pour être prises. »
Nathalie ne s’est pas confiée à ses proches, qui sont pourtant « ouverts d’esprit », dit-elle. C’est souvent le cas des patientes de Muriel Salmona : « Il a fallu qu’elles se battent avec leurs proches pour faire accepter leur homosexualité. Alors, leur dire que les choses se passent mal, c’est impossible. Elles savent qu’elles ne seront pas écoutées avec bienveillance et se retrouvent piégées. » Beaucoup se taisent aussi pour protéger la communauté LGBT – lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s –, qu’elles estiment déjà « trop stigmatisée ». La plupart du temps, les lieux communautaires sont des espaces de sécurité, de protection et d’écoute pour les personnes LGBT. Les victimes redoutent que leur parole soit instrumentalisée par les masculinistes ou tout autre mouvement sexiste.
Crainte de l’homophobie
Quant au recours à la police, il n’est pas fréquent non plus : Chloé Boura, 29 ans, n’a pas osé porter plainte après avoir été violée par une « amie » : « La soirée avait été bien arrosée, avec usage de drogues, et j’ai pensé qu’on ne me croirait pas. » Une crainte légitime face aux policiers qui peuvent, trop souvent encore, considérer l’usage de stupéfiants ou la consommation d’alcool comme une circonstance atténuante pour l’agresseur, alors qu’aux yeux de la loi, il s’agit d’une circonstance aggravante, faisant passer la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans.
Anaïs non plus n’est pas allée au commissariat : « Il existe une fétichisation des femmes lesbiennes et bisexuelles. Je n’ai pas pu m’empêcher de me dire que le flic en face allait trouver ça cool et sexy. Je craignais que ça tourne en pugilat homophobe. » Par la suite, deux ex-compagnes de la femme qui l’avait violée lui ont confié avoir également été victimes de violences. « Si je l’avais su, je pense que j’y serais allée. Si on avait été deux devant un flic, ça aurait apporté du poids à mon récit, et il n’aurait peut-être pas vu ça juste comme une histoire de lesbiennes qui a mal tourné. »
L’une des craintes récurrentes des victimes, c’est que leurs viols, parce qu’il n’y a pas eu de pénétration pénienne, ne soient pas considérés comme tels aux yeux de la loi. Heureusement, l’article 222-23 du Code pénal, qui définit le viol, ne fait pas de distinction selon le genre ou le mode de pénétration. Le texte condamne « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». « La volonté de détruire l’autre » ou de le terroriser ne dépend pas du fait « de posséder un pénis ou pas », rappelle le Dr Muriel Salmona.
Une prise en charge essentielle
Ces femmes n’osent pas parler, alors que la verbalisation fait partie du processus de guérison. Pour repérer ces violences, les médecins ont un rôle à jouer : « Dans l’idéal, lorsqu’une femme va chez son médecin généraliste, il faudrait qu’il lui demande si tout va bien à la maison, car nous nous sommes rendu compte que, quand on pose la question, elles se confient », explique Hélène Kuntzmann, référente santé des femmes à la délégation territoriale Alsace de l’Agence régionale de santé Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Mais les lesbiennes et les bisexuelles font face, là encore, à une double difficulté : elles n’osent révéler ni les violences ni leur orientation sexuelle. Et rares sont les médecins sensibilisés à leurs enjeux de santé spécifiques. Certaines s’échangent les adresses de praticiens à qui on peut faire pleinement confiance.
Les travailleurs sociaux peuvent aussi être un recours, et des associations tentent déjà de traiter cette problématique. Ainsi le Groupe action gay et lesbien Loiret, domicilié au centre LGBT d’Orléans, qui a produit un flyer tiré à quatre mille exemplaires sur plusieurs types de violences, dont les violences sexuelles. Fières, une association lesbienne, bi, trans, a organisé une soirée thématique fin juin, à Paris, sur la santé, les risques liés aux pratiques sexuelles et le consentement entre partenaires. Le sujet est encore tabou, le nombre de cas révélés est faible et les associations n’ont pas vraiment de chiffres sur la question. On attend les résultats d’une enquête de l’Institut national d’études démographiques (Ined) sur les modes de vie, la santé et les situations d’insécurité des LGBT, qui seront dévoilés en 2017. Comme le rappelle le Dr Muriel Salmona, « moins on en parle, plus les victimes sont isolées et abandonnées face aux conséquences psychotraumatiques ». Il est donc urgent de dénoncer ces violences.
- Les prénoms ont été modifiés.[↩]