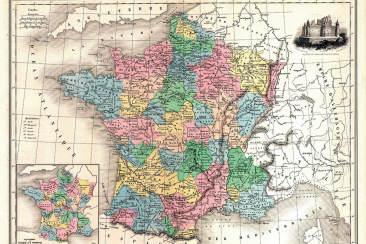Des milliers de sages-femmes se sont mobilisé·es ce jeudi 7 octobre à Paris pour dénoncer un manque de reconnaissance et demandent une revalorisation de leur salaire.
L'heure n'est plus au code rouge mais au code noir pour les sages-femmes. Depuis 12h ce jeudi 7 octobre, la place du 18 juin 1940 dans le quartier de Montparnasse à Paris est envahie par des sages-femmes. C’est le point de départ de cette journée de manifestation qui fait suite à une mobilisation qui a commencé le 24 septembre dernier. Dans la foule, les manifestant·es agitent des spéculums en plastique en guise de castagnette, ils·elles chantent Reconnais-moi, une version revisitée du hit de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi , la bonne ambiance règne malgré l'amertume qui les a poussé·es à s'emparer de la rue. De nombreuses pancartes affichent la colère des ces soignant·es : « La cup est pleine » ou encore « Véran m'a tué ». Plus que jamais, les sages-femmes ont décidé de ne plus rester dans l'ombre et de se battre pour que leur profession soit mieux considérée.
Véritable reconnaissance de la profession médicale

Ces dernières années, les sages-femmes ont multiplié les grèves et mobilisations pour faire entendre leurs revendications. Ils et elles se considèrent comme les grand·es oublié·es du Ségur de la santé du printemps 2020, qui avait abouti sur une revalorisation salariale des professions médicales - une augmentation, jusqu'à 1 010 euros brut par mois, selon l'ancienneté, de l'indemnisation des médecins de l'hôpital public et 183 euros net pour les para-médicaux et les sages-femmes de l'hôpital public, alors que celles-ci ont un statut médical. Ces dernier·ères ont dû attendre le 16 septembre dernier pour obtenir une augmentation de 100 euros brut des salaires dans le public, annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran. Une augmentation largement insuffisante pour Solène, sage-femme depuis 2 ans et demi à l’hôpital d’Eaubonne (Val d’Oise). « Ma première année, je touchais 1690 euros pour un bac +5 avec autant de responsabilités. Aujourd’hui, on tourne autour des 2000 euros mais c’est insuffisant, explique-t-elle. On ne demande pas grand chose mais quand il y a des Ségur, j'aimerais qu'ils cessent de nous considérer comme des paramédicaux, même je les respecte totalement. »

Les sages-femmes demandent à ce que leur statut médical soit reconnu. Actuellement, le code de la santé publique ne reconnait que trois professions médicales : les médecins, les dentistes et les sages-femmes, mais ces dernier·ères ne se sentent pas traité·es comme tel·les. Emilie est sage-femme depuis 20 ans et elle n'a constaté que très peu de progrès depuis. « Ça fait 20 ans qu’on demande la même chose : que notre statut médical soit aussi reconnu dans la vraie vie, on a l'impression d'être invisibles », estime-t-elle. Même constat chez les sages-femmes libérales. En plus du suivi des grossesses et du postnatal, ils·elles ont aussi des compétences gynécologiques. Depuis 5 ans, Leslie est sage-femme libérale et elle regrette le manque d'informations sur son métier. « J'ai eu des patientes qui sont venues pour des grossesses. Quand je leur expliquait que je pouvais aussi assurer leur suivi gynécologique, elles étaient hyper surprises, témoigne-t-elle. On est aussi là pour une meilleure reconnaissance de la santé des femmes. Qu’elles sachent qu’il n’y a pas que les gynécologues, on est aussi là pour elles. »
Des conditions de travail déplorables
Dans la foule de manifestant·es, Solène est venue accompagnée de plusieurs collègues. La jeune femme dénonce un réel manque de personnels qui compromet leur efficacité. « On veut vraiment plus d’effectif, c’est très difficile de garder le cap pendant nos gardes. Franchement, on met en danger la vie de nos patientes », déplore-t-elle. Souvent, la jeune sage-femme se retrouve avec 4 à 5 patientes à gérer la même nuit, une charge trop lourde selon elle : « Olivier Véran pense que nous ne sommes pas en surcharge de travail mais il a réellement tort. Qu’il vienne le constater lui-même ! » La surcharge de travail amène un nombre conséquent de sages-femmes vers le burnout. Une étude Collège National des Sages-Femmes (CNSF), réalisée en 2020, indiquait que 42,3% des salarié·es des établissements de santé, 31% des libéraux·les et 37,5% des enseignant·es ont souffert d’un burnout.

Des chiffres conséquents qui ont une incidence sur les étudiant·es en particulier. Oumi et Samrine sont deux étudiantes de l’hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine). Pour elles, les stages sont très vite devenus une source d’angoisse. « Souvent, quand on est en stage, on voit des sages-femmes en pleurs, en détresse. Du coup, on est utilisé pour palier le manque d’effectif alors qu’on est juste étudiantes », explique Samrine. En plus des stages, le volume de formation est souvent remis en cause. Le diplôme de sage-femme s'obtient au terme d'un bac+5. Après une première année de médecine, ils et elles suivent un cursus spécifique de 4 ans. Pour l'Association Nationale des Étudiant·es Sages-Femmes (ANESF), il y a une réelle nécessité de modifier les études. « Le volume horaire de formation est très important. Environ 1246 heures de plus, en comparaison aux autres filières médicales dont le cursus dure au minimum 6 ans », explique-t-elle dans un communiqué. L’ANESF, souhaite donc un allongement d'une année des études des sages-femmes. Pour l'association, cette organisation, jugée alarmante, est la cause d'un véritable mal-être chez les étudiant·es. Selon leur étude, « 8 étudiant·es sur 10 souffrent d’un stress accru depuis leur entrée dans la formation » et 7 sur 10 présentent des symptômes dépressifs.
Pour que leur conditions de travail s'améliorent, les sages-femmes revendiquent un statut spécifique, à l'image des dentistes qui ont, pour les manifestant·es, une situation que les sages-femmes méritent aussi. Mais pour l'heure, Olivier Véran n'a toujours pas envisagé publiquement un tel changement.
Lire aussi l Les sages-femmes en ont ras-le-bol