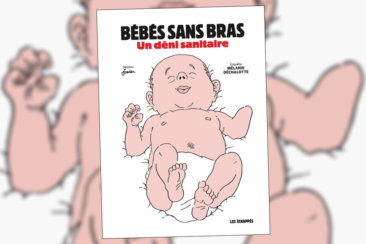Depuis 2015, ils et elles sont une poignée à s’être fait passer pour des victimes des attentats terroristes de Paris ou de Nice avec une méticulosité glaciale. Identification mythomaniaque, perversion morbide, appât du gain... les motivations diverses de ces imposteur·rices causent des ravages chez les véritables victimes.
Le parcours mythomane de Florence M. prend brutalement fin au matin du 13 février 2018. Lorsqu’elle est interpellée par les forces de l’ordre au domicile de sa mère où elle réside à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), les mensonges de cette quinquagénaire s’effondrent en quelques secondes comme un château de cartes. Le motif de son arrestation ? Escroquerie. Il faut dire que Florence M. trompe son monde depuis plus de deux ans maintenant, adaptant son discours à son interlocuteur. En février 2016, elle s'était présentée à la police comme rescapée du Bataclan, avait livré un récit détaillé et empoché 25 000 euros du Fonds de garantie d’aide aux victimes. Le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats qui avaient fait 131 morts dans Paris, c'est en qualité de proche d’une victime blessée lors du concert des Eagles of Death Metal qu'elle avait préféré intégrer la communauté des survivant·es du 13 novembre et de leurs proches. Mais voilà. Aucune des versions n'est vraie, Florence M. n'est victime ni directe, ni indirecte du terrorisme.
Le 13 novembre 2015, la France connaît l'attentat de masse le plus meurtrier de son histoire. Une nation entière est alors touchée de plein fouet par la tuerie perpétrée par un commando de l’État islamique. Quelques mois plus tard, la haine frappe à nouveau dans l’Hexagone. Cette fois, sur la promenade des Anglais à Nice, où un homme fauche au volant d’un camion 86 personnes le soir du 14 juillet. Beaucoup d’entre nous connaissent alors quelqu’un, qui connaît quelqu’un, qui était sur place ou aurait pu s’y trouver. « Cette proximité relative avec les faits que l’on ressent souvent est une impulsion universelle naturelle pour se raccorder à un événement traumatique, affirme la psychanalyste Virginie Ferrara. Mais certaines personnes vont plus loin. » Jusqu’à s'accaparer le statut de victime, être indemnisé·e à ce titre et même éprouver les mêmes symptômes que les vrai·es rescapé·es comme le stress post-traumatique, l'hypervigilance ou encore les troubles du sommeil.
Mythomane professionnelle
Florence M. est peut-être le cas le plus intéressant. La styliste est une mythomane professionnelle déjà condamnée à trois reprises pour escroquerie avant 2015. Ce 13 novembre, cette femme célibataire et sans enfant voit dans les attentats l'occasion de réitérer. Dès le lendemain, elle s'invente un ami grièvement blessé dans l'attentat, lui crée une page Facebook et rédige des dizaines de commentaires de soutien à l'aide d'autres faux profils. Un mensonge qui lui permet de se fondre totalement au sein de la communauté des survivant·es, au point de devenir l’une des responsables de l'association Life for Paris quelques mois plus tard. « Avec Life for Paris, Florence a trouvé une bande de potes, une famille. Elle s’est sentie utile pour la première fois de sa vie », précise à Causette Alexandre Kauffmann, auteur d'un livre-enquête qu'il lui a consacré, La mythomane du Bataclan, paru en mai 2021 aux éditions Goutte d’or.
Dès 2016, Florence M. est en effet chargée du recueil des témoignages des nouveaux·elles adhérent·es. Pendant des mois, elle va entendre leurs récits, jusqu'à connaître le déroulé des événements par cœur, minute par minute. Une plongée dans l’horreur qui lui permettra un peu plus tard de construire un mensonge solide auprès du Fonds de garantie. Plus loin dans l'aberrant, Florence sera même chargée de débusquer les menteur·ses parmi les personnes qui souhaitent entrer dans l’association. « N’étant pas une victime directe, sa démarche était très appréciée des membres, elle pouvait garder la tête froide », affirme Alexandre Kauffmann. Florence M. met en effet toute son énergie au service de l’association. Elle participe activement aux commémorations, organise des concerts, des soirées, devient un soutien sans faille pour les rescapé·es qui n’imaginent pas une seule seconde que la mythomane tient une autre partition auprès de la justice.
6 400 victimes d’attentats sont prises en charge depuis 2015 par le Fonds de garantie d'aide aux victimes
Florence M., donc. Mais aussi Alexandra D., Cédric R., Jean-Luc B., Laura O., Christophe T., Serge D., Audrey G., Sasa D. et sa compagne Vera V.… Au final, on compte plus d’une vingtaine de personnes qui se sont déclarées être des victimes ou des proches de victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre 2015 et de Nice en juillet 2016. À ce jour, vingt-et-une personnes ont été condamnées pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux témoignages par la justice française depuis janvier 2016. Seize pour les attentats du 13 novembre, cinq pour les attentats du 14 juillet. Des cas de fraudes marginaux, comparés aux 6 400 victimes d’attentats prises en charge depuis 2015, mais une question lancinante : qu’est-ce qui motive ces fausses victimes ?
Appât du gain
L’indemnisation financière est le premier enjeu de ces personnes, qui voient dans les attentats un moyen de « se faire » de l’argent facilement. Créé en 1990, le Fonds de garantie d’aide aux victimes indemnise l’intégralité des préjudices physiques et psychiques causés par des actes de terrorisme. Les victimes peuvent ouvrir un dossier auprès de l’institution dès lors qu’ils·elles sont inscrit·es sur la liste unique des victimes (LUV) établie par le parquet. Pour ce faire, un dépôt de plainte et une preuve de présence sur les lieux sont nécessaires. « Après le 13 novembre 2015, on a demandé à ce que le dépôt de plainte soit simplifié, indique à Causette Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de l’association Life for Paris depuis septembre 2017. C’était important de faciliter les démarches pour des victimes suffisamment traumatisées pour qui il peut être très douloureux d’entamer le processus judiciaire. Beaucoup n’ont d'ailleurs pas encore franchi le pas. » Meurtri·es dans leur chair et leur psyché, des centaines de survivant·es saisissent le Fonds dès la fin de l’année 2015.
C’est ainsi que des escrocs ont pu s'immiscer dans le flot. Et bien souvent, des personnes qui n’en sont pas à leur coup d’essai. Sasa D. et sa compagne Vera V., multirécidivistes, ont déclaré aux enquêteurs parisiens avoir été soufflés par une explosion le soir du 13 novembre au Stade de France (Seine-Saint-Denis). Un faux témoignage agrémenté d'un dépôt de plainte et d'un certificat médical qui leur permet alors d'empocher 60 000 euros. L’histoire aurait pu s'arrêter là et le couple mythomane ne jamais être mis en cause. Mais quelques mois plus tard, Sasa D. et Vera V. voient de nouveau dans le drame l'occasion d’assouvir leur soif de cupidité.
Quand les deux amants - qui vivent à Cannes - apprennent l’attentat de Nice le 14 juillet 2016, il et elle prennent immédiatement la route en direction de l’hôpital Pasteur de Nice pour se faire à nouveau porter comme victimes. Coïncidence inconcevable ou mensonge morbide ? Ce second dossier d’indemnisation met en tout cas la puce à l’oreille au Fonds de garantie qui fait part de ses doutes à la justice. Après enquête, le couple d’escrocs reconnaît les faux témoignages et est condamné à quatre et six ans de prison ferme le 19 avril 2017.
« Une victime peut refuser de se faire examiner par un expert et ainsi, elle ne touche qu’une somme forfaitaire. Dans ce cas, un escroc ne se fera jamais attraper »
Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de l’association Life for Paris depuis septembre 2017
Le Fonds de garantie d’aides aux victimes, interrogé par Causette, assure s’être « fortement mobilisé contre la fraude depuis 2016 et qu’il s’agit de cas marginaux ». Arthur Dénouveaux n’en est pas si sûr. « Une victime peut refuser de se faire examiner par un expert et ainsi, elle ne touche qu’une somme forfaitaire [baptisée préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme d’un montant de 30 000 euros, ndlr]. Dans ce cas, un escroc ne se fera jamais attraper. »
Un mensonge comme une deuxième peau
Au-delà de l'appât du gain, il existe un enjeu plus complexe, qui concerne, lui, le profil psychologique de ces mythomanes : certain·es d’entre eux·elles nourrissent une « obsession », selon les mots de la psychanalyste Virginie Ferrara, pour obtenir le statut de victime. Pour le comprendre, il faut s'intéresser au traitement des victimes d’attentat. « Auparavant les victimes du terrorisme étaient invisibilisées, souligne Gérôme Truc, sociologue spécialiste des réactions sociales aux attaques terroristes. Il faut attendre les années 1980 et le combat de Françoise Rudetzki [victime d’un attentat à la bombe en 1983 et fondatrice du Fonds de garantie des victimes, ndlr] pour que soit reconnu le statut de victimes civiles de guerre. Mais on a vraiment vu un tournant après le 11 septembre 2001. Les victimes ont alors gagné une centralité et une visibilité dans nos sociétés occidentales, ce qui peut approfondir une faille narcissique chez des gens qui veulent se sentir exister dans la collectivité, qui veulent d’une certaine manière être reconnus, sacralisés et peut-être participer à l’Histoire en disant “Moi aussi, j’y étais”. »
On a tous et toutes en mémoire la lecture douloureuse des portraits des victimes du 13 novembre 2015 publiés dans la presse pendant les semaines qui ont suivi les attentats. « Il y a une telle attente médiatique et sociétale autour des attentats terroristes que ces personnes ont également envie d’en faire partie, d’avoir eux-aussi de la “lumière” », poursuit le sociologue.
Car toutes les fausses victimes ne demandent pas d’argent. C’est même pour cela que leur nombre est difficile à quantifier : elles ne peuvent pas être poursuivies et donc recensées tant qu’elles n’ont pas tenté d’escroquer le Fonds de garantie. À l’image de Florence M., qui n’a pas tout de suite cherché à être indemnisée. « Ce qu’elle voulait au départ c’est être utile, appartenir à un groupe et ainsi rompre avec sa solitude », précise Alexandre Kauffmann.
Victimes de la vie
S’il existe une multitude de profils différents, ils et elles ont pour point commun d’être tous et toutes, des « victimes » de la vie. « Alexandra D., par exemple, a porté plainte vingt et une fois avant les attentats du 13 novembre, pour vols et agressions sexuelles, précise Alexandre Kauffmann. Elle a vu dans son mensonge un moyen d'être enfin reconnue en tant que victime. » Florence D., elle aussi, se considère réellement comme telle. Son enfance est marquée par un père absent qui quitte très vite le foyer familial et une mère dépressive. Elle enchaîne ensuite les désillusions amoureuses, complexée par un syndrome de Cushing qui rend son visage bouffi et lui fait prendre beaucoup de poids. Malheureuse, Florence M. tente même en 2012 de mettre fin à ses jours.
« J’ai seulement envie de dire à ces personnes, “Vas-y, prends ma place dans le couloir avec les terroristes” »
David Fritz-Goeppinger, victime du Bataclan
« Ce sont souvent des personnes qui se sentent mal dans leur corps et dans leur tête, elles ne sont pas heureuses, souligne le sociologue Gérôme Truc. Être enfin reconnues en tant que victime ou proche de victime par l’État et la société leur permet de réparer le préjudice du manque de reconnaissance et d’affection qu’elles ont connu toute leur vie. » Pour la psychanalyste Virginie Ferrara, « les fausses victimes ont des personnalités fragiles, ce sont des personnes souvent dépressives qui présentent pour la plupart des troubles de la personnalité et des troubles de l’attachement. S'inventer une vie est alors pour elles le seul moyen de sortir de leur réalité qu’elles trouvent trop fade à leur goût. » Une situation que l’on retrouve par exemple chez Audrey G., jeune femme qui prétend avoir été touchée au pied par une balle au Bataclan. Si elle n’a pas été poursuivie par la justice car elle n’a jamais tenté d’escroquer le Fonds de garantie, cela ne l’a pas empêchée de se promener la nuit autour du Bataclan seule avec sa fille de 5 ans et de raconter avec aplomb à un veuf qu’elle avait vécu les derniers instants de la femme de ce dernier, tuée au Bataclan.
Dégâts considérables
Véritable détresse psychologique, désir mortifère de se raccrocher à un drame national ou manipulation glaciale ? La frontière est floue. Reste que les dégâts, eux, sont bien réels pour les vraies victimes.« Avec leur mensonge, ils ont sali la mémoire des gens qui sont morts ce soir-là, déplore David Fritz-Goeppinger, lui-même otage du Bataclan. Le statut de victime, je ne le souhaite à personne. À ces gens qui nous ont trahis, j’ai seulement envie de dire, “Vas-y, prends ma place dans le couloir avec les terroristes”. » Le sentiment de trahison est d’autant plus fort que ces fausses victimes ont toutes gravité autour de l'association Life for Paris dès les premières semaines de sa création. « Elles ont fait irruption à l’intérieur même d’un sanctuaire où on essayait de se reconstruire à l'abri des regards indiscrets, rappelle le président de l’association, Arthur Dénouveaux. Toutes voulaient faire quelque chose pour aider, elles postaient de manière assez régulière sur les réseaux sociaux, participaient aux commémorations, à nos apéros-thérapies et donnaient également beaucoup d’interviews avec énormément de détails. »
À la différence des vraies victimes, les fausses cherchent en effet la lumière en permanence, notamment dans les médias. « On a vu une différence avec les vraies victimes qui ont souvent beaucoup de mal à s’exposer, soutient le sociologue Gérôme Truc. Quand elles ont raconté une fois, deux fois leur histoire, elles n’ont ensuite plus envie d’en parler pendant un moment. »
Ce n’est pas le cas d’Alexandra D.. Comme une grande majorité, la trentenaire est inscrite depuis 2016 sur la liste unique des victimes. Ce qui lui a permis de recevoir jusqu’à 20 000 euros de la part du Fonds de garantie entre janvier 2016 et mai 2017 ainsi que de bénéficier d'un coûteux séjour de reconstruction thérapeutique en 2016. Son visage a été aperçu dans les nombreuses interviews qu’elle a données à la presse jusqu'à son arrestation en 2018. Photographiée en novembre 2017 dans le cadre d'une dépêche de l’AFP sur les victimes ayant recours au tatouage comme « thérapie », elle exhibait d'ailleurs fièrement le sien, la devise de Paris Fluctuat nec mergitur (il est battu par les flots mais ne sombre pas) tatouée à l’encre noire sur le bras pour ne pas oublier cette nuit-là.
Le soir du 13 novembre, Alexandra D. prétend être à la terrasse du Carillon, l’une des terrasses parisiennes attaquée par le commando terroriste où treize personnes seront tuées. Aux journalistes, cette femme sans emploi n’hésite pas non plus à montrer une cicatrice sur son coude, vestige selon elle d'une balle de kalachnikov. Or, si Alexandra est bien une habituée des lieux, elle n’y était pas ce soir-là. C'est parce qu'elle n'a pas voulu faire examiner cette cicatrice trop nette – finalement liée à un accident de kitesurf – que la justice commence à douter de sa version. La jeune femme est condamnée à deux ans de prison dont six mois fermes pour escroquerie le 16 octobre 2018. À son procès, Alexandra D. affirmera comme pour se justifier : « Il était prévu que j'aille à la terrasse du Carillon. Mes plans ont changé, à vingt minutes près. »
Indécence
Au-delà d’afficher leur prétendue souffrance, ces mythomanes n’hésitent pas non plus à relancer compulsivement le Fonds de garantie pour percevoir leurs indemnités. Cédric R., ancien ambulancier de 29 ans a prétendu boire un verre au Bataclan café le soir du 13 novembre 2015. Comme Alexandra D., Cédric R. a même fait tatouer sur son corps la « douleur » de cette soirée représentée par une Marianne sur fond de Bataclan. La localisation de son téléphone portable démontrera lors de son procès en décembre 2017 qu’il était en réalité chez lui à une trentaine de kilomètres de Paris lorsque les terroristes sont entrés dans la salle de concert.
Mais en novembre 2015, l’urgence pour l’association Life for Paris n’est pas d’enquêter mais d'accueillir et d’accompagner les victimes. « On ne pouvait pas remettre en question la parole d'une personne qui raconte sa soirée du 13 novembre », se souvient Arthur Dénouveaux. Alors, lorsque Cédric demande des témoignages aux survivant·es pour constituer son dossier auprès du Fonds, ils sont plusieurs à appuyer sa demande. « J’ai rencontré Cédric en janvier 2016 à une commémoration, raconte à Causette, David Fritz-Goeppingher. Il est venu me voir en me disant : “Je sais qui tu es, je t’ai vu dans la ruelle quand tu étais suspendu dans le vide, accroché à la fenêtre”. Je ne me suis pas méfié et je l’ai cru. Peut-être car c’était important que quelqu'un légitimise ces faits que j’avais encore tellement de mal à croire. Alors comme un con, je lui ai répondu, “Ah, mais c’était toi le mec au tee-shirt blanc”. »
« Un jour, Cédric me demande d’écrire une lettre pour le Fonds de garantie dans laquelle je déclare l’avoir vu dans le passage Amelot le soir du 13 novembre, je l’ai fait. »
David fritz-Goeppinger, ancien otage du Bataclan
David ne le sait pas encore, mais il vient de mettre un pied dans l’engrenage mensonger de Cédric R.. Très vite, les deux hommes se rapprochent jusqu’à devenir amis. « C’était un mec sympa, il a même organisé un apéro chez lui où il a invité soixante personnes dont beaucoup de membres de l’asso. Je me souviens de son discours dans lequel il disait qu’il était très heureux de faire partie de notre communauté. » Cédric R. revient souvent sur les détails mortifères des attentats. Mais dans cette période où les rescapé·es ont plus que jamais besoin de bienveillance et de soutien, tous et toutes boivent ses paroles. Il parle même avec effroi d’une femme enceinte qui a pris trois balles juste devant lui pour le sauver… l’enquête montrera qu’aucune victime ne correspond à sa description. « Un jour, il me demande d’écrire une lettre pour le Fonds de garantie dans laquelle je déclare l’avoir vu dans le passage Amelot le soir du 13 novembre, je l’ai fait. »
Cédric R. fournit la lettre de David, des certificats médicaux et son Rib en mai 2016. Mais rien n’y fait, sa demande est rejetée, son dossier n’étant pas assez solide selon le Fonds de garantie. Cédric appellera alors l’organisme à dix-huit reprises avant d’être démasqué par la justice quelques mois plus tard. David tombe de dix étages lorsqu’il apprend que son ami est un menteur. « Je me suis senti trahi, manipulé et évidemment coupable d’avoir écrit cette lettre », affirme celui qui a dû écrire un « contre-témoignage » pour ne pas que sa propre parole soit décrédibilisée. Cédric R., de son côté, a été condamné à deux ans fermes dont dix-huit mois avec sursis en décembre 2017. À son procès, il déclare s’être vraiment considéré comme une victime, finissant par avouer presque à demi-mot qu’il « aurait aimé y être », sans expliquer les raisons qui l'ont poussé à ce geste.
Lorsqu’elles sont démasquées par la justice ou par les membres de l’association, ces mythomanes ne semblent pas voir le mal qu’elles ont pu causer. Durant son procès en mars 2018, Florence M. déclare ne pas comprendre pourquoi les membres de l’association Life for Paris lui en veulent, elle qui « consacre [sa] vie depuis 2015 à leur venir en aide ». Comme Cédric R., Florence M. a vraiment cru à son mensonge. « J’ai commencé à avoir les mêmes symptômes, à avoir peur des gens, à ne pas pouvoir aller dans certains quartiers, j’ai cru que j’étais une victime », assurera-t-elle à un expert psychiatre. Pour escroquerie et abus de confiance, Florence M. est condamnée en 2018 à quatre ans et demi de prison ferme.
Faire face aujourd'hui
Pour se protéger de potentielles fausses victimes, Life for Paris,, qui compte aujourd’hui 800 adhérent·es, multiplie désormais les vérifications auprès de ses membres. « Après avoir eu affaire à plusieurs cas, on a compris où étaient nos failles, déclare le président Arthur Dénouveaux. Après l’histoire de Florence, on a tous dû refournir des preuves de notre présence sur les lieux, ça nous a rassurés et, d’un côté, ça a même renforcé notre cohésion. » De son côté, le Fonds de garantie d’aide aux victimes assure à Causette concilier « la bienveillance, qui conduit à présumer la bonne foi des victimes, avec l’indispensable vigilance face au risque de fraude ».
Six ans après les attentats du 13 novembre, beaucoup de victimes ne se sont pas encore manifestées. Et alors que s’est ouvert, le 8 septembre, le procès-fleuve qui durera neuf mois et qu’elles devraient être nombreuses à se constituer parties civiles, une question se pose. Faut-il craindre que de nouveaux·velles usurpateur·rices se mêlent à elles ? Le président de Life for Paris se veut optimiste. « Nous ne sommes plus dans l’urgence de 2015, on est beaucoup plus vigilants aujourd’hui. Je ne pense pas que nous allons voir arriver de nouveaux faux témoignages, par contre on reçoit actuellement beaucoup de nouvelles adhésions et on espère que le procès donnera le courage nécessaire à celles qui ne se sont pas encore manifestées. »
Difficile reconnaissance des victimes
Si les personnes présentes au Bataclan ou sur les terrasses parisiennes sont automatiquement reconnues comme victimes des attentats de novembre 2015, il est plus compliqué de déterminer celles de l’attentat de Nice et donc d’y débusquer les mythomanes. « Avec Nice, on a une grande difficulté à déterminer le périmètre des victimes. On utilise la géolocalisation, mais il ne faut pas oublier que c’est une ville entière qui a été traumatisée ce soir-là », affirme le sociologue Gérôme Truc. 30 000 personnes étaient en effet présentes le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Pour faire preuve de leur bonne foi, les victimes doivent alors apporter des preuves de leur présence sur les lieux de l’attentat : témoignages, photos, données de géolocalisation, textos, certificats médicaux... « C’est toujours un véritable parcours du combattant de se faire reconnaître comme victime, 20 % n’ont pas encore touché d’indemnisation et lorsque de nouvelles victimes arrivent, c’est aujourd'hui très difficile pour elles de prouver qu'elles étaient là », témoigne d’ailleurs Jean-Claude Hubler, l’ancien vice-président de l’association des victimes de l'attentat de Nice, Promenade des anges.
Comment alors comptabiliser les victimes ? Sur quels critères considérer qu’une personne est une victime de l’attentat et quelle limite donner à la fonction de victime ? Le procès du 13 novembre 2015 a mis ces questions en lumière dès le deuxième jour d’audience, lorsque les juges ont refusé que plusieurs personnes se constituent parties civiles au motif qu’elles n’étaient pas directement présentes ou visées par les terroristes...