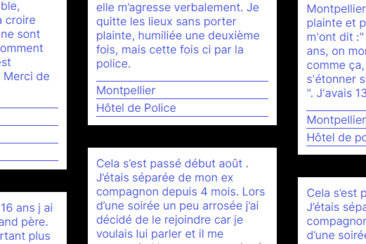Dans Nos absentes. À l’origine des féminicides, à la fois enquête et récit personnel, Laurène Daycard explore avec minutie le processus du féminicide. Nourri de témoignages de femmes « survivantes » ou de familles endeuillées, de chiffres et de réflexions de spécialistes, son livre est devenu une référence pour cette catégorie de crime.

Impossible pour Causette de consacrer ce hors-série aux « faits divers » sans aborder le sujet du féminicide. Car précisément, après qu’il ait fait les beaux jours de cette rubrique morbide, il est important qu’on l’en distingue désormais. Depuis des années, la journaliste Laurène Daycard enquête sur les crimes conjugaux et travaille dans ce sens, pour démontrer qu’ils dépassent de loin cette catégorie par leur caractère systémique et révélateur des choix politiques d’une société tout entière.
Causette : Pour quelles raisons ne peut-on plus aujourd’hui classer les féminicides dans la catégorie « faits divers » ?
Laurène Daycard : Parce qu’un fait divers, comme son nom l’indique, c’est un fait – en l’occurrence un meurtre – isolé. Or les féminicides, perpétrés dans un contextes intrafamilial ou non intime, sont des crimes systémiques, genrés, produits dans et à cause d’un contexte patriarcal. On distingue d’ailleurs des récurrences dans le processus qui y mène.
C’est l’une des autres particularités du féminicide par rapport aux faits divers meurtriers : ils répondent à un schéma systémique...
L. D. : En effet, ce qu’on peut aujourd’hui qualifier de « crime de possession » s’inscrit très souvent dans un scénario de contrôle conjugal, ou de contrôle coercitif. Un déséquilibre qui s’est installé au sein du couple et qui se développe en une prise de pouvoir de l’un sur l’autre et qui est fait de microrégulations du quotidien. Le sociologue américain Evan Stark a étudié ce contrôle, qui s’étend jusqu’au moment où il revient à décider qu’on peut s’octroyer un droit de vie ou de mort sur l’autre.
Quels sont les signes avant-coureurs ou qui doivent alerter de la mise en place de ce scénario ?
L. D. : Le harcèlement est récurrent, ainsi que des antécédents de violences conjugales connus par l’entourage ou par les services de police. On relève également que très souvent, le féminicide survient dans un contexte de séparation, avec un pic de risque autour des six mois suivant cette séparation.
« Ce qu’on peut aujourd’hui qualifier de "crime de possession" s’inscrit très souvent dans un scénario de contrôle conjugal, ou de contrôle coercitif »
Donc, ce sont des faits que l’on peut « repérer »...
L. D. : En effet, il y a plusieurs « alertes rouges » qui doivent avertir sur la possibilité d’un passage à l’acte de féminicide : le harcèlement, le contexte de séparation, les violences antérieures notamment les tentatives de strangulation, mais aussi des menaces de meurtre ou le chantage au suicide. Il n’est pas rare qu’un féminicide soit doublé d’un suicide. Les violences peuvent également se cristalliser au moment de la grossesse. Car le conjoint redoute cet enfant, qui va solliciter la mère et s’interposer dans le contrôle exercé sur elle. Le fait que ces alertes rouges, aujourd’hui bien documentées, ne soient toujours pas le signal systématique d’une action de la police ou de la justice pose la question de ce qui est fait pour protéger ces femmes. Cela renvoie à des questions politiques et sociétales.
La volonté politique pourrait passer par une mise en place de davantage de formation ?
L. D. : C’est une des solutions : la formation des personnels de justice et des travailleurs et travailleuses sociaux pour qu’ils et elles sachent repérer un scénario de violence conjugale. Le viol conjugal, les violences économiques, les violences psychologiques sont reconnus aujourd’hui. Mais l’accès aux preuves est compliqué. Il faut décrypter le quotidien, éplucher les comptes par exemple. Parfois, il n’y a pas de violence physique, il faut être attentif aux autres détails.
Les violences peuvent-elles n’être que psychologiques ?
L. D. : Oui, mais il ne faut pas croire qu’elles sont moins importantes. D’anciennes victimes m’ont dit que le pire, c’était précisément la torture psychique qu’elles avaient subie. L’une d’entre elles avait l’impression de devenir folle. Elle oubliait où elle avait mis des objets. Mais en fait, c’était son mari qui les cachait, pour la déstabiliser. Ou encore le cas de Madeleine dont le mari coupait le gaz en partant, la forçant à vivre dans une maison magnifique, mais glacée. Tout en lui offrant des cadeaux d’apparat pour la faire briller à son bras lors de sorties. Car le processus des violences conjugales se produit dans toutes les classes sociales, à égalité.
« Les violences psychologiques ne sont pas moins importantes. D’anciennes victimes m’ont dit que le pire, c’était précisément la torture psychique qu’elles avaient subie »
En dehors de ces « crimes de possession », quelles sont les autres typologies du féminicide ?
L. D. : La première est apparue pour les meurtres de Ciudad Juárez, au Mexique, théâtre d’un féminicide de masse. La sociologue mexicaine Julia Monárrez Fragoso, du Colegio de la Frontera Norte, qui a étudié ces cas, parle bien de meurtre intime, dans le milieu familial, mais aussi de meurtres concernant des professions « stigmatisées » comme les travailleuses du sexe de Ciudad Juárez, et également des féminicides systémiques sexuels. Pour ces derniers, on remarque souvent des corps non identifiables, car trop torturés. Cette typologie peut faire écho au féminicide des yézidies par l’État islamique. En France, ça serait la typologie des affaires de tueur en série.
Vous dites que si l’on se penche sur le traitement des féminicides dans les médias, on distingue des différences par rapport à la façon dont on relate les faits divers en général...
L. D. : C’est un fait, le traitement médiatique des féminicides est bien particulier. En France encore, certaines femmes victimes, qu’importe le contexte du féminicide, n’ont même pas droit à une certaine forme d’humanité : on ne donne pas leur identité, il n’y a pas d’enquête sur elles, leur mort est déconnectée des problèmes sexistes et sexuels qui les entourent. Le problème de cette déshumanisation, c’est qu’elle surplombe les faits, relatés comme s’ils étaient exceptionnels et qu’ils « n’arrivent qu’aux autres ». Et par ailleurs, c’est précisément le mécanisme des violences conjugales : une déshumanisation de l’autre.
« L’état se révèle incapable de protéger la vie de ces femmes et s’inscrit dans un climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles »
Autre écueil, la façon dont on peut faire des violences conjugales un récit romantique, « un drame de l’amour » ou une histoire de passion...
L. D. : Oui, la romanticisation est encore fréquente, et c’est un travers spécifique aux violences conjugales – ces « crimes passionnels » ou ces « drames de la séparation ». Parfois, on rapporte aussi des détails privés. Le meurtre de Géraldine Sohier 1, dont je parle dans mon livre, a été « illustré » dans un journal par la photo de mariage du couple. On peut relever aussi une certaine empathie pour le meurtrier, comme on a pu le voir dans l’affaire Cantat. On peut encore lire des phrases du genre « Il a été poussé à bout »...
Le scandale de ces crimes, c’est que dans bien des cas, ils pourraient être évités. C’est pourquoi on peut parfois les requalifier en crime d’État ?
L. D. : L’État se révèle incapable de protéger la vie de ces femmes et s’inscrit dans un climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles qui, parfois, n’impose pas assez de barrières aux hommes. En France, nombreuses sont les victimes qui tentent de porter plainte, mais que l’on décourage, ou encore que l’on ne prend pas au sérieux. L’exemple de Razia Askari à Besançon est édifiant. Elle dépose six plaintes pour finalement s’entendre dire que « Monsieur veut juste voir ses enfants »... Il finira par la tuer de dix-neuf coups de couteau.2 On peut se demander, légitimement, à quel moment la parole de ces femmes est entendue, crue et suivie d’application.
- Géraldine Sohier, 49 ans, a été tuée en 2016 au fusil de chasse par son mari, qui s’est ensuite suicidé, dans la bibliothèque de Villers-Allerand (Marne) qu’elle tenait parmi ses activités associatives, notamment au service des enfants de la commune. C’est leur fille de 9 ans, présente sur les lieux, qui est allée chercher de l’aide auprès d’une voisine (source : L’Union, 13 octobre 2016). [↩]
- Rashid Askari a été condamné en appel en 2022 à trente ans de réclusion criminelle avec vingt ans de sûreté pour l’assassinat de son épouse, Razia Askari, 34 ans et mère de leurs deux enfants, qu’il a poignardée en pleine rue à Besançon (Doubs) en 2018.[↩]