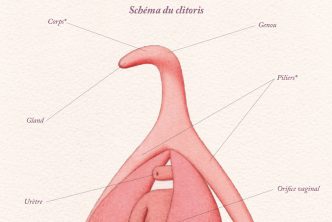Si le chemsex reste majoritairement pratiqué par les hommes gays, une étude montre qu'elle se répand aussi chez les hétéros, hommes ou femmes, les femmes lesbiennes et les personnes non-binaires. La dernière étude consacrée au phénomène avance que 80% des chemsexeur·euses présentent un fort risque d'addiction.
Sea, sex and chems. Derrière le nom sucré de l'étude réalisée par les hospices civils de Lyon, le centre de soins en addictologie villa Floréal d'Aix-en-Provence et l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) et présentée mercredi 24 novembre à Paris, se cache une réalité inquiétante. Poussées par la facilité avec laquelle il est possible de se procurer les drogues de synthèse sur internet pour presque rien, de plus en plus de personnes s'adonnent à la pratique du chemsex (pour « chemical sex », qui désigne le fait d'avoir une relation sexuelle sous stupédiant) et 80% des 1196 personnes ayant répondu à l'étude menée entre mars et juillet derniers présentent « des risques notables d’addiction aux substances ». Sea, sex and chems montre, de la même manière, que le risque d'addiction à la sexualité est trois fois plus élevé chez les chemsexeur·euses que chez les autres.
Autre enseignement de l'étude : le chemsex est loin d'être cantonné au milieu gay masculin. Proposé dans des centres de soin mais aussi en ligne via les réseaux sociaux, le questionnaire a permis de toucher des personnes concernées dans d'autres milieux. C'est ainsi que l'étude démontre que des hommes hétéros mais aussi des femmes, hétéros ou lesbiennes (l'ensemble du groupe femmes représente même 16,5% de l'échantillon de chemsexeur·euses étudié) et des personnes non-binaires se sont elles et eux aussi ouvert·es à la pratique.
Etant donné l'état de souffrance et d'addiction de la majorité des chemsexeur·euses interrogés, les professionnel·les de santé à l'origine de ce travail concluent à l'urgence d'une prise en charge globale - y compris par un·e sexologue. Ils et elles recommandent aussi que co-existent à la fois des espaces de soin dédiés aux chemsexeurs issus de la communauté gay masculine et des espaces accueillant l'ensemble de la population touchée par le phénomène. Entretien avec Dorian Cessa, docteur et coordinateur de Sea, sex and chems.

Causette : Quels grands enseignements tirez-vous de votre étude ?
Dorian Cessa : En décentrant la problématique du chemsex de la seule communauté des hommes homosexuels, on peut observer un début de diffusion dans d’autres communautés. Jusque là, il n'existait pas d'étude française prenant en compte les populations hétéros ou lesbiennes. Aujourd'hui, nous pouvons donc démontrer que le chemsex n'est pas réservé aux hommes gays et d'ailleurs, la majorité des femmes qui ont répondu au questionnaire sont hétérosexuelles.
Notre méthodologie nous a aussi permis d'observer que le risque d'addiction est largement répandu. 80% des répondants ont déclaré des comportements qui nous laissent à penser à des risques d'addiction (je parle de risques et pas d'addictions avérées puisque notre étude repose sur du déclaratif, via un questionnaire en ligne, et que nous n'avons donc pas observé cliniquement ces personnes). Or, seuls 13% des répondants avaient été recrutés dans un espace médical ou hospitalier dans lequel ils se présentaient pour des problématiques liées au chemsex. Cela veut donc dire que, même éloignés d'une prise en charge médicale, les chemsexeurs présentent des problématiques de santé liées à leur pratique, ce qui est préoccupant.
"J’ai vu débarquer dans le sud des patients qui ont déménagé parce que c’était pas possible pour eux de se sortir de ce cercle en restant à Paris."
Votre étude s'intéresse aux addictions aux drogues mais aussi à l'addiction à la sexualité. Qu'est-ce que c'est ?
D.C. : Qu'on l'appelle addiction comportementale sexuelle, hypersexualité ou trouble sexuel compulsif (terme qui va en janvier prochain dans la Classification internationale des maladies), il s'agit d'une entité clinique dont les médecins addictologues et les psychiatres parlent depuis longtemps mais pour laquelle coexistent plusieurs définitions.
On considère qu'il y a addiction sexuelle lorsque la consommation de sexe est source d’une altération du fonctionnement global comme l'incapacité à respecter les impératifs de la vie, par exemple aller au travail ou aux repas en famille. C'est lorsqu'il y a un impact sur le vécu social car on passe trop de temps à rechercher ou avoir une relation sexuelle et que le sexe est une source de souffrance, pas forcément au moment de l’acte mais parce que sa place déborde dans notre vie. Cela n'a donc rien à voir avec le fait d'avoir beaucoup de partenaires différents mais avec, comme pour les autres formes d'addiction, une satisfaction plus basse dans l'acte que la moyenne des gens et donc la nécessité de s'y adonner très souvent pour tenter de la combler.
On sait aussi que les chemsexeur·euses rencontrent à terme une difficulté à avoir des relations sexuelles sans drogue...
D.C. : C’est en effet la grosse problématique des personnes qu’on voit dans le cadre de l’addiction. Très rapidement après qu’on s’est lancé dans ces pratiques-là, le retour à une sexualité sans produit est extrêmement compliqué. Ce qu’on observe souvent, au moins de manière transitoire, c’est un désinvestissement complet de la sexualité pour les gens qui veulent vraiment arrêter le chemsex et qui du coup retrouveront très difficilement les sensations qu’ils ont eu sous produit, et même si avant le chemsex, ils avaient une sexualité satisfaisante.
Cela reste possible, mais au prix d'une prise en charge assez lourde, qui durera non pas six mois mais plusieurs années. D'où la nécessité de consulter un sexologue ou un professionnel de santé qui sache prendre en compte cette dimension-là.
Cela demande aussi un grand investissement du patient car il faut se mettre à l’écart des tentations. C’est très dur de sortir du chemsex, parce que quelqu'un d'addict a resserré son entourage social sur d'autres usagers. J’ai vu débarquer dans le sud des patients qui ont déménagé parce que ça n’était pas possible pour eux de se sortir de ce cercle en restant à Paris.
"Les antécédents de violences sexuelles sont un facteur de risque accru d'entrée dans la pratique du chemsex."
Quels sont les facteurs de risques d'entrée dans le chemsex mis en avant par l'étude ?
D.C. : En ce qui concerne les hommes homosexuels, notre étude confirme que le chemsex était particulièrement présent dans la population séropositive au VIH, dans un contexte actuel où, fort heureusement, la prep limite le risque de contamination. Cela peut s'expliquer par le rejet que vivent encore les personnes séropositives : elles seraient poussées au chemsex parce qu'il permet de débloquer une certaine forme de stress et d’anxiété et probablement qu’on peut avoir des partenaires plus facilement avec des produits, dans un contexte d'orgies.
On note aussi la pression des pairs via les applis de rencontre.
En ce qui concerne les femmes, notre travail montre que les antécédents de violences sexuelles sont un facteur de risque accru d'entrée dans la pratique du chemsex. Notre étude a ainsi montré que si 60% du groupe témoin de femmes non chemsexeuses déclarait avoir subi des violences sexuelles (ce qui est déjà énorme), elles sont 80% chez les chemsexeuses. Et je me demande : si on avait bien pris en charge ces traumatismes, aurait-on autant de chemsexeuses ? Idem pour les expériences de sexe tarifé : celles qui l'ont déjà pratiqué ont 3,5 fois plus de risques de devenir accros aux drogues dans un cadre sexuel, ce qui est énorme.
Enfin, on note aussi un antécédent féminin aux anxiolytiques. On peut donc dire d'une part que les femmes qui ont eu besoin d’anxiolytiques dans leur vie sont plus susceptibles de se tourner vers le chemsex, et d'autre part, que ce sont des molécules médicamenteuses avec lesquelles on peut très rapidement tomber dans une addiction et qui donc prédisposent à quelque chose.
Vous êtes-vous intéressé·es à la question du consentement lors de la pratique du chemsex ?
D.C. : Non car notre questionnaire était déjà très long. Mais il y a peu, une étude très intéressante allemande s'est penchée sur la santé mentale des chemsexeurs. Elle contient un chiffre marquant : 3 à 4% de leur panel a confessé avoir eu un comportement comparable à une agression sexuelle sous l’influence des produits. S'il y a des agresseurs, il y a forcément des agressés.
D'une manière plus générale, j'ai reçu en consultation des personnes qui étaient d'accord pour participer à une soirée mais qui, après vingt-quatre heures d'orgie, ont pu être embarqués dans des pratiques sexuelles pas forcément cohérentes avec leurs personnes ou dans la prise d'une certaine quantité de drogue qu'ils ne voulaient pas. Concernant la drogue, cela représente tout de même 20% du panel de chemsexeurs de notre étude.
"Dans l’absolu, il peut y avoir des individus qui ont une petite passe chemsex deux trois fois pendant six mois et qui passent à autre chose. Mais cette autorégulation est difficile."
Le chemsex heureux ou du moins raisonné vous semble-t-il impossible ?
D.C. : Ce serait prétentieux de ma part de dire non, d'ailleurs, note étude montre que 20% des personnes que nous avons interrogées ne sont pas dans des logiques addictives. Là où je nuancerais, c’est que les nouveaux produits de synthèse (NPS) utilisés sont à très haut risque addictif.
Dans l’absolu, il peut y avoir des individus qui ont une petite passe chemsex deux trois fois pendant six mois et qui passent à autre chose. Mais cette autorégulation est difficile. Je ne veux pas être ultra alarmiste, il ne s'agit pas d'héroïne ou de crack mais j’ai quand même l’impression que la majorité des gens ne s’en sort pas complètement indemne.
Quel message voulez-vous faire passer ?
D.C. : Je pense qu’on ne peut pas prendre correctement en charge quelqu’un qui souffre du chemsex sans sexologie. La majorité des Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) historiques ont été créés sur les sujets de drogues par intraveineuse mais n’ont pas l’habitude des molécules prises dans le cadre du chemsex, ni des questions de sexualité. Nous avons besoin de soins communautaires pour les hommes gays mais aussi pour les autres populations touchées.
Aujourd'hui, si mon planning de soin est complet, j'aurais du mal à orienter une femme ou un homme hétéro qui viendrait consulter pour addiction au chemsex.
La Ville de Paris se mobilise pour limiter les risques
C'est à l'appui de l'étude Sea, sex and chems et d'une autre menée par la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques (MMPCR) que la Ville de Paris a annoncé une série de mesures pour une meilleure prise en charge des pratiquant·es du chemsex. Alors que le chemsex a été responsable d'au moins 24 morts entre 2008 et 2017, l'urgence est à la minimisation des risques.
« Il faut absolument éviter la stigmatisation et la moralisation, ce sont les pires ennemis de la prévention », a rappelé lors d'une conférence de presse mercredi 24 novembre Jean-Luc Romero-Michel, adjoint d'Anne Hidalgo. Au programme : une sensibilisation au phénomène auprès des autorités de santé, des associations et de la police, de manière à coordonner les actions. Et la mise sur pieds, dans les semaines à venir, d'un comité stratégique de suivi de la question.