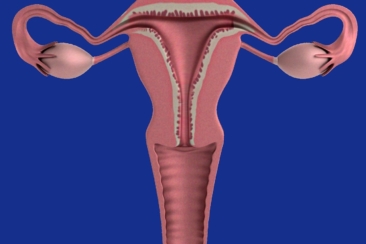Explosion du port de Beyrouth, tremblements de terre, crise économique… Au Liban, les traumatismes s’enchaînent et ravivent le souvenir de la guerre. En quelques années, la santé mentale est devenue une urgence nationale à laquelle l’État, défaillant, est pourtant bien incapable de répondre. À mesure que le tabou se brise, les associations et les citoyen·nes s’organisent.
Voilà trois jours que Tamara souffre de tachycardie. « Mes nouveaux anxiolytiques me donnent des palpitations et m’empêchent de dormir », confie-t-elle, agitée, en tapotant sa poitrine. La coach sportive a 33 ans, les cheveux bouclés noir de jais, de la gravité dans le regard, une veste en jean délavé sur le dos. « Je suis, comme tout le monde, en mode survie. » Depuis quelques années, la jeune Libanaise lutte contre une dépression, des idées suicidaires et des crises d’angoisse à répétition. Les guerres successives, l’explosion du port, la pandémie de Covid et la crise économique ont instillé chez Tamara, comme chez une bonne partie du peuple libanais, une anxiété généralisée. Près de 40 % de la population souffrirait aujourd’hui d’un trouble psychologique, soit quatre fois plus que la moyenne mondiale. « Les gens vont mal, et la situation ne cesse de se dégrader. Il y a un avant et un après 2019 : la crise économique a tout changé », déplore Tamara. Gangréné par l’inflation et la précarité, le Liban manque cruellement de structures, de médicaments, de personnel soignant. Voilà également bientôt sept mois qu’il n’a plus de président. Alors que la question de la santé mentale est sur toutes les lèvres, psychiatres et psychologues désertent le pays, laissant dans leur sillage des cabinets vides et des files d’attente à rallonge.

les crises d’angoisse et se dit en « mode survie »
(© SARAH ANDERSEN)
Quand le centre el-Rahma a ouvert ses portes à Tripoli, le 15 septembre dernier, Tamara était la première à patienter devant l’entrée. « Je cherchais désespérément de l’aide depuis des mois. J’avais contacté quinze psychologues, ils étaient tous complets… Et surtout trop chers. » Il faut dire que l’établissement, en dispensant un suivi psychologique et des médicaments gratuits, fait figure d’exception. Ses façades blanches tranchent avec les bâtiments décrépis du vieux centre-ville. Une telle structure n’aurait pu voir le jour sans l’aide de fonds internationaux 1, devenus indispensables pour pallier les carences du système de santé libanais. Depuis quelques années, les organisations non gouvernementales et les associations locales redoublent d’efforts pour compenser ce que l’État, défaillant, n’est plus en mesure d’assurer. Stéphanie Bou Gebrayel, psychologue du centre, se souvient de ses premières années passées à exercer. « On me disait que j’étais le docteur des fous. Notre métier était stigmatisé, alors qu’aujourd’hui c’est peut-être le boulot le plus demandé : on réalise qu’on ne peut pas vivre sans psychologues au Liban. » Elles sont deux thérapeutes à se relayer pour assurer le suivi d’une centaine de patient·es des environs de la région de Tripoli.
« Je cherchais désespérément de l’aide depuis des mois. J’avais contacté quinze psychologues, ils étaient tous complets… »
Tamara, 33 ans
Il a fallu huit mois avant que Jocelyne Azar, psychiatre qui partage déjà son activité entre quatre établissements, accepte de les rejoindre un jour par semaine afin de prendre en charge quelques consultations. Si les recrutements sont de plus en plus difficiles, c’est parce que « la moitié des psychiatres ont quitté le pays », explique Georges Elie Karam, directeur exécutif de l’Institut pour le développement de la recherche et les soins appliqués (Idraac) et psychiatre à l’hôpital Saint George à Beyrouth. Son service a dû fermer trois lits sur treize en attendant de pouvoir remplacer les professionnel·les de santé parti·es à l’étranger. Plusieurs départs ont été précipités par l’explosion, qui a violemment affecté l’établissement. Les séquelles se lisent dans les fissures des murs et dans les voix meurtries de celles et ceux qui témoignent. « Vingt-quatre personnes sont décédées ici, dont l’infirmière qui travaillait en psychiatrie, confie Georges Elie Karam. L’explosion a été tellement traumatisante que c’est devenu soudainement “normal” de ne pas se sentir bien. Moi-même, je me suis demandé si je ne voulais pas partir vivre ailleurs. »

Un pays en état de choc
Tamara était elle aussi à Beyrouth, le 4 août 2020, lorsque des stocks de nitrate d’ammonium entreposés sur le port ont explosé, faisant plus de 220 morts et 7 000 blessés. Elle se sou vient du bruit. Des vitres qui valsent. Des affaires en l’air. Des cris dans la rue. « J’ai cru que c’était une bombe, ça m’a rappelé la guerre de 2006 avec Israël. J’étais en état de choc. Je n’ai pas dormi pendant les deux semaines qui ont suivi, je faisais dix à quinze attaques de panique par jour. » Le tremblement de terre survenu en Turquie et en Syrie en février dernier a ravivé ces blessures à peine cicatrisées. Stéphanie Bou Gebrayel a bien vu les conséquences du séisme dans la vie psychique de ses patient·es : « Les secousses ont réactivé chez eux des symptômes de stress post-traumatique, hérité des années de violence. Les gens ont eu peur, ils sont sur le qui-vive. Au Liban, le danger est perçu comme imminent. »
« On me disait que j’étais le docteur des fous. Notre métier était stigmatisé, alors qu’aujourd’hui c’est peut-être le boulot le plus demandé »
Stéphanie Bou Gebrayel, psychologue au centre el-Rahma, à Tripoli
Guerre civile, occupation syrienne, tensions avec Israël… Depuis des décennies, le pays vit bel et bien au rythme des conflits. À Beyrouth, les nouveaux gratte-ciel s’élèvent à côté des immeubles criblés de balles, symboles d’un passé qui ne passe pas. Leïla, Libanaise de 70 ans, vit dans une pièce étroite, à deux pas des vestiges de sa maison d’enfance, bombardée lors de la guerre de 1975. Le mobilier y est sommaire. Un lit, une grande armoire, une table sur laquelle sont posés une boîte de mouchoirs et quelques cendriers. Personne n’entre ici, excepté les assistantes sociales de l’Idraac, qui s’occupent aussi du suivi psychologique des personnes âgées, précaires et isolées. Leïla n’a pas d’argent, pas d’enfant, pas d’ami·es à qui parler. Depuis l’explosion, elle ne peut « plus rien gérer » : « Parfois, je n’ose pas sortir de chez moi. Je suffoque, j’ai un poids sur la poitrine, j’ai du mal à respirer. » Si elle continue à travailler deux jours par semaine en tant que femme de ménage, son maigre salaire ne suffit pas à combler ses besoins primaires. « J’ai tout perdu, avec la crise économique. On vivait mieux pendant la guerre : au moins, on avait de l’électricité, de l’eau potable, on pouvait s’acheter du pain et de quoi manger ! » Alors que la livre libanaise a perdu 98 % de sa valeur en l’espace de trois ans, plongeant la population dans une grande misère, les consultations psychologiques sont devenues aussi inaccessibles que nécessaires.

Pénurie de médicaments
C’est pour venir en aide aux plus démunis qu’Aya et Hussein, 24 et 31 ans, ont fondé Nation Station, une ancienne station-service de Beyrouth réhabilitée en pharmacie et en centre de distribution de nourriture. Car en plus de l’exode des cerveaux qui réparent, soignent et rafistolent, le Liban doit aussi faire face à la pénurie de médicaments. Avec l’inflation, certains anxiolytiques et antidépresseurs sont désormais des denrées rares que quelques Libanais·es se procurent à l’étranger ou au marché noir. Hussein et Aya récupèrent les boîtes périmées ou non utilisées. « On s’occupe de ce que l’État ne fait pas », déplore le frère aîné. Il n’est pas le seul à ne plus rien attendre des autorités, surtout depuis la fin de la thaoura. De cette révolution de 2019, où un quart de la population était descendue dans la rue, bien décidée à se débarrasser d’une classe politique jugée mafieuse et corrompue, il ne reste que la mascotte du poing levé sur la grande place des Martyrs de Beyrouth.
Désabusé mais pas résigné, le peuple libanais fait dans la résilience et le système D. « Au début, c’était surtout une initiative pour le quartier de Geitawi », témoigne Aya. Rien ne prédestinait cette jeune artiste à quitter ses sculptures pour travailler dans l’humanitaire. « Le port venait d’exploser, les gens avaient besoin de manger. On a commencé à fournir des kits de premiers secours et des médicaments que les gens nous donnaient. On était une toute petite équipe, mais c’est vite devenu une grosse opération. On est partis à la recherche de fonds internationaux, on a monté des dossiers, on a eu des subventions. » Trois ans plus tard, l’ancienne station-service, toujours debout, s’est dotée d’une pharmacie en dur, ainsi que d’une petite clinique où défilent plusieurs spécialistes. Chaque semaine, une psychologue y propose des consultations gratuites ou à tarif réduit, adapté au niveau de vie des bénéficiaires. « Les gens viennent de tout le pays. On est submergés. »

Les ONG prennent le relais
Alors que la société civile s’organise, le tabou de la santé mentale se brise. Les témoignages fleurissent sur les réseaux sociaux, tandis que les campagnes d’information essaiment à la télévision. Sur l’autoroute qui longe la côte méditerranéenne, de grandes pancartes bleu ciel s’élèvent entre les poteaux électriques et les oliveraies, affichant le chiffre désormais bien connu des Libanais·es : 1564. Ce numéro vert permet de joindre la ligne téléphonique de prévention du suicide mise en place par l’ONG libanaise Embrace, en 2017. En plein cœur du quartier de Hamra, à Beyrouth, cent vingt volontaires se relaient jour et nuit dans un bureau où la détresse se déverse à coups de sonneries. Nour est l’une d’entre eux·elles. « On a été formés par des psychologues pour évaluer les risques de suicide et savoir désamorcer les situations critiques. On ne raccroche que lorsqu’on sent que la personne n’est plus en danger, et qu’on a établi avec elle un “plan de sécurité”. » « On fait de notre mieux, mais on opère dans un système qui est cassé, ajoute Joëlle Jaber, psychologue et superviseure de la ligne d’écoute. Le pays manque de structures stables vers lesquelles orienter les patients. Quand les hospitalisations sont nécessaires, on n’a aucune solution. » Devant l’urgence de la situation, la permanence de huit heures a progressivement été étendue à quinze, vingt et une, puis vingt-quatre heures l’année précédente.
« Le pays manque de structures stables vers lesquelles orienter les patients. Quand les hospitalisations sont nécessaires, on n’a aucune solution »
Joëlle Jaber, psychologue et superviseure de la ligne d’écoute de prévention du suicide de l’ONG Embrace
D’autres initiatives sont nées, bâties sur les vestiges d’une ville soufflée par l’explosion. Au lendemain du 4 août 2021, six étudiants en psychologie ont ainsi lancé Be Brave Beirut (BBB), un système de soutien émotionnel par téléphone qui privilégie la sensibilisation et la prévention. Lynn Moghrabi et Nour Saab, respectivement 20 et 23 ans, font partie des quatre-vingts volontaires, la plupart élèves en dernière année de licence de psychologie. « On est très présents sur les réseaux sociaux, ça joue un grand rôle dans la déstigmatisation. » Alors que plus de 1 500 personnes ont déjà été suivies, les six fondateurs de l’association ont, quant à eux, tous quitté le pays. Lynn sera diplômée cette année et se pose déjà la question : partir ou rester ? Si de nombreux·euses Libanais·es aspirent à quitter leur pays, d’autres les rejoignent dans l’espoir d’une une vie meilleure. Selon les Nations unies, les réfugié·es syrien·nes représenteraient un cinquième de la population. Hiba, Hind et Doaa ont fui la Syrie en 2013 et vivent désormais à Nabatié, dans le sud du pays. Ces femmes d’une trentaine d’années ont grandi dans une société où les peines se taisent, les violences domestiques se cachent et les larmes se ravalent. En plus des traumatismes liés à la guerre et à l’exil, elles subissent le racisme et l’ostracisme. C’est vers ces personnes marginalisées que Farah Wardani, dramathérapeute, a décidé de se tourner. « On voit chez ces femmes beaucoup d’anxiété, de dépressions et de symptômes de stress post-traumatique. »
« On dit souvent que c’est une psychanalyse en action : on bouge, on travaille directement au niveau du corps »
Farah Wardani, dramathérapeute et directrice de l’ONG Laban

En 2022, la comédienne a organisé une centaine de sessions de cette « thérapie par le théâtre. C’est une méthode collective, qui touche plus de gens et répond à un besoin urgent. On dit souvent que c’est une psychanalyse en action : on bouge, on se met en mouvement, on travaille directement au niveau du corps ». Danse, chant, méditation, sophrologie, psychodrame… Les exercices sont multiples et varient d’une séance à l’autre. Chaque semaine, dans cet espace clos, douze femmes partagent leurs histoires. Ce matin, elles forment un rond de larmes et de désespoir. « On n’a plus de futur », lâche Doaa entre deux sanglots. Cette mère de famille de 33 ans a fui la guerre en Syrie dès le début du conflit. « On pensait que nos enfants auraient un avenir ici, mais le pays ne leur assure même pas d’éducation. Les écoles sont tout le temps fermées, les enseignants ne viennent plus parce qu’ils ne sont plus payés. On se sent complètement abandonnées. Quand je viens ici, je me sens plus forte, même si je pleure beaucoup. » Au fil des séances, les corps se déverrouillent et les tensions se dénouent. La dramathérapie aide ces femmes à s’exprimer autrement. « C’est le seul espace où on peut le faire. Dehors, je ne trouve pas les mots », confesse Hindi, 35 ans. Les mots manquent aussi à Fatmé, qui a perdu son frère dans le séisme en Turquie, et à Hiba, sous antidépresseurs depuis plusieurs mois. « Des mots, des mots, des mots », se répète à voix basse Hindi, en citant Shakespeare. Ils aident à panser les maux. « Le théâtre ne change pas la réalité ni les causes des souffrances. Les problèmes sont toujours là. Mais grâce à ça, on se sent beaucoup mieux. » Elle lève les yeux et balaie l’air d’un geste de la main. « Je me dis que tout va passer. La joie, la tristesse, la souffrance, tout bouge. » À Nabatié, comme ailleurs au Liban, on cherche une échappatoire pour soulager la douleur. Une fenêtre pour entretenir l’espoir de jours meilleurs.
Lire aussi l Mona El Hallak, l’architecte au chevet des vieilles pierres de Beyrouth
- Le centre a été financé par l’Agence française de développement.[↩]