Alors que le monde s’ouvre à peine aux personnes trans, voilà qu’il découvre les détrans : celles et ceux qui reviennent sur leur transition. Certain·es ont accepté de nous livrer leur vécu, malgré la crainte, trop souvent étayée, de voir leur histoire récupérée par les opposant·es au genre.
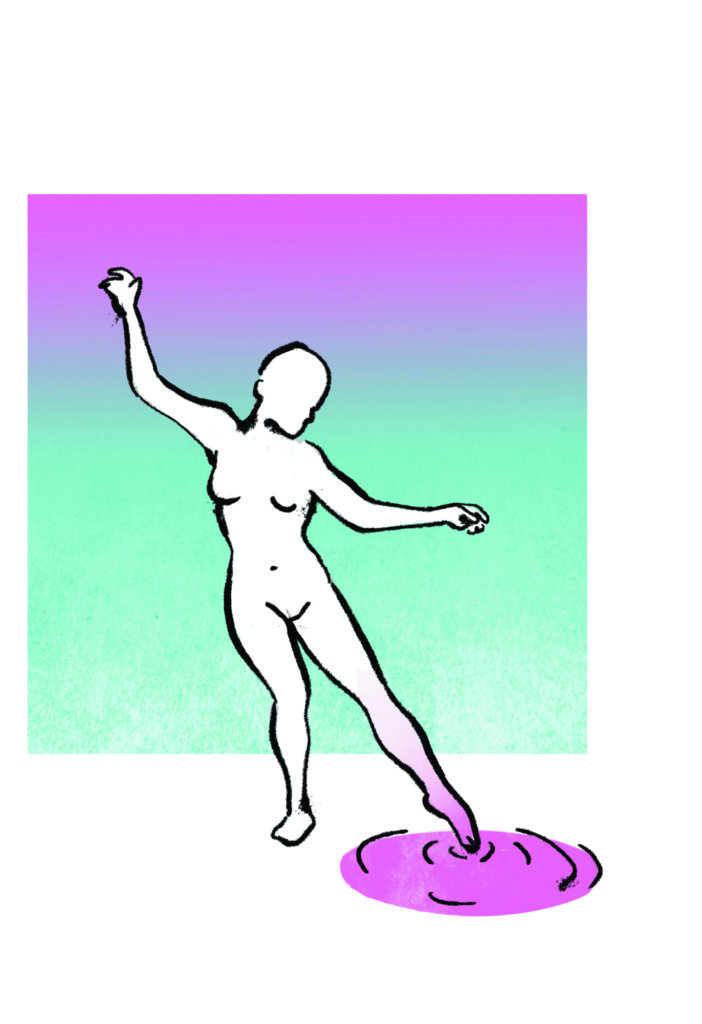
Le sujet est délicat à tellement d’égards que « c’est comme s’il n’y avait pas de bonne manière d’en parler ». Elle a beau avoir cofondé Post Trans, l’une des premières assos dédiées au sujet et être elle-même concernée, Élie, 22 ans, cheveux courts blond scandinave, originaire de Belgique, prend des pincettes. Ce sujet, c’est la détransition.
« À 15 ans, j’ai annoncé à ma famille que j’étais lesbienne, relate-t-elle. Ça s’est bien passé. Ma sœur m’a répondu qu’elle était fière de la femme que je devenais. C’est là que ça m’a heurté·e : je ne me sentais pas “femme”. » Une réflexion s’amorce sur son identité de genre. Selon le protocole en vigueur, Élie consulte une association trans, plusieurs psys et un gynéco recommandé par cette asso qui lui permettra de commencer un traitement hormonal pour transitionner vers le genre masculin. De la testostérone, suivie d’une mastectomie (ablation des seins). « Je me sentais de mieux en mieux dans mon corps. J’avais le sentiment de me le réapproprier. » Mais, au fil du temps, « je me suis rendu compte que je me sentais mal à l’aise avec le statut d’homme hétéro. J’avais le sentiment de cacher une partie de moi ». Alors à 20 ans, Élie arrête les hormones, lâche son prénom masculin et recommence à se faire genrer au féminin. C’est ce processus de passage vers un autre genre après une première transition que l’on appelle « détransition »1
Depuis la diffusion de séries documentaires sur le sujet entre 2018 et 2020 (aux Pays-Bas, en Suède et en Angleterre), le sujet affole les médias étrangers. Ce qui les alarme : l’augmentation des demandes de transitions (quatre fois plus en cinq ans, par exemple, dans le principal service de réassignation de genre du Royaume-Uni). En France, elles ont été multipliées par cinq depuis 2012, nous a rapporté l’Assurance Maladie, atteignant environ (et seulement) cinq cents dossiers.
Pas de débat sur cette tendance : tous les acteur·rices du monde médical en Europe et en France s’accordent dessus. Mais elle cacherait, s’inquiètent les détracteur·euses, des cas de transitions trop rapides et donc de futur·es détransitionneur·euses. Un argument en or pour les sphères anti-LGBTQI+ : si des personnes éprouvent des regrets à la suite d’une transition, voilà la preuve qu’il faudrait en corser les conditions d’accès. Pourtant, sociologues et militant·es estiment que le chiffre de détransitions tourne autour de 1 % des personnes trans seulement. Le chirurgien spécialiste en réassignation de genre Romain Weigert, seul soignant français membre du comité scientifique de l’Association professionnelle européenne pour la santé des transgenres (EPATH), n’a reçu que trois demandes en quinze ans de carrière. Le sujet se prête d’autant plus aux spéculations qu’il n’existe aucune étude de référence. En France, aucun contenu (à part un article de Closer et de L’Incorrect, « média conservateur »). Et, dans la sphère médicale, « aucune recommandation de la Haute Autorité de santé ni des instances européennes pour accompagner une éventuelle détransition », note Romain Wiegert.
Voyage personnel
Cet argumentaire du regret se fonde sur la théorie d’une chercheuse américaine, Lisa Littman : la « manifestation rapide de dysphorie de genre » (Rapid onset of gender dysphoria). Selon elle, les ados, en particulier assigné·es filles, s’identifieraient comme trans de plus en plus rapidement, en raison de « contagion sociale », notamment « sur les réseaux sociaux ». L’idée, si elle dérange ainsi formulée, fait néanmoins écho à certains témoignages de personnes détrans. Celui d’Élie, encore. « Je voulais aller hyper vite, pour sortir de mon état de détresse. » Cependant, alerte fermement l’Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres, la théorie de Lisa Littman « n’est reconnue par aucune association professionnelle majeure ». Et surtout, si l’on écoute les personnes concernées, la rhétorique du regret est loin de s’appliquer à chaque détransition.
« En révélant Ashlyn, j’ai aussi caché Dustin. Tout allait bien dans ma vie […], mais je n’étais pas totalement heureux. J’ai senti qu’il fallait renouer avec Dustin.
J’ai pensé : "Peut-être que ce voyage a pris fin". »
Dustin, 38 ans, né intersexe et assigné homme. Il a transitionné vers le genre féminin, vivant près de dix ans en tant qu’Ashlyn, puis a détransitionné début 2020
Il n’y a qu’à écouter Dustin. Ce barbu en chemise à carreaux de 38 ans, photographe dans le Colorado (États-Unis), est né intersexe, a été assigné homme et a vécu « pendant presque dix ans » en tant qu’Ashlyn. Il a détransitionné (arrêté les hormones féminines et recommencé à s’identifier au masculin) début 2020, au premier confinement. « J’avais profondément besoin d’explorer l’identité d’Ashlyn pour survivre. J’y ai trouvé un sentiment de cohésion lorsque j’en avais besoin, après la vingtaine. » Pourquoi avoir détransitionné ? « En révélant Ashlyn, j’ai aussi caché Dustin. Tout allait bien dans ma vie, j’avais un super job, mon mariage se solidifiait, mais je n’étais pas totalement heureux. J’ai senti qu’il fallait renouer avec Dustin. J’ai pensé : “Peut-être que ce voyage a pris fin”. »
Il en est de même pour Archie2. Visage jovial et cheveux lisses tombant dans le bas du dos, cette apprentie sociologue s’identifie comme une « femme lesbienne ». Ses deux premières années de fac se sont passées en tant qu’homme trans. « Cette expérience a été un moment de grande libération. » Libération d’une enfance bridée « dans la campagne de l’Ain » et dans une famille défaillante, d’années de harcèlement à l’école et d’une relation de soumission à un partenaire malsain. « C’est la première fois que j’ai pu choisir qui j’étais. Être une femme, on me l’avait imposé. Je garde de cette époque la notion de choix. » Elle ne parle pas de détransition mais de « retransition », pour souligner que son parcours n’est pas un retour en arrière, mais une nouvelle étape de sa vie, impossible sans la précédente.
Irréversibilité
Le sujet n’exciterait pas les foules sans la question de l’irréversibilité. Très concrètement, « les opérations sont irréversibles », tranche le chirurgien Romain Weigert. On peut procéder à des reconstructions type vaginoplasties, phalloplastie ou opérations mammaires, comme dans des transitions, mais cela implique des procédures de nouveau très longues, complexes et potentiellement « décevantes ». Concernant la prise d’hormones, les effets varient. Peu de séquelles sur Dustin. Pilosité et « répartition des graisses » sont « revenues », avec de l’exercice régulier. Beaucoup de femmes détrans rapportent en revanche que leur voix reste grave, marquée à vie par la testostérone. Certaines le regrettent. D’autres, non. Tous et toutes n’estiment pas avoir été correctement informé·es à ce sujet. Comme Élie, qui considère « n’avoir pas eu toutes les cartes en main » pour comprendre tout ce que son choix impliquait.

Mais le sujet le plus inflammable est que ces interrogations ont un impact par ricochet sur les droits des personnes trans, plus nombreuses que les personnes détrans. Arnaud Alessandrin, sociologue spécialiste des transidentités, est l’auteur du seul texte académique français sur la détransition3. Prudent face à notre démarche, il prévient : « Parler de détransition, c’est poser la question du “principe de précaution”. » Et prendre le risque de raviver un héritage médical pathologisant et dévastateur pour les personnes trans.
Lorsqu’en 1953 la psychiatrie a défini le « transsexualisme » (terme utilisé à l’époque), « la grande peur était qu’en élargissant l’accès aux opérations, on en vienne à opérer des personnes dont la demande exprimait le symptôme de pathologies comme la schizophrénie, la bipolarité ou la dysmorphophobie [préoccupation intense concernant un défaut imaginaire de l’apparence physique, ndlr]. » Aujourd’hui, la grande peur cible un autre sujet : les transitions des mineur·es. Avec, en arrière-plan, la question qui tue : faut-il renforcer le temps et les critères de discernement avant d’accompagner les jeunes dans leur transition ?
Le Royaume-Uni y a répondu en décembre 2020 par l’affirmative. La justice a en effet restreint les conditions d’accès aux soins de transition aux mineur·es de moins de 16 ans, ne les estimant pas capables de formuler un consentement « libre et éclairé » au sujet de leur identité. La décision fait suite à « l’affaire Keira Bell ». Assignée femme à la naissance, Keira Bell a entamé un traitement hormonal à 16 ans pour matcher avec son identité masculine. La vingtaine passée, elle détransitionne. Et attaque la clinique qui lui avait administré le traitement, qu’elle regrette. Dans ce débat, sont particulièrement ciblés les bloqueurs de puberté, première étape de transition proposée aux mineur·es. Ils servent à retarder l’apparition de la puberté afin de leur laisser « le temps » d’affirmer leur identité.
Mais « en interdisant ces traitements aux mineurs, schématise Arnaud Alessandrin, on dit aux jeunes : “Il faut savoir qui tu es, maintenant.” » Là où les bloqueurs de puberté leur laisseraient une marge de manœuvre, on les pousse vers une puberté qu’ils et elles voient comme une grande souffrance. « Moi, je connais un effet secondaire si je n’avais pas transitionné, rétorque Sacha 2 : le suicide. » Il se reconnaît aujourd’hui comme non binaire, après avoir vécu comme homme trans pendant deux ans et demi (et préfère utiliser le pronom « il »). Au milieu de tonnes de références à la littérature LGBTQI+, il confie : « Transitionner m’a sauvé de l’anorexie et m’a permis de comprendre que j’avais de la valeur. »
Risques de suicide
En France, rapporte Catherine Doyen, psychiatre spécialiste des enfants et de l’autisme dans l’unité « dysphorie de genre » de l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, « on prescrit moins facilement de bloqueurs de puberté que d’autres pays. On commence plutôt les transitions à partir de 16 ans. Pourtant, quand on voit les conséquences psychopathologiques de cette attente, ça vaut peut-être le coup d’anticiper ». Les personnes trans ont en effet 41 % de risques de faire une tentative de suicide dans leur vie, contre 5 % pour le reste de la population. Quel « risque » la société souhaite-t-elle faire peser dans la balance : proposer des bloqueurs de puberté aux jeunes incertain·es, quitte à ce qu’ils et elles détransitionnent4 , ou le suicide ?
L’argument mobilisé pour limiter l’accès aux bloqueurs de puberté est l’incertitude quant aux effets secondaires. L’Américain William Malone est l’un des endocrinologues les plus opposés à leur utilisation. Il évoque des risques de « densification des os ». D’autres détracteur·euses parlent entre autres de possibles conséquences sur le développement cérébral. « Il n’y a actuellement aucune preuve convaincante que les bloqueurs de puberté, les hormones et les opérations améliorent l’état psychologique des jeunes », ajoute-t-il. Sauf qu’aucune recherche ne dresse de conclusion définitive et ne fait consensus dans le monde médical. La dernière étude que William Malone nous présente, publiée dans l’American Journal of Psychiatry en 2019, va d’ailleurs dans le sens d’« appuyer la décision de prescrire des opérations d’affirmation de genre aux personnes transgenres qui le demandent ». Certain·es sources affirment même que tout débat médical devrait être clos, grâce au dernier référentiel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le texte, datant de 2020, préconise d’entamer les transitions lorsque l’on décèle une « incongruence de genre ». Vocabulaire crucial. Le mot permet en effet à chacun·e de « déterminer son identité de genre, sans forcément être au bord du suicide », comme le requérait l’ancienne terminologie, relate Marie-Pierre Julien, sociologue et membre de l’équipe TransEst au CHU de Nancy.
Ouvrir le genre
S’ajoute à ces débats éthiques un autre tabou. Celui de la non-binarité. Éli (sans « e », cette fois !), biologiste de 28 ans originaire d’Allemagne, se dit non binaire. Son corps fin parsemé de tatouages, son carré noir et sa gestuelle apaisée lui donnent un air de yogi. Après dix-neuf ans dans un corps assigné femme, « je m’identifiais fermement comme un homme. J’ai donc entamé une transition en 2011 ». Cinq ans plus tard, « j’ai arrêté de prendre mes shots de testostérone d’un coup et j’ai repris des œstrogènes. Aujourd’hui, je suis de nouveau vue comme une femme et ça ne me dérange pas, mais je me définis comme non binaire. Le corps que j’ai à ce stade aujourd’hui est le bon pour moi ». Éli fait ici référence à la mastectomie opérée pendant sa transition. Ce fut, et c’est toujours, un « soulagement joyeux ». Pas question de revenir dessus en se reconstruisant une poitrine. Ce choix est-il signe que sa transition aurait été inutile si la société lui avait d’emblée permis d’être une femme hors des schémas classiques, en retirant juste ses seins ? Non, insite Éli. Comme Dustin, Archie et Sacha, c’est la somme de sa transition et de sa détransition qui lui a permis de se trouver. « C’était un choix de vie important ; un choix de vie comme on en fait tous, comme choisir sa carrière ou se marier. » Rappel important, souligne Sacha, pour que l’on n’en fasse pas un nouvel argument pour dissuader les personnes trans de transitionner.
« C’était un choix de vie important ; un choix de vie comme on en fait tous, comme choisir sa carrière ou se marier »
Éli, 28 ans, assigné femme à la naissance, a transitionné vers le genre masculin en 2011 et détransitionné en 2016
La question ouvre cependant un nouvel horizon pour les droits trans. D’autant que « 30 % des personnes trans qui s’adressent à nous s’identifient comme non binaires ou ne sachant pas », estime-t-on dans un CHU de province (qui n’a pu nous divulguer l’information qu’anonymement). « Les détransitions amènent, depuis une quinzaine d’années, la perspective de mener des transitions “partielles”, ajustées à la manière dont les personnes définissent leur identité », analyse Thierry Gallarda, psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne et référent des consultations « dysphories de genre ». Comme quelqu’un qui voudrait « se débarrasser de sa poitrine, adopter un traitement hormonal léger, avoir une barbe ».
La formulation parlerait à Dustin. En tant qu’Ashlyn, « j’avais le sentiment de devoir cocher des cases de féminité et suivre un parcours linéaire », regrette-t-il. Mais les institutions médicales n’y semblent pas prêtes. Surtout en France, où l’accompagnement aux personnes trans repose sur une « tradition psychanalytique » bien solide, reconnaissait la Cour de cassation elle-même, lors de son dernier colloque sur la transidentité le 2 avril. Tradition héritée de Freud qui rend les critères pour avoir le droit de transitionner justement très binaires.
Les frais de Freud
David Bell est de cette école. Psycha–nalyste, il a longtemps fait partie de l’administration du plus grand « service de développement de l’identité de genre » du Royaume-Uni et s’oppose aux transitions pour les mineur·es. Il a rédigé un rapport interne pour inciter à en durcir les conditions. « J’ai le sentiment qu’il y a quelque chose de sacré dans le corps, expose-t-il, et que les interventions rapides le traitent comme si c’était un magnétoscope, sur lequel vous pourriez appuyer sur “pause”. »
« Ce qui est un parcours de vie pour les uns est présenté sous le prisme de l’erreur pour les trans »
Arnaud Alessandrin, sociologue spécialiste des transidentités
Il est important de noter que certaines personnes détrans se retrouvent dans ce discours. C’est le cas du militant américain Walt Heyer, 77 ans. Après « huit années » passées en tant que femme trans, il a détransitionné au début des années 1990. Depuis, il milite contre la transition, un « préjudice », que l’on s’auto-inflige, selon lui, à cause de traumas d’enfance. Lui qui est allé jusqu’à l’opération génitale a le ton grave. « Certaines choses ne peuvent pas être récupérées », souffle-t-il.
C’est aussi plus ou moins le cas d’Em, Suédoise de 27 ans ayant détransitionné à 23 ans. Même si la transition FtM (« female to male ») fut « libératrice » sur le coup, elle a aujourd’hui un avis tranché : « Je considère que personne ne devrait être autorisé à faire quoi que ce soit avec son corps avant 25 ans. » Mais, ne serait-ce pas là une discrimination faite aux personnes trans par rapport à ce que la société permet aux corps des personnes cisgenres ? Arnaud Alessandrin prend l’exemple des opérations de chirurgie esthétique. « Quand un homme cis veut faire une pénoplastie, il n’a pas trois ans de diagnostic à faire. » Idem pour les opérations mammaires et les hormones. Lorsqu’il s’agit de pilule contraceptive ou de traitements dans le cadre de la ménopause, personne ne tique. « Ce qui est un parcours de vie pour les uns, résume le sociologue, est présenté sous le prisme de l’erreur pour les trans. »

Il est enfin un ultime revers rendant les détransitions si explosives. La frilosité des sphères trans et LGBTQI+ elles-mêmes, conscientes de toute cette charge symbolique. « Si l’on pose des questions sur la détransition, on est automatiquement étiqueté comme transphobe », résume le psychanalyste David Bell. Les premières réactions qu’a suscitées notre enquête confirment ce point. Après un interrogatoire de dix minutes et un long échange téléphonique, l’asso trans Acceptess-T a finalement demandé à ne pas être citée dans notre article, doutant de notre « éthique ». Une autre asso, qui a quant à elle voulu rester anonyme, justifie : « L’un des problèmes à parler de suivi psychiatrique fort sous le mauvais prétexte d’espérer avoir moins de détransitions, c’est qu’on empêche des personnes de transitionner, ce qui génère de l’automédication [comprendre, des personnes qui se tournent vers le marché noir des hormones] sans aucun suivi médical. Comme ces personnes sortent du radar, on les ignore. »
Pour les personnes détrans, il reste donc « difficile d’ouvrir la conversation », confie Élie. À la difficulté d’assumer un deuxième coming outs’ajoute, comme l’exprime Sacha, notre lettré·e, la crainte de fragiliser « [ses] frères et sœurs trans, qui ne [lui] ont apporté que de l’amour et du soutien ». Et pour cause. Certain·es ne se privent pas de jeter de l’huile sur le feu. Comme David Bell. « Les personnes trans détestent les personnes détrans, avance-t-il, elles sont courageuses de parler. » Il n’est rien de plus facile que de récupérer l’histoire des minorités les plus marginalisées.
- Comme les transitions, les détransitions peuvent être à la fois sociales (usage de nouveaux pronoms, vêtements, coiffure, etc.) et médicales (bloqueurs de puberté pour les ados, hormones et opérations chirurgicales)., et qui fait polémique.[↩]
- Les prénoms ont été modifiés.[↩]
- « La notion de regret dans la clinique du changement de genre », L’Évolution psychiatrique, vol. 84, n° 2, pages 177 à 284. Elsevier, 2019.[↩]
- La prise de bloqueurs de puberté est suivie de la prise d’hormones dans 95 % des cas.[↩]





