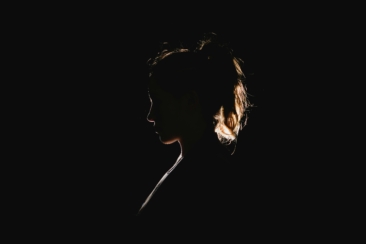Contre le réchauffement climatique ou le sort indigne réservé aux animaux, pour aider les migrant·es ou protéger les populations des pesticides de synthèse, la désobéissance civile semble être devenue, pour beaucoup, l’ultime recours.
Face au sentiment d’inaction des pouvoirs publics, de plus en plus de citoyen·nes usent de ce mode de protestation pour se faire entendre. Qu’elles soient isolées ou groupées, ces actions, qui ont récemment surgi dans le paysage médiatique, ont pour objectif de faire parler d’elles.

Elles sont le nouveau visage de la désobéissance. Sur les photos, les Allemandes Carola Rackete et Pia Klemp ont le regard tranquille, mais déterminé de celles qui sont animées d’une mission. Pour sauver des migrant·es de la noyade dans ce grand cimetière qu’est devenue la Méditerranée, les deux capitaines de navire d’ONG n’ont pas craint de braver l’Italie et son ministre de l’Intérieur d’extrême droite Matteo Salvini. Arrêtée pour avoir tenté d’accoster de force dans le port de Lampedusa puis assignée à résidence, la première a finalement été libérée. La seconde, toujours poursuivie par la justice italienne, encourt jusqu’à vingt ans de prison. « Ce n’était pas un acte de violence, seulement de désobéissance », a plaidé Carola Rackete.
Ces temps-ci, les initiatives qui s’en réclament essaiment tous azimuts : les décrocheur·euses de portraits de Macron, les maires qui prennent des arrêtés antipesticides sur leur commune, les « gilets jaunes » qui ne déclarent pas en préfecture les trajets de leurs manifestations, les défenseur·euses des animaux qui pénètrent dans des abattoirs sans autorisation et diffusent des images interdites, les professeur·es baptisé·es les Stylos rouges, qui ont refusé de saisir les notes du bac, les médecins qui déclarent avoir aidé des couples du même sexe à avoir un enfant… Les citoyen·nes sont de plus en plus nombreux à plébisciter ce mode d’action non violent qui, stricto sensu, consiste à refuser d’appliquer une loi ou de se soumettre à un ordre en son nom propre, à visage découvert. Sans craindre de finir au poste, voire devant les tribunaux pour y défendre sa cause.
« J’ai participé à des manifestations, signé des pétitions… Ça ne marche pas ! Nous vivons un moment historique et pourtant les États ne changent pas de cap. Il faut aller plus loin, se radicaliser sans violence », clame Emma, membre du jeune collectif ANV-COP21 (Action non violente-COP21) fondé en 2015 dans le sillon de la conférence de Paris sur les changements[…]